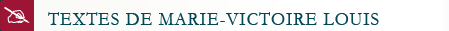Violences
Extrait de l’Abécédaire féministe
À la recherche du patriarcat…
L’abécédaire féministe, profondément revu, comporte dorénavant 29.639 items et 23 rubriques : I. Culture (1230) ; II. Droit (469) ; III. Êtres humains (1.605) ; IV. Corps (765) ; V. Enfants (403) ; VI. Femmes (3.745) ; VII. Hommes (1.959) ; VIII. Relations entre êtres humains (1.085) ; IX. Famille (749) ; X. Féminismes (518) ; XI. Justice (1.162) ; XII. Langage (1.303) ; XIII. Patriarcat (931) ; XIV Penser (2023) ; XV. Politique (3.123) ; XVI. Pornographie (189) ; XVII. Proxénétisme (558) ; XVIII. « Sciences » sociales (954) ; XIX. Démographie (36) ; XX. Économie (1.361) ; XXI. Histoire (1.072) ; XXII. Sexes [Sexualité, Sexisme…] (326) ; XXIII. Violences (803) … et continuera d’évoluer.
* Ajout. Depuis le 11 juillet 2023. XXIV. Dialogues (3271)
3 octobre 2025
XXIII. Violences
En noir. Items nouveaux (et modifiés)
I. Viols : Viols (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ; Par ordre alphabétique Viols (Anticommunisme) ; Viols (Balkany Patrick) ; Viols (Balzac Honoré de) ; Viols (Banks Russel) ; Viols (Bataille Georges) ; Viols (Bellil Samira) ; Viols (Boyd William) ; Viols (Brassens Georges) ; Viols (Canard enchaîné Le) ; Viols (Céline Louis-Ferdinand) ; Viols (Chaunu Pierre) ; Viols (Clouzot Henri-George) ; Viols (C. News) ; Viols (« Consentement ») (1, 2) ; Viols (Correctionnalisation des) ; Viols (Culture) ; Viols (Déni) (1, 2, 3) ; Viols (« Dominations ». France Culture) ; Viols (Drouelle Patrice) ; Viols (Femmes) ; Viols (Impuissance des femmes) ; Viols (Fan) ; Viols (Flagg Fannie) ; Viols (Flaubert Gustave) (1, 2, 3) ; Viols (Galey Matthieu) ; Viols (Gandhi) ; Viols (Goretti Marietta) ; Viols (Guerre. Algérie) (1, 2) ; Viols (Guilloux Louis) ; Viols (Guyotat Pierre) ; Viols (Hegel Friedrich) ; Viols (« Hélas ») ; Viols (Honte) ; Viols (Hymen) ; Viols (Incident) ; Viols (Julie) ; Viols (Kafka Franz) ; Viols (Kolyma) ; Viols (Lahaie Brigitte) ; Viols (Langage) (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Viols (Macron Emmanuel) ; Viols (Maternité) ; Viols (Marzouki Moncef) ; Viols (Maupassant Guy de) ; Viols (Métis) ; Viols (Michelet Jules) ; Viols (Morali-Daninos André) ; Viols (Mo Yan) ; Viols (Naouri Aldo) ; Viols (Négation) ; Viols (« Orgie ») ; Viols (« Pudeur ») ; Viols (Proust Marcel) ; Viols (Racisme) ; Viols (Romans anglais. XIXème siècle) ; Viols (Roy Arundhati) ; Viols (Roy Claude) ; Viols (Sylvestre Anne) ; Viols (Taï Abdellah) ; Viols (Tentative de) ; Viols (Tulard Jean) (1, 2) ; Viols (Vallet Odon) ; Viols (Violarcat) ; Viols (Vergès Jacques) ; Viols (et vol) (1) Par ordre chronologique (1) ; Viols (« en série ». En bande organisée, en réunion, collectifs) ; Viols (Violeurs. Paroles de) ; Viols (Violeurs. Dénégation) ; Viols (Violeurs. Tordjman Gilbert) ; Viols (Violeurs. Soldats russes en Allemagne) ; Viols (Zola Émile) (1, 2, 3, 4) ; Viols (Zemmour Éric) ; (101)
II. Violences : Violences (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; Par ordre alphabétique Violences (Afghanistan) ; Violences (« Bizutages ») (1, 2) ; Violences (Brecht Bertolt) ; Violences (Breton André) ; Violences (Burke Edmond) ; Violences (Churchill Winston) ; Violences (« Conjugales ») (1, 2, 3) ; Violences (Conséquence) ; Violences (« Consentement ») ; Violence (« Cycle de la violence ») ; Violences (Cyrulnik Boris) ; Violences (David-Neel Alexandra) ; Violences (Décapitation) ; Violences (Diderot Denis) ; Violences (Distinction mineur-es / majeur-es) ; Violences (« Dix commandements ») ; Violences (Eros et thanatos) ; Violences (Église catholique. Jésuites) ; Violences (Église catholique. Évêques) ; Violences (Église catholique. Pape) ; Violences (« Folie meurtrière ») ; Violences (France Culture) (1, 2, 3) ; Violences (Gresh Alain) ; Violences (Jarry Alfred) ; Violences (Kropotkine Pierre) ; Violences (Loi…) (1, 2) ; Violences (Lois religieuses) (1) (Christianisme) (1, 2, 3) ; Violences (Lois religieuses. Islam (1, 2) ; Violences (Logement) ; Violence (Luttes) ; Violences (Marat) ; Violences (« Métaphore de la tasse de thé ») ; Violences (Montesquieu) ; Violences (« Motifs ») ; Violences (Nietzsche Friedrich) ; Violences (Niées) ; Violences (Nin Anaïs) ; Violences (Pascal Blaise) ; Violences (Pareto Vilfredo) ; Violences (Prêtres) ; Violences (« Pudeur ») ; Violences (Regrets) ; Violences (Respect) ; Violences (Rousseau Jean-Jacques) ; Violences (Roy Arundhati) ; Violences (Servage) ; Violences (Sexuelles) ; Violences (Sports) (1, 2, 3) ; Violences (Statistiques) ; Violences (« Stress post-traumatique ») ; Violences (Suicide) ; Violences (Suicides après assassinat[s]) ; Violences (Styron William) ; Violences (Symboliques) ; Violences (Tchékhov Anton) ; Violences (Terkel Studs) ; Violences (Tolstoï Léon) ; Violences (Vallès Jules) ; Violences (Victimes) (1, 2, 3) ; (86)
III. Violences. Sade : Violences. Sade (1, 2, 3, 4) ; Par ordre alphabétique Violences. Sade (Apollinaire) (1, 2) ; Violences. Sade (Bataille Georges) ; Violences. Sade (Barthes Raymond) ; Violences. Sade (Blanchot Maurice) ; Violences. Sade (Breton André) (1, 2, 3) ; Violences. Sade (Camps de concentration) ; Violences. Sade (Camus Albert) ; Violences. Sade (Deforges Régine) ; Violences. Sade (Delon Michel) ; Violences. Sade (Dworkin Andrea) ; Violences. Sade (Flaubert Gustave) (1, 2) ; Violences. Sade (France Culture) ; Violences. Sade (Freud Sigmund) ; Violences. Sade (Jeangène Vilmer Jean-Baptiste) ; Violences. Sade (Heine Maurice) ; Violences. Sade (Klossowski Pierre) ; Violences. Sade (Lebel Jean-Jacques) ; Violences. Sade (Lely Gilbert) ; Violences. Sade (Le Monde) ; Violences. Sade (Lévy Bernard-Henri) ; Violences. Sade (Miller Alice) ; Violences. Sade (Nadeau Maurice) ; Violences. Sade (Prix) (1, 2, 3) ; Violences. Sade (Robbe-Grillet Alain) ; Violences. Sade (Sacher-Masoch Leopold von) ; Violences. Sade (Sollers Philippe) (1, 2) ; Violences. Sade (Starobinski Jean) ; Violences. Sade (Surréalistes) ; Violences. Sade (Tulard Jean) ; Violences. Sade (Vaneigem Raoul) ; Violences. Sade (Winock Michel) ; (43)
IV. Violences à l’encontre des enfants : Par ordre alphabétique. Violences à l’encontre des enfants (Anderson Hans-Christian) ; Violences à l’encontre des enfants (« Ballets roses ») (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Béjart Maurice) ; Violences à l’encontre des enfants (Bernanos Georges) ; Violences à l’encontre des enfants (Bruckner Pascal, Finkielkraut Alain) ; Violences à l’encontre des enfants (Buchenwald. 1945) ; Violences à l’encontre des enfants (Céline Louis-Ferdinand) ; Violences à l’encontre des enfants (CIIVISE. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Édouard Durand) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ; Violences à l’encontre des enfants (Circoncision) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des enfants (Comtesse de Ségur) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Collège Stanislas) ; Violences à l’encontre des enfants (Dickens Charles) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Dostoïevski Fiodor) (1, 2, 3, 4) ; Violences à l’encontre des enfants (Doillon Jacques) ; Violences à l’encontre des enfants (Dourov Pavel) ; Violences à l’encontre des enfants (Dubreuil Christian) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Éducation nationale) ; Violences à l’encontre des enfants (« Fantasme ») ; Violences à l’encontre des enfants (Église catholique) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Fessée) Par ordre chronologique (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Flaubert Gustave) ; Violences à l’encontre des enfants (France Culture) ; Violences à l’encontre des enfants (Galey Matthieu) ; Violences à l’encontre des enfants (Gide. André) (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Violences à l’encontre des enfants (Girard André) ; Violences à l’encontre des enfants (Hugo Victor) ; Violences à l’encontre des enfants (« Interdit de l’inceste ») ; Violences à l’encontre des enfants (Lang Jack) ; Violences à l’encontre des enfants (Langage) ; Violences à l’encontre des enfants (Léautaud Paul) ; Violences à l’encontre des enfants (Le Scouarnec Joël) ; Violences à l’encontre des enfants (Levasseur Thérèse) ; Violences à l’encontre des enfants (Loi) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Lou Andréas Salomé) ; Violences à l’encontre des enfants (M. Le maudit) ; Violences à l’encontre des enfants (Matzneff Gabriel) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Márai Sándor) ; Violences à l’encontre des enfants (« Mensonges ») ; Violences à l’encontre des enfants (Montherlant Henri de) ; Violences à l’encontre des enfants (« Pédophiles ») (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Pivot Bernard) ; Violences à l’encontre des enfants (Mirbeau Octave) ; Violences à l’encontre des enfants (Prêtres) (1, 2) ; Violences à l’encontre des enfants (Prytanée) ; Violences à l’encontre des enfants (Radio Libertaire) ; Violences à l’encontre des enfants (Réunionnais en France) ; Violences à l’encontre des enfants (Rhénanie. Nord-Westphalie. 2020) ; Violences à l’encontre des enfants (Riaumont. Foyer de) ; Violences à l’encontre des enfants (Roland Madame) ; Violences à l’encontre des enfants (Roy Claude) ; Violences à l’encontre des enfants (Sand George) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des enfants (Trump Donald) ; Violences à l’encontre des enfants (Vallès Jules) ; Violences à l’encontre des enfants (Viot Michel Abbé) ; Violences à l’encontre des enfants (Zola Émile) ; (89)
V. Violences à l’encontre des enfants. Infanticides : Par ordre alphabétique. Infanticides (Beccaria Cesare) ; Infanticides (Chine. Shanghai. Années 50) ; Infanticides (Frédéric II.) ; Infanticides (Gramsci Antonio) ; Infanticides (Histoire) ; Infanticides (Kafka Franz) ; Infanticides (Mère) ; Infanticides (Mère. Esclavage) ; Infanticides (Michelet) ; Infanticides (Père) (1, 2, 3) ; Infanticides (Procès. Tunisie (autour de 1914) ; Infanticides (Revendication) ; Infanticides (Tolstoï Léon) (1, 2) ; Infanticides (Zola Émile) (1, 2) ; (18)
VI. Violences à l’encontre des enfants. Violences. Incestueuses : Violences. Incestueuses (1, 2, 3) ; Par ordre alphabétique. Violences. Incestueuses (Beck Robert) ; Violences. Incestueuses (Dolto Françoise) ; Violences. Incestueuses (Ferré Léo) ; Violences. Incestueuses (Langage) (1, 2, 3, 4) ; Violences. Incestueuses (« Lolita ») ; Violences. Incestueuses (Mythe) (1, 2) ; Violence. Incestueuses (Négation de. Bettelheim Bruno) ; Violence. Incestueuses (Négation de. Freud Sigmund) (1, 2) ; Violences. Incestueuses (Père « attachement excessif » au père) ; Violences. Incestueuses (Saint Phalle Niki de) ; Violences. Incestueuses (Talmont Virginie) ; Violences. Incestueuses (Voltaire) ; (20)
VII. Violences à l’encontre des femmes : Violences à l’encontre des femmes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) ; Par ordre alphabétique. Violences à l’encontre des femmes (Abitbol Sarah) ; Violences à l’encontre des femmes (Adityanath Yogi) ; Violences à l’encontre des femmes (Aragon Louis) ; Violences à l’encontre des femmes (Bachelot Roselyne) ; Violences à l’encontre des femmes (Badinter Robert) ; Violences à l’encontre des femmes (Bakounine Mikhaïl-Michel) ; Violences à l’encontre des femmes (Balibar Jeanne) ; Violences à l’encontre des femmes (Balzac Honoré de) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (Baudelaire) ; Violences à l’encontre des femmes (Beck Robert) ; Violences à l’encontre des femmes (Benedetti Arnaud) ; Violences à l’encontre des femmes (Berberova Nina) ; Violences à l’encontre des femmes (Berger Aurore) ; Violences à l’encontre des femmes (« Bêtise » Une) ; Violences à l’encontre des femmes (« Bizutages ») ; Violences à l’encontre des femmes (Bonafous Louis) ; Violences à l’encontre des femmes (Borne Elisabeth) ; Violences à l’encontre des femmes (Brésil. XIXème siècle) ; Violences à l’encontre des femmes (Buckingham Duc de) ; Violences à l’encontre des femmes (Burke Edmund) ; Violences à l’encontre des femmes (Chaîne Histoire) ; Violences à l’encontre des femmes (Chateaubriand François-René de) ; Violences à l’encontre des femmes (Chazal Claire) ; Violences à l’encontre des femmes (C. News) ; Violences à l’encontre des femmes (Collomb Gérard) (1, 2) ; Violences (Cologne. 31 décembre 2015) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Colonialisme) ; Violences à l’encontre des femmes (Constant Benjamin) ; Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) ; Violences à l’encontre des femmes (Coutume) ; Violences à l’encontre des femmes (Création d’un « Observatoire ») ; Violences à l’encontre des femmes (« Crime d’honneur ») (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (« Crime passionnel ») ; Violences à l’encontre des femmes (Criminels de paix) ; Violences à l’encontre des femmes (Chahinez Daoud) ; Violences à l’encontre des femmes (Darmanin Gérald) ; Violences à l’encontre des femmes (David-Neel Alexandra) ; Violences à l’encontre des femmes (Delorme Florian) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Dépôts de plainte) ; Violences à l’encontre des femmes (Dickens Charles) ; Violences à l’encontre des femmes (Dire) (1, 2, 3, 4) ; Violences à l’encontre des femmes (Dostoïevski Fiodor) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Drucker Léa) ; Violences à l’encontre des femmes (Dumas Alexandre, fils) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Église catholique) ; Violences à l’encontre des femmes (Enquêtes) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Équivalence) ; Violences à l’encontre des femmes (« Erreur ») ; Violences à l’encontre des femmes (Expertise) ; Violences à l’encontre des femmes (« Faits divers ») ; Violences à l’encontre des femmes (« Fantasmes ») ; Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) ; Violences à l’encontre des femmes (Fielding Henry) ; Violences à l’encontre des femmes (Fontaine Brigitte) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (France Culture) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (France Inter) ; Violences à l’encontre des femmes (France insoumise. Programme 2022) ; Violences à l’encontre des femmes (Frémiot Luc) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Freud Sigmund) ; Violences à l’encontre des femmes Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Violences à l’encontre des femmes (Front national) ; Violences à l’encontre des femmes (Gainsbourg Serge) ; Violences à l’encontre des femmes (Gauche) ; Violences à l’encontre des femmes (Gifles) ; Violences à l’encontre des femmes (Godard Jean-Luc) ; Violences à l’encontre des femmes (Guerini Stanislas) ; Violences à l’encontre des femmes (Guy Gilbert) ; Violences à l’encontre des femmes (Handke Peter) ; Violences à l’encontre des femmes (Hollande François) ; Violences à l’encontre des femmes (Hugo Victor) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (Jablonka Ivan) ; Violences à l’encontre des femmes (La Fontaine Jean de) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Landru) ; Violences à l’encontre des femmes (Langage) ; Violences à l’encontre des femmes (Lebrock Annie) ; Violences à l’encontre des femmes (Leiris Michel) ; Violences à l’encontre des femmes (« Libération de la parole ») ; Violences à l’encontre des femmes (Lusset Élisabeth) ; Violences à l’encontre des femmes (Luttes sociales) ; Violences à l’encontre des femmes (Macron Emmanuel) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Mafia) ; Violences à l’encontre des femmes (Manifestations) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ; Violences à l’encontre des femmes (Martin-Fugier Anne) ; Violences à l’encontre des femmes (Marzouki Moncef) ; Violences à l’encontre des femmes (Masha Amini) ; Violences à l’encontre des femmes (Mauduit Xavier) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Message au répondeur de Là-bas si j’y suis) ; Violences à l’encontre des femmes (Mélenchon Jean-Luc) ; Violences à l’encontre des femmes (Mey louise) ; Violences à l’encontre des femmes (Meyer Daniel) ; Violences à l’encontre des femmes (Militaires français au Rwanda) ; Violences à l’encontre des femmes (Moreno Élisabeth) ; Violences à l’encontre des femmes (Mutilations sexuelles) ; Violences à l’encontre des femmes (Mukwege Denis) ; Violences à l’encontre des femmes (Nationalisme / Impérialisme) ; Violences à l’encontre des femmes (Négation / Négationnisme) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Nietzsche Friedrich) ; Violences à l’encontre des femmes (« Occultées ») ; Violences à l’encontre des femmes. Oufkir Fatéma) ; Violences à l’encontre des femmes (« On doit jamais battre une femme, même avec une fleur ») ; Violences à l’encontre des femmes (Pardon) ; Violences à l’encontre des femmes (Pasternak Boris) ; Violences à l’encontre des femmes (Paulhan Jean) ; Violences à l’encontre des femmes (Petrucciani Loana) ; Violences à l’encontre des femmes (Philippe Édouard) ; Violences à l’encontre des femmes (Picoult Jodi) ; Violences à l’encontre des femmes (Phagan Mary) ; Violences à l’encontre des femmes (Piolle Éric) ; Violences à l’encontre des femmes (Polanski Roman) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Policiers) (1) Par ordre chronologique (1) ; Violences à l’encontre des femmes (Polytechnique) ; Violences à l’encontre des femmes (Politique de lutte contre) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (Pradié Aurélien) ; Violences à l’encontre des femmes (« Pourquoi n’êtes-vous pas partie ? ») ; Violences à l’encontre des femmes (Réage Pauline) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (Radio courtoisie) ; Violences à l’encontre des femmes (Renard Jules) ; Violences à l’encontre des femmes (Renoir Jean) ; Violences à l’encontre des femmes (Richelieu maréchal de) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (Robin Muriel) ; Violences à l’encontre des femmes (Roland Marie-Jeanne) ; Violences à l’encontre des femmes (Robinson Mary) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Roudinesco Élisabeth) ; Violences à l’encontre des femmes (Rues de Paris) ; Violences à l’encontre des femmes (Sand George) (1, 2, 3) ; Violences à l’encontre des femmes (Schiappa Marlène) (1, 2, 3, 4) ; Violences à l’encontre des femmes (« Sévices fondé sur le genre ») ; Violences à l’encontre des femmes (Silence des femmes) (1, 2) ; Violences à l’encontre des femmes (Simpson O. J) ; Violences à l’encontre des femmes (Sinclair Anne) ; Violences à l’encontre des femmes (Steinem Gloria) ; Violences à l’encontre des femmes (Sylvestre Anne) ; Violences à l’encontre des femmes (Taraud Christelle) ; Violences à l’encontre des femmes (Tchékhov Anton) ; Violences à l’encontre des femmes (Thiam Awa) ; Violences à l’encontre des femmes (Tolstoï Léon) (1, 2, 3, 4) ; Violences à l’encontre des femmes (Tristan Flora) ; Violences à l’encontre des femmes (Trump Donald) ; Violences à l’encontre des femmes (Union européenne. Décembre 2023) ; Violences à l’encontre des femmes (Victorine) ; Violences à l’encontre des femmes (Voltaire) (1, 2, 3, 4) ; Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ; (271)
VIII. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage » : « Droit de cuissage » (1, 2) ; Par ordre alphabétique Anonyme (XVIIème siècle) ; Apollinaire ; Aragon (Louis) ; Assiette de porcelaine ; Aubry (Martine) ; Auguste ; Bachelot (Roselyne) ; Balzac (Honoré de) (1, 2, 3, 4) ; Belgique (1960) ; Berberova (Nina) ; Bistula (Maria) ; Broch (Hermann) ; Caserio (Sante Geronimo) ; Chaunu (Pierre) ; Charrière (Isabelle de) ; Comminges (Comte de) ; Colet (Louise) ; Debré (Robert) ; Defoe (Daniel) ; Desanti (Dominique) ; Dolto (Françoise) ; Dostoïevski (Fiodor) ; Dulong (Claude) ; Fielding (Henry) ; France (Révolution. 1789) ; Giroud (Françoise) (1, 2) ; Goncourt (Edmond de) ; Grossman (Vassili) ; Guillaumin (Émile) ; Hugo (Victor) (1, 2, 3, 4) ; Interdiction de recherche de paternité ; Istrati (Panaït) ; Janin (Jules) ; Kapuściński (Ryszard) ; Knobelspiess (Roger) ; La Châtre (Maurice) ; Lefèvre (Frédéric) ; LIP ; Louis XIV ; Luther ; Malet (Léo) : Mann (Thomas) ; Marat ; Màrai (Sàndor) (1, 2) ; Marmontel (Jean-François) ; Marx (Karl) et Engels (Friedrich) ; Michelet (1, 2) ; Mines ; Montaigne ; Mugnier (Abbé) ; Perrault (Gilles) ; Pétain (Philippe) ; Phoolan Devi ; « Prime de mariage » ; Proust (Marcel) ; Renard (Jules) ; Richardson (Samuel) (1, 2, 3) ; Ferdinando IV (roi de Naples et de Sicile) ; Rousseau (Jean-Jacques) ; Russie (1928) ; Russie (1929) ; Sartre (Jean-Paul) ; Sicile (1, 2) ; Simenon (Georges) ; Sinclair (Anne) ; Stendhal ; Styron (William) ; « Survivantes » ; Sylvestre (Anne) ; Székely János) (1, 2, 3) ; Thackeray (William Makepeace) ; Tchékhov (Anton) ; Tolstoï (Léon) (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Tulard (Jean) ; Université, CNRS ; Vaillant (Roger) ; Vassilikos (Vassilis) ; Voltaire Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ; Wikipédia ; Zinoviev (Alexandre) ; Zola (Émile) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ; (130)
IX. Violences à l’encontre des femmes. Harcèlement sexuel : Harcèlement ; Par ordre alphabétique Harcèlement sexuel (Akerman Chantal) ; Harcèlement sexuel (Anachronisme) ; Harcèlement sexuel (Appel. Levons l’omerta. 10 mai 2016) ; Harcèlement sexuel (Avocat général. 2002) ; Harcèlement sexuel (Capek Karel) ; Harcèlement sexuel (Diderot Denis) ; Harcèlement sexuel (Fonction) ; Harcèlement sexuel (Fraisse Geneviève) ; Harcèlement sexuel (Gide André) ; Harcèlement sexuel (Grahn Lucile) ; Harcèlement sexuel (Lanzmann Claude) (1, 2) ; Harcèlement sexuel (Leroy Myriam) ; Harcèlement sexuel (Lewinski (Monica) ; Harcèlement sexuel (Lois) ; Harcèlement sexuel (Macron Emmanuel) ; Harcèlement sexuel (Naipaul V. S) ; Harcèlement sexuel (Question prioritaire de constitutionnalité) ; Harcèlement sexuel (Roudy Yvette) ; Harcèlement sexuel (« de rue ») (1, 2) ; Harcèlement sexuel (Vallaud-Belkacem Najet) ; Harcèlement [sexuel] (Vergès Jacques) ; Harcèlement sexuel (Vigna Xavier) ; Harcèlement sexuel (Zola Émile) (1, 2, 3, 4, 5) ; (31)
X. Violences. Patriarcales : Violences. Patriarcales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Par ordre alphabétique Violences. Patriarcales (Ségur Comtesse de) ; Violences. Patriarcales (Tchékhov Anton) ; Violences. Patriarcales. (Pédagogie) ; Violences. Patriarcales (Résistance) (1, 2) ; Violences. Patriarcales (Weinstein Harvey) ; (14)
3 octobre 2025 : 803 items
I. Viols :
Viols :
Viols (1) : Le viol est au patriarcat - et donc au proxénétisme - ce que le fouet (et le viol) est à l’esclavage.
(Viols) (2) : Combien d’hommes se sentent-ils, intuitu personae, un tant soit peu concernés lorsqu’un viol, un crime donc, a lieu dans le monde ? Et, en regard, combien se sentent-ils concernés par une pensée (action) féministe qui s’élabore, se concrétise ? Et si ces deux questions n’en étaient qu’une seule ?
Viols (3) : Le viol est sans doute si déstructurant non pas tant parce qu’il attaque, fracture « l’intime » - si souvent, synonyme de « sexe » - mais parce qu’il attaque, qu’il fracture la séparation de l’être humain et du monde, et donc les relations entre eux.
En détruisant les frontières physiques, mentales, imaginaires nécessaires à la construction de soi dans le monde, le viol détruit l’idée même d’un être-pour-soi.
La préservation de soi, la protection de soi ayant été fracturées, la construction de soi doit être rebâtie sur d’autres fondements.
Comprendre ces violences dans leur complexité et en politiser la dénonciation en est sans doute le meilleur moyen de se reconstruire et de construire un autre monde.
Viols (4) : Évolution du langage : « Elle a subi des sévices sexuels » ; « Elle a été violée » ; « Ils l’ont violée. Le viol est un crime ». (Cf. Langage)
Viols (5) : Le déni, le contraire du viol n’est pas le « consentement », pas plus que le « non-consentement. » (Cf. Penser. Consentement, Violences à l’encontre des femmes. Consentement)
Viols (6) : Les violeurs sont-ils des malades, des pervers, des ir-responsables, de coupables, de criminels… ? La question est mal posée, car elle occulte l’essentiel : ce sont d’abord et avant tout des hommes. Ceci posé, après on peut réfléchir…
Viols (7) : Si l’obsession des hommes est, si souvent, leur virilité, le viol ne serait-il pas le moyen le plus efficace de la tester, la vérifier, en repousser la crainte, et aussi alors la démontrer ? (Poursuivre)
Viols (8) : (4 juillet) 2024. Entendu sur France Culture :
« Le viol sur » et non : « le viol de ».
- De même, réfléchir à l’expression : « viols avec violence »
Viols (9) : Combien de viols, les « filles séduites » cachent-elles. Des millions ? (Cf. Enfants. Filles, Violences à l’encontre des femmes)
Par ordre alphabétique. Viols :
Viols (ACAT. Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture) : (21 décembre) 1991. Antoine Spire, responsable de l’émission Chili. Les voix du passé. Voix du silence de France Culture, interroge André Jacques, président de l’ACAT, « de retour du Chili » :
« Vous avez vu ces jeunes hommes qui sont encore en prison, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. On dit qu’ils ont été torturés après leur arrestation et que les femmes ont été systématiquement violées. Vous pouvez en témoigner ? »
Sa réponse : « Ah oui. À peu près tous les prisonniers ont été, au Chili, victimes de violences, un court temps d’arrêt - diverses et de tortures. » (Cf. Violences. Viols. Dénis. Violences à l’encontre des femmes)
Viols (Anticommunisme) : (14 septembre) 2023. Entendu, concernant les prisons du Chili fasciste d’Augusto Pinochet [1915-2006] :
« Des jeunes filles étaient violées au nom de la répression anti-communiste. » (Cf. Politique. Anticommunisme)
Viols (Balkany Patrick) : (29 juin) 2009. Le Monde dans un article intitulé Patrick et Isabelle Balkany, Les amis du Président [Sarkozy] évoque « un scandale ridicule lorsqu'une maîtresse porta plainte, en 1997, après que Patrick Balkany l'eut obligée à lui administrer une fellation sous la menace d'un 357 Magnum 3. » 1 (Cf. Droit, Femmes, Justice. Patriarcale, Politique. Médias)
* Ajout. 14 mai 2019. Le Figaro rapporte la réaction à la Police judiciaire de son épouse Isabelle Balkany en soutien et défense de son mari - jugée « cash » par le journal - :
« Mon mari n’a jamais eu besoin d’un révolver pour se faire ‘tailler une pipe’. » 2 (Cf. Droit, Femmes. Épouse de, Justice, Politique. Médias)
Viols (Balzac Honoré de) : 1831. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Petites misères de la vie conjugale, auteur de :
« […] Ô maris ! Sachez-le, vous pouvez en ce moment tout réparer, tout raccommoder. […] Oui, vous pouvez la ramener triomphante, elle n’a plus que vous, il vous reste une chance, celle de violer votre femme. Ah ! bah ! Vous lui dites votre imbécile, niais et indifférent :
‘Qu’as-tu ?’ » 3 (Cf. Hommes. Époux, Famille. Mariage)
Viols (Banks Russel) : 2016. Russel Banks [1940-2023], dans Continents à la dérive, auteur de :
« L’homme jeta le garçon par terre, et après lui avoir baissé le pantalon d’un geste brusque, il enfonça son genou entre ses jambes, les écarta et le pénétra - une déchirure sauvage, une rupture à la fois dans son esprit et dans son corps qui fit hurler le garçon et le laissa disloqué, brûlant de rage et de honte, gardant au fond de lui une sombre étoile de douleur. Quand l’homme en eut fini avec lui, le garçon se mit à pleurer, il ramassa son propre corps avec de navrantes précautions, comme si ce n’était pas le sien, et le porta à l’endroit où Vanise était allongée avec son enfant. » 4 (Cf. Êtres humains, Corps)
Viols (Bataille Georges) : 1966. Georges Bataille [1897-1962], dans son livre intitulé : Ma mère, peut concomitamment écrire :
- « Je suis né des amours qu’il [son père, alors âgé de 35 ans] avait eu avant mariage avec ma mère qui avait 14 ans. » (p.28)
- « J’évitais à toute force de reconnaître la vérité que, plus tard, avant de mourir, m’obligea à voir ; qu’à 14 ans elle avait poursuivi mon père, et lorsque la grossesse dont je suis le fruit obligea la famille à les marier, c’est elle qui allait de débauche en débauche, le corrompant jusqu’au bout, avec la même obstination sagace qu’elle devait montrer avec moi. » (p.38)
- Sa mère : « […] J’avais 13 ans et j’étais enragée. Ton père m’a trouvée dans les bois. J’étais nue et je croyais qu’avec mon cheval, nous étions les bêtes des bois. […] Je rêvais de filles ou de faunes ; je savais qu’ils m’auraient dérangée. Ton père m’a dérangée. […]
Soudain, ma mère pleura, elle fondit en sanglots. Je la pris dans mes bras.
- Mon enfant, disait-elle, mon enfant des bois ! Embrasse-moi : tu viens du feuillage des bois, de l’humidité dont je jouissais, mais ton père, je n’en voulais pas, j’étais mauvaise. Quand il m’a trouvé nue, il m’a violée, mais j’ai mis son visage en sang ; je voulais lui arracher les yeux. Je n’ai pas pu.
- Maman, criai-je.
- Ton père m’avait épiée. Je crois qu’il m’aimait […]. » (p.62, 63) 5 (Cf. Enfants. Fruits, Femmes. Mères, Famille, Pornographie, Violences. Sade)
Viols (Bellil Samira) : 2003. Samira Bellil [1972-2004] dans Dans l’enfer des tournantes, auteure de :
« Beaucoup de filles que j’ai connues à cette époque et qui ont eu, comme moi, leur enfance saccagée par un viol et ses conséquences - réputation désastreuse, rejet et abandon de tous - ont ‘mal tourné’. Certaines sont en prison, sut le trottoir, en psychiatrie ou complètement camées. Je me demande souvent comme elles font pour survivre […]. » 6 (Cf. Femmes. Remarquables. Bellil Samira, Patriarcat)
Oui, les enfants, les filles, les femmes violées - celles qui ne sont pas suicidées et ou que l’on n’a pas assassinées, souvent à ‘petit feu’ - ont, de tous temps, rempli les prisons, les bordels, les asiles…
Sans oublier les garçons, les hommes…
Viols (Boyd William): 1988 (traduction française). William Boyd, dans Les nouvelles confessions, auteur de :
- « Mon journal. Berlin. 25 mars 1946 : ‘Bavardé avec un capitaine de l’état-major américain qui affirme que les Russes n’ont pas violé à l’excès. Ils étaient plus intéressés par le pillage dit-il. […] Il estime que le nombre de viols à Berlin est resté à peu près ‘dans la moyenne’. Il s’est toutefois montré fort amer sur la question des bas de soie : ‘Il y a plus de femmes à Berlin qui portent des bas de soie qu’il n’y en a à Paris ou à Londres. »
- « Il me conduisit quelque part dans le secteur français. Il y avait du tricolore partout. Je soupçonne que les Français prenaient autant de plaisir à occuper Belin que les Russes. » 7
Viols (Brassens Georges) : 1952. Pendant des dizaines d’années, nous avons été des millions, ravie-s, sans n’y voir aucun mal, de chanter Le gorille de Georges Brassens [1921-1981] et à trouver légitime que le viol d’un juge ait été préféré par le gorille à une « vieille décrépite ». (Cf. Femmes, Justice. Juges, Patriarcat)
Viols (Canard enchaîné Le) : (17 mars) 2021. Lu dans la chronique Cinéma du Canard enchaîné, concernant le film I need a ride to California :
« La scène finale du viol met une ombre noire au tableau, même si l’héroïne se relève et continue sa marche. »
Ouf ! j’ai eu peur…
Viols (Céline Louis-Ferdinand) : 1932. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, auteur de :
« Un corps luxueux, c’est toujours un viol possible, une effraction précieuse, directe, intime dans le vif de la richesse, du luxe, et sans reprise à craindre. » 8
Viols (Chaunu Pierre) : (8 mai) 2001. [rediffusion. 20 janvier 2025] Pierre Chaunu [1923-2001] sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) évoque « la défloration de gamines ». (Cf. Patriarcat. « Hymen », Violences. Violences à l’encontre des filles. « Droit de cuissage ». Chaunu Pierre)
Viols (Clouzot Henri-Georges) : (13 août) 2020. Henri-Georges Clouzot [1907-1977], à qui un producteur veut imposer Brigitte Bardot comme actrice, auteur de :
« Je n’aime pas tellement me laisser violer. » 9
Ce qui ne l’empêcha pas de la violenter.
Viols (C. News) : (18 décembre) 2023. Un homme sur C’News, après avoir entendu le récit de Claire faisant état, dénonçant le viol dont l’auteur est un étranger, sous OQTF [Obligation de quitter le territoire français], après avoir affirmé, de ce fait, « avoir honte d’être français » poursuit ainsi :
« Que des viols arrivent, cela fait partie de la nature humaine… »
Viols. « Consentement » :
Viols (« Consentement ») (1) : Un viol, après un « consentement » obtenu par « violence, contrainte, menace, et surprise » reste un viol. (Cf. Droit, Penser. Consentement, Violences. « Consentement ». Violences à l’encontre des femmes. Union Européenne)
* Ajout. 9 avril 2024. Entendu dans l’émission Affaires sensibles de France Inter, une journaliste effectuant un « micro-trottoir » effectué en 1976 poser cette question :
« Est-ce qu’on peut violer une femme sans son consentement » ?
Décidemment, pour certain-es, le viol et le consentement doivent être liés.
Par ordre chronologique. Viols. « Consentement » :
Viols (« Consentement ») (1) : 1985. Nicole-Claude Mathieu [1937-2014], dans Quand céder n’est pas consentir, auteure de :
« On sait que dans les procès de viol, l’argument des avocats - comme le sens final des sentences (acquittements fréquents des violeurs) - est presque toujours basé sur l’idée de consentement de la femme. […] » 10 (Cf. Droit. Patriarcal, Justice. Patriarcale, Violences à l’encontre des femmes. « Consentement »)
-------------
Viols (Correctionnalisation des) : Négation du crime, négation du droit. (Cf. Droit, Justice)
Viols (Culture) : Parler, dénoncer une culture du viol est tout à fait insuffisant. C’est d’une politique du viol dont il faut parler, qu’il faut dénoncer. Qu’il faut changer. (Cf. Culture. Patriarcale)
Par ordre chronologique. Viol. Déni :
Viols (Déni) (1) : (1er août) 1835. Alexis de Tocqueville [1805-1859], dans ses Voyages en Angleterre et en Irlande, rapporte un échange avec un juge de la cour d’assises de Galway, « un vieillard très estimé pour son expérience et son savoir ». Après que celui-ci lui ait confirmé que « les faits de violences [étaient] très nombreux dans cette partie de l’Irlande » Tocqueville l’interroge :
« J’ai vu sur les différents Calendars (liste des causes criminelles), beaucoup de rapes (viols). J’avais entendu dire que les mœurs étaient très pures. Comment ces deux choses peuvent-elles se concilier ? » La réponse du juge fut :
« Les mœurs sont en effet très pures. Presque toutes les accusations de rape sont faites par des filles qui veulent de cette manière forcer un homme de les épouser. Si le mariage a lieu, la poursuite cesse, suivant nos lois. Cette manière d’agir des filles prouve une grande grossièreté des mœurs, mais non leur impureté. » 11
À ce niveau de contradictions, je ne peux que me convaincre un peu plus que toute tentative de justification du patriarcat est tout simplement impossible. (Cf. Famille. Mariage, Justice, Patriarcat, Penser)
Viols (Déni) (2) : 1974. Jean-Paul Sartre [1905-1980], dans On a raison de se révolter, se souvient :
« J’ai un ami qui parlait dans un meeting communiste en province. Il a dit : ‘Il ne faut pas violer les foules’. Le dirigeant communiste lui a reproché à la sortie : ‘Tu n’aurais pas dû prononcer le mot de ‘violer’ : il y avait des femmes. »
L’explication que Jean-Paul Sartre en donne est que : « Les communistes sont puritains. » 12
Ainsi, pour lui, selon le langage commun, ici, qu’ici il conforte : viols = femmes = puritanisme (exit les hommes, leurs violences et le patriarcat) (Cf. Femmes. « Puritaines », Langage. Mots. Critique de : « Puritain-e », Patriarcat)
Viols (Déni) (3) : 1995. Je lis dans le Guide des films. 1895-1985. L-Z, coordonné par Jean Tulard, à la présentation du film de Roman Polanski, Tess d’Uberville [1979], que Tess « se fait engrosser par […] sir Alec. » 13 (Cf. Culture. Patriarcale. Cinéma, Hommes. Grossiers, Langage, Violences. Viols. Romans anglais. « Droit de cuissage »)
-------------
Viols (« Dominations ». France Culture) : (7 au 10 décembre) 2020. France Culture nomme les quatre émissions consacrées au viol : Violé-es. Une histoire de dominations. Au lieu et place du clair, précis, bien nommé : Les viols, expressions patriarcales de la domination masculine ?
Je note aussi, dans la présentation écrite, que si les termes de patriarcat, de domination masculine ne sont pas lisibles, les hommes - comme les femmes, comme les enfants, d’ailleurs peuvent être singulièrement absents. Je lis en effet, en exemple, le 9 décembre :
« Les minorités sexuelle et racisées et les victimes d’inceste et/ou de violences dans l’enfance, sont proportionnellement surreprésentées parmi les victimes de violences à caractère sexuel. Les écouter, c’est comprendre les rouages d’un système où le viol n’est pas affaire de sexe ou de sexualité, mais de pouvoir. »
N.B.1. Les viols, pas plus que les « violé-es », ne sont ni des « histoires », ni des « affaires » …
N.B.2. Les femmes, pas plus que les hommes, pas plus que les enfants, sont des « minorités », et « minorités sexuelles » ne veut rien dire.
N.B.3. Les victimes sous-représentées mériteraient-elles moins d’être « écoutées » ?
N.B.4. « Écouter » « les victimes », France Culture l’accepterait-il pour les juif-ves en 1933 ?
N.B.5. « Écouter » serait-ce synonyme de « comprendre » ?
N.B.6. Et « comprendre » dès lors qu’il s’agirait de « pouvoir » n’est-ce pas aussi le justifier ? En tout cas, pas de condamner, de lutter contre.
Lamentable. Honteux. (Cf. Femmes. Victimes, Féminismes, Langage. Critique de mots. « Racisé-es », Patriarcat. Domination masculine, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Sade. Prix, Violences. Incestueuses)
* Ajout. 10 octobre 2022. À la rediffusion de cette série par France Culture du 10 au 16 octobre 2022, je n’ai pas vérifié l’évolution de la structure même des émissions, mais, sous réserve de vérification, l’émission entendue le 10 octobre, aurait-elle été ajoutée ? Quoi qu’il en soit, son titre : « Poser ses mots », comme sa présentation : « Les victimes cherchent à formuler le trauma » sont absolument inappropriés : les critiques de la police, de la justice, des psys, de la gratuité, de la politique d’isolement des femmes violées, de la nécessaire solidarité des femmes entre elles, des structures politiques sans liens avec le vécu des femmes, la relégitimation de la colère, tout ceci qui avait été abordé, y est nié.
Viols (Drouelle Patrice) : (17 mars) 2022. Patrice Drouelle, dans l’émission Affaires sensibles de France Inter, intitulée : La torture pendant la guerre d’Algérie, a réussi le tour de force d’exprimer trois expressions honteuses : « être né d’un viol » ; « son viol », auxquels on peut ajouter, en matière de déni : « l’usage de la torture ». 14 (Cf. Langage. Possessif, Politique. Guerre. Algérie)
Viols (Femmes) : (10 octobre) 2022. Une femme violée, auteure de :
« On est trop nombreuses ». 15 (Cf. Femmes, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Viols (Impuissance des femmes) : Devant l’impuissance des femmes si souvent tétanisées, confrontées aux hommes qui les violent, les battent, les agressent, il y a l’ancestrale permanence de la logique sacrificielle toute patriarcale dont aucune femme ne peut se considérer comme indemne. (Cf. Femmes, Hommes, Patriarcat, Histoire, « Sciences » sociales. Psychanalyse. « Inconscient collectif », Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Viols (Fan) : 2016. Lu : « Inculpé de viol, il a remercié ses fans de leur soutien » … 16
Viols (Flagg Fannie) : 1987. Fannie Flagg, dans Beignets de tomates vertes, auteure de :
« Elle était montée dans la chambre nuptiale, décidée à être une bonne et aimante épouse, et c’est pourquoi cela avait été un tel choc pour elle quand Franck l’avait prise avec violence, comme s’il avait voulu la punir d’être une femme. Sitôt qu’il eut joui, il s’était retiré dans sa propre chambre, la laissant dolente et en sang. Il n’était jamais revenu dans son lit que tenaillé par ses désirs, et neuf fois sur dix, pour l’unique raison qu’il était trop saoûl ou trop fatigué pour se rendre au bordel dont il était un client assidu. » 17 (Cf. Êtres humains. Désirs, Patriarcat. Flagg Fannie, Proxénétisme. « Clients »)
Par ordre chronologique. Viols. Gustave Flaubert :
Viols (Flaubert Gustave) (1) : (8 juillet) 1861. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Edmond [1822-1896] et Jules de Goncourt [1830-1870] :
« (Il y avait à l’hospice général de Rouen [où il avait vécu] un idiot que l’on appelait Mirabeau, et qui, pour un café, enfilait les femmes mortes sur la table d’amphithéâtre. Je suis fâché que vous n’ayez pas pu introduire ce petit épisode dans votre livre. - Il aurait plus aux dames. Il est vrai que Mirabeau était faible et ne méritait pas tant d’honneur. Un jour, il a calé bassement devant une femme guillotinée.) » 18 (Cf. Corps. Cadavres, Sexes […], Violences. Sade. Flaubert Gustave)
Viols (Flaubert Gustave) (2) : (19 octobre) 1875. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Edmond Laporte [1832-1906] :
« Détail de mœurs : un citoyen vient d’être condamné par la cour de Quimper pour avoir violé ses trois filles et son fils âge de seize ans. Quel tempérament, hein ! Ce n’est pas nous qui ferions ça ! Du moins, pas moi ! »
- Même formulation dans une lettre écrite le 21 octobre 1875 à Ivan Tourgueniev [1818-1883], sauf le début :
« Il y a pourtant des choses qui consolent. » Et la fin :
« Ce n’est pas nous qui sommes capables de ces traits de santé. » 19 (Cf. Hommes. Impuissants. Solidaires, Proxénétisme. Bordels, Sexes. Hommes. Flaubert Gustave)
Viols (Flaubert Gustave) (3) : (9 janvier) 1879. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à sa nièce Caroline [1846-1931] :
« Comme anecdote locale, il y a eu à Beaupaume deux tentatives de viol, pendant la nuit de Noël. Les détails sont farces. Ça m’a réjoui naturellement. » 20
Les éternelles attaques de Gustave Flaubert contre les « bourgeois », « la bêtise », « le parti de l’ordre » … prennent soudainement une autre couleur.
-------------
Viols (Galey Matthieu) : (28 février) 1973. Lu dans le Journal de Matthieu Galey [1934-1986] :
« […] La révolution reste à faire. […] Quelle jeune fille, au fond, ne rêve pas d’être violée par un beau prolétaire ? Ruinée, la bourgeoisie se serait déchargée de sa mauvaise conscience. Libre enfin. Femme, après avoir été si longtemps une jeune fille aux genoux serrés. Peut-on imaginer qu’elle se donne seule, qu’elle s’offre ? Il faudra qu’on la force, pas tout à fait malgré elle. Ce serait plus gai que de se rancir parmi ses bribes de richesses. Chaque jour amenuisée. Après un certain degré de décrépitude, on ne vous viole même plus. On n’en a plus envie. Et c’est triste de ne plus être désirée. » 21 (Cf. Relations entre êtres humains. Désir, Femmes. Jeunes filles. Bourgeoises, Hommes, Patriarcat, Économie. Capitalisme)
Viols (Gandhi) : 1981. Lu, dans Tous les hommes sont frères, recueil de textes de Gandhi [1849-30 janvier 1948] :
- « Si on menaçait de violer ma fille… et qu’il n’y eu aucun moyen de la sauver, j’agirais selon les exigences les plus pures de l’ashima si je mettais fin à sa vie, quitte à m’exposer ensuite à la colère du forcené. »
- « Supposez que je sois un noir et que ma sœur soit violée par un blanc ou lynchée par tout un groupe, que serait mon devoir ? Tout d’abord je ne dois ni souhaiter de mal à ces gens hostiles, ni bien sûr collaborer avec eux. Il se peut que je dépende matériellement de la communauté qui est responsable du lynchage ; je dois alors refuser de coopérer plus longtemps avec eux, au point de refuser la nourriture qui viendrait de cette communauté. Je dois même cesser de m’associer avec ceux de mes frères de couleur qui n’ont pas régi. Au besoin, il ne faut pas hésiter à s’immoler soi-même. […] »
- « Quand une femme est victime d’une agression, il lui est possible de continuer à penser en termes de himsa ou d’ashima. Son premier devoir est de se protéger. Elle est libre de recourir à toute méthode ou moyen qui lui vient à l’esprit pour défendre son honneur. Dieu lui a donné des ongles et des dents. Elle doit en user des toutes ses forces et, au besoin, y perdre la vie. […] » 22 (Cf. Corps, Femmes. Comment meurent les femmes. Justice. Gandhi, Patriarcat. Pères, Politique. Non-violence)
N.B. « Ashima » : « Non-violence. D’un point de vue positif, c’est la force de l’amour ». Himsa : violence »
Viols (Goretti Marietta) : 1992. Lu dans un Dictionnaire de Femmes célèbres : Marietta Goretti [1890-1902] « Sainte. Italienne » :
« Jeune paysanne illettrée, élevée dans une famille très pauvre, sa mère lui enseigna le catéchisme et les vertus de la chasteté. Elle n’avait que 12 ans lorsqu’un jeune homme du nom d’Alexandre Serenelli [Alessandro. 1882-1970] tenta de la séduire et la menaça de mort si elle lui résistait. Elle se défendit par ces seuls mots : ‘Dieu ne permet pas cela’. Le jeune homme la frappa lors de quatorze coups de couteau. Elle ne succomba que le lendemain, non sans promettre à son bourreau de prier au ciel pour lui. Alexandre Serenelli se convertit, et après 26 ans de pénitencier, vint implorer le pardon de la mère de Marietta. Il lui fut accordé, ‘puisque la jeune fille l’avait déjà pardonné’. Il assista à la cérémonie de béatification présidée par le pape Pie XII, le 27 avril 1947. Marietta Goretti fut canonisée en 1950. On la fête le 6 juillet. » 23 (Cf. Relations entre êtres humains. Pardon, Justice, Langage. Mots, Patriarcat, Politique. Catholicisme, Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Par ordre chronologique. Viols. Guerre. Algérie :
Viols (Guerre. Algérie) (1) : (4 mars) 1957. Mouloud Feraoun [1913-1962] écrit dans son Journal :
« […] [Après avoir évoqué Guel [?-?] « désemparé »] Aujourd’hui sa femme lui a dit qu’au cours du dernier ratissage, il y a quatre jours, les soldats [Français] ne se sont pas gênés pour caresser les filles. La nuit, quand ils viennent inspecter les maisons de ceux qui ont fui le village pour dormir dans les champs, ils ne trouvent pas les suspects, bien sûr, mais ils trouvent leurs épouses et leurs sœurs. Et parfois on entend les femmes crier. Le capitaine veut absolument que le village se rallie. Il a dû constater que la meilleure méthode pour cela est de faire violer les femmes par les soldats. Cette méthode a déjà réussi aux Ouadhias. On s’attend à ce qu’elle soit appliquée chez nous. Auparavant, si c’est possible, Guel voudrait ramener sa femme ici pour la mettre à l’abri. On ne peut que l’approuver et plaindre toutes celles qui ne pourront fuir…ou du moins leurs maris ! » Et Mouloud Faraoun, après cette dernière terrible réflexion, poursuit :
« - Voilà lui ai-je dit, une façon infaillible d’émanciper les femmes. Ce coup-ci, elles comprendront ce qu’il en coûte de se révolter et de prétendre d’un clin d’œil chasser les Français d’Algérie. » Pour enfin terminer ainsi :
« On peut se demander aussi pourquoi les maquisards choisissent ce moment pour s’éloigner de notre village et aller ailleurs exiger des autres villages où ils passent gigots de mouton et tapis de laine. Je ne prétends pas certes qu’il faille empêcher les ratissages et arrêter les blindés mais ces petites patrouilles qui vont la nuit faire leurs visites pas trop indiscrètes et déshonorantes, pourquoi ne rencontreraient-elles pas une autre patrouille de 'patriotes aguerris' qui s’expliqueraient avec elles [Les femmes, donc]. La même idée est venue à Guel et trotte dans la tête des gens de chez nous qui en ont vraiment assez. »
Chaque mot, chaque prise de position, interrogation, analyse est à décrypter. 24
N.B. « Ratissage » : « Nettoyer avec un râteau. Synonyme : racler, râteler. Familier. Ruiner quelqu'un. Synonyme : dépouiller, escroquer, étrangler, exploiter, filouter, ruiner. » (Cf. Hommes. Solidarité entre hommes, Langage. Euphémisme. Verbe. Faire, Patriarcat, Politique. Guerre. Algérie, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Viols (Guerre. Algérie) (2) : 1960. Jacques Vergès, Michel Zavrian, Maurice Courrégé, dans Le droit et la colère, auteurs de :
« Nous avons eu l’affreux privilège d’approcher, sortant des centres de torture, des hommes dont le corps portait les marques indélébiles de leurs souffrances, des jeunes filles, que la soldatesque avait à loisir humiliées, tout le temps qu’elles leur étaient livrées ‘légalement’, sous le couvert de l’assignation à résidence. » 25 (Cf. Droit, Justice, Langage, Patriarcat, Politique. Colonialisme. Guerre. Algérie, Histoire, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Viols (Guilloux Louis) : 1935. Louis Guilloux [1899-1980], dans Le sang noir, auteur de :
« Dans une honorable famille, à la campagne, tout près d’ici, il y avait une fillette de treize ans. Un vagabond viole la fillette. Qu’arrive-t-il ? Le père n’ose plus regarder sa fille. La mère a beau le sermonner, il devient méchant pour sa petite. Plus il souffre, plus il est méchant. La petite devient sombre. Elle ne joue plus. Des gamins courent après elle, rient, veulent ‘savoir’. Elle s’est jetée dans un étang. Voilà. L’histoire est finie. » 26 (Cf. Enfants, Patriarcat. Pères, Violences à l’encontre d’enfants)
Viols (Guyotat Pierre) : (17 novembre) 2024. Entendu sur France Culture, dans l’émission Pierre Guyotat (1940-2020) sculpteur de langue [!] que Pierre Guyotat a été « violé à sept ans, dans une salle de classe, par plusieurs jeunes, plus âgés que lui, dont des jeunes d’origine maghrébine ». J’entends aussi : « viols complet » [!].
J’entends enfin que « son père qui a découvert le viol a réglée le lendemain l’affaire avec les parents. » (Cf. Justice, Famille, Langage. Critique de mots : « Affaire », Patriarcat. Pères)
Viols (Hegel Friedrich) : 1820. Friedrich Hegel [1770-1831], dans Principes de la philosophie du droit, dans un paragraphe intitulé Violence et crime, auteur de :
« Seul peut être contraint à quelque chose qui veut se laisser contraindre. »
Cet argument - à lier avec le Volenti non fit injuria - a servi au droit de justification du viol. 27 (Cf. Droit. Patriarcal, Politique. Céder. Hegel Friedrich)
Viols (« Hélas ») : 1997. Edgar Morin, dans Le Monde, auteur de :
« Au cours de ce processus [de la guerre dans l’ex-Yougoslavie], il n’y a pas eu que les bombardements massifs, les exactions multiples, les atrocités, les massacres, les viols qui surviennent, hélas, de part et d’autre dans tous les conflits où la guerre est à la fois ethnique, civile, religieuse […]. » 28
Viols (Honte) : La honte [des victimes], ça suffit ! (Cf. Êtres humains. Culpabilité)
* Ajout. 15 mai 2024. Titre de première page du Canard enchaîné, à l’occasion de l’ouverture du festival de Cannes :
« #Me Too Cinéma à Cannes : le message des victimes aux accusés : ‘Vous navets pas honte ? »
* Ajout. 27 janvier 2025. 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« La honte […] une punition méritée. » 29
Viols (Hymen) : (16 septembre) 2015. Un chirurgien brésilien, élève de Ivo Pitanguy [1923-2016] nommé « le père de la chirurgie esthétique », en réponse à une question sur « la chirurgie de l’hymen », auteur de :
« C’est une intervention qu’on demande souvent à des chirurgiens dans les cas de viol. Alors c’est l’État qui règle la facture. Comme une compensation financière. » 30
Est-ce véridique ? Et une « compensation », pour qui ? de quoi ? (Cf. Corps, Patriarcat. Hymen, Politique. État)
Viols (Incidents) : (13 avril) 2025. Lu sur Franceinfo : « La Foire au Jambon de Bayonne a mal tourné. Sept personnes ont été placées en garde à vue, dont un pour viol, relève France 3 Nouvelle-Aquitaine, à l'issue de divers incidents qui se sont déroulés pendant l'évènement ce week-end. » (Cf. Langage. Sujet. Verbe. Avoir)
Viols (Julie) : 2013. Lu dans Clémentine Autain, Elles se manifestent. Viol, 100 femmes témoignent. Julie. 32 ans :
« Le viol est comme une pierre tombant dans un lac calme ; il y a le bouleversement initial, mais surtout les cercles de perturbation consécutifs à l’entrée de la pierre dans l’eau, et tout l’environnement qui est affecté. En apparence, le calme perdure, mais des lames de fond ébranlent durablement les fondements de votre personnalité. […] » 31
Viols (Kafka Franz) : (4 janvier-8 avril) 1912. Franz Kafka [1883-1924], dans le Cinquième cahier de son Journal, auteur de :
« Il séduisit une jeune fille dans un petit village des montagnes de l’Iser où il séjournait un été pour rétablir ses poumons abîmés. De façon incompréhensible, comme il arrive parfois à des malades du poumons, il jeta la fille de son hôte qui le soir après le travail faisait volontiers une promenade avec lui, il la jeta dans l’herbe au bord du fleuve après une courte tentative de persuasion et la prit, alors qu’elle gisait paralysée d’effroi. Plus tard il dut aller chercher de l’eau dans le fleuve en la puissant dans la paume de sa main et il la versa sur le visage de la jeune fille pout la ramener à vie. ‘Ma petite Julie, ma petite Julie’ disait-il, penché sur elle, un nombre incalculable de fois. Il était prêt à assumer toute la responsabilité de son crime et s’efforçait seulement de déterminer à quel point sa situation était grave. S’il n’avait pas réfléchi, il ne s’en serait pas rendu compte. La jeune fille simple étendue devant lui, qui, respirait à nouveau régulièrement et ne gardait les yeux fermés que par peur et embarras, ne pouvait pas l’inquiéter ; d’un coup de pied, l’être grand et fort pouvait pousser la fille de côté. Elle était faible et insignifiante, ce qui lui était arrivé pouvait-il avoir une importance ne serait-ce que jusqu’au lendemain ? Toute personne comparant l’un et l’autre ne devait-il pas en arriver à la même conclusion ? […] »
Terrible…
« Rien. Rien. Voilà comment je me fabrique des fantômes. Je n’ai été impliqué encore que faiblement, que lors du passage ‘plus tard, il dut…’ et surtout par l’eau qu’il ‘versa’. » […]
N.B. Alors que le note de La Pléiade précise que Franz Kafka - lui-même « poitrinaire » - « devait se rendre souvent [dans cette région] en mission professionnelle - ce qu’il fit notamment en février 1911 », l’hypothèse qu’il puisse lui-même être l’auteur de ce viol, de ce « crime » n’est pas abordée.
La référence à « l’être grand et fort » ne pourrait-il avoir joué un rôle de cache ? 32 (Cf. Hommes. Irresponsable, Langage. Verbe. Prendre)
Viols (Kolyma [Goulag]) : 1938-1939. Ekaterina Olitskaïa, dans Le sablier, auteure de :
« Auparavant, on n’envoyait à la Kolyma que des hommes, puis on vit apparaître des femmes, mais la proportion des femmes était infime. La femme était très recherchée. Pour posséder une femme, les hommes étaient prêts à commettre n’importe quel délit, n’importe quelle infraction. Ils enlevaient les femmes, les violaient, puis les abandonnaient, mutilées. Plusieurs fois, on avait enlevé des femmes d’un convoi et on les avait envoyés sur les gisements. Là-bas, on les avait jetées en pâture à toute une bande d’hommes qui attendaient leur tour. Pour une raison que j’ignore, ce viol collectif des femmes reçut l’appellation de ‘tramway’.
[…] Un mois, plus tard, je fis la connaissance de plus près avec Ania. Nous travaillons dans la même brigade. En 1938, condamnés selon l’article 58 [personnes soupçonnées d’activité ‘contre-révolutionnaire’], elle avait été envoyée à la Kolyma. Les droits communs l’avaient jouée aux cartes. Celui qui gagnerait devait la prendre, puis la livrer à ses camarades. Pendant le travail, on avait attiré Ania dans un coin isolé et là, douze hommes avaient abusé d’elle. Le soir, lorsqu’on avait regroupé la brigade des déportées, pour les ramener dans la zone, pas d’Ania. On l’avait cherchée et on l’avait retrouvée les vêtements complètement déchirés et à moitié morte. À l’infirmerie du camp, elle s’était rétablie à la surprise générale. Plusieurs fois elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Chaque fois, elle fit sauvée. Tout le monde connaissait l’histoire d’Anna. On disait qu’elle avait changé du tout au tout. Quand je fis sa connaissance, elle était redevenue calme, froide, hostile à tout le monde, méprisant et les hommes et les femmes. […] » 33 (Cf. Femmes. Échange des femmes. Comment meurent les femmes, Proxénétisme. Kolyma [Goulag])
Viols (Lahaie Brigitte) : (10 janvier) 2018. Brigitte Lahaie déclara :
« On peut jouir d’un viol ».
- Le 12 janvier 2018, elle déclara en pleurs :
« Je regrette que ça a été mal compris et surtout sorti de son contexte. C'est malheureusement une vérité. J'aurais peut-être dû ajouter ce 'malheureusement', en disant 'malheureusement’, on peut jouir pendant un viol ce qui rend la reconstruction encore plus difficile. Ce que je voulais dire - parce que je connais par cœur (sic) ces questions de sexualité - c'est que parfois, oui, le corps et l'esprit ne coïncident pas. C'est quand le corps et l'esprit ne coïncident pas que ça crée encore plus de difficultés. » 34
- En l’écoutant, j’ai d’abord pensé aux médias - aujourd’hui silencieux - qui, pendant des dizaines d’années, lui ont conféré et laissé la responsabilité de l’ « éducation sexuelle » des français-es. (Cf. Corps, Femmes. Pleurs, Politique. Médias, Pornographie, Sexes […])
* Ajout. 24 juillet 2022. Brigitte Lahaie est toujours chroniqueuse sur Sud-radio.
Viols. Langage :
Viols (Langage) (1) : Le viol : Encore ? toujours ? de plus en plus ? présenté, analysé comme un « fait », un « acte », un « cas », un « agissement », une « affaire », un « dérapage », un « débordement », un « accident », un « passage à l’acte » - dont on décrit le « mode opératoire » - un « drame » ... Autant de termes qui nient la violence et donc les viols. Analyse aussi valable pour les autres crimes, de toutes sortes. 35 (Cf. Langage)
Viols (Langage) (2) : « On pille, on tue, on viole » : l’atteinte à la propriété est assimilée à l’assassinat, lesquels subsument et/ou sont subsumés dans le viol, lequel est, en sus, dissocié de l’assassinat. (Cf. Langage)
Viols (Langage) (3) : 2005. Un livre paraît intitulé : Le scandale des ‘tournantes’. Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique’. Ce qui est, pour moi, scandale c’est l’emploi du terme de « tournante », qui, dès lors qu’il est sanctionné par la ‘sociologie’ est légitimé et promis - ce qu’il fut - à un brillant avenir. (Cf. Langage. Mots. Critique de : « Scandale », « Sciences » sociales. Sociologie, Violences)
* Ajout. 11 septembre 2016. Lu, à l’occasion du procès de 2015 dit du Carlton :
« Elle a raconté comment une partie fine organisée dans un restaurant de Lambersart avait pris des allures de tournante. » 36 (Cf. Justice, Langage, Proxénétisme, Violences)
* Ajout. 3 avril 2017. Lu :
« Aujourd’hui, et jusqu’à demain soir, se déroulera le procès de plusieurs jeunes, accusés d’avoir violé ‘en tournante’ une jeune fille de 16 ans. » 37 (Cf. Justice, Violences)
Par ordre chronologique. Viol. Langage :
Viols (Langage (1) : (18 décembre) 1776. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au marquis de Thibouville [1710-1784], concernant l’héroïne de sa dernière pièce de théâtre, Irène, écrit :
« C’est une femme amoureuse à la fureur du meurtrier de son mari, et qui finit par se tuer au lieu de se laisser violer par son cher amant. » 38
- Je lis, dans une lettre au comte d’Argental [1700-1788] en date du 15 décembre 1776, une autre présentation :
« J’ai bien peur qu’on ne se moque d’une femme qui se tue de peur de coucher avec le vainqueur et le meurtrier de son mari, quand elle n’aime pas son mari et adore ce meurtrier. Cela ressemble aux vierges chrétiennes de la Légende dorée qui se coupaient la langue avec leurs dents, et la jetaient aux nez des païens pour ne pas être violées par eux. » (Cf. Corps, Langage)
Viols (Langage) (2) : 1970. Madeleine Jacob [1896-1985] alors chroniqueuse judicaire à L’Humanité et à l’Humanité Dimanche fait état de l’enlèvement et du viol d’une jeune fille de 17 ans « mongolienne par deux « pères de famille » de 20 et 30 ans. Elle écrit :
« Ils la firent monter dans leur voiture, une fourgonnette, et là… Oui… Vous avez compris. Ils l’emmenèrent à leur hôtel… Et puis, à 120 kilomètres de Paris. Et cela, pendant 10 jours… C’était en août. Ils la maintinrent de force sous une tente. Et ils continuèrent ce qu’ils avaient commencé. » 39
Pour la fin du procès - dont le mot viol étant est ici absent, récusé - dont leurs auteurs ont comparu libres, ils furent condamnés par un tribunal correctionnel, au sein duquel ils « devisaient très souriants et très détendus » à des peines de prison avec sursis. (Cf. Femmes. Silence, Justice. Procès, Langage, Viol. Déni patriarcal)
Viols (Langage) (3) : (26 octobre) 2014. Même déni, ou plutôt, même difficulté à nommer le viol, entendu ce jour, une jeune femme africaine évoquant le viol commis par l’homme qui l’avait violée :
« Il a fait ce qu’il avait à faire. » 40 (Cf. Langage. Verbe. Faire)
Viols (Langage) (4) : (20 novembre) 2017. Entendu, dans le cadre d’une émission consacrée à la « justice restaurative », présentée comme à même d’instaurer un ‘dialogue’ entre condamnés et victimes, une femme qui avait été violée, se présentant en ces termes :
« J’ai eu mon histoire… » 41 (Cf. Dialogues, Justice. « Restaurative […] », Langage. Verbe. Avoir)
Viols (Langage) (5) : (2 septembre) 2015. Entendu sur France Culture :
« Un abus de faiblesse… un viol ». 42 (Cf. Politique. Abus)
Viols (Langage) (6) : 2018. Entendu sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) concernant une femme violée, évoquer, en lieu et place : « une féminité bafouée. » (Cf. Femmes. « Féminin ») (Poursuivre : riche d’analyses)
-------------
Viols (Macron Emmanuel) : (21 octobre) 2020. Emmanuel Macron après l’assassinat de Samuel Patty, concernant les Islamistes, auteur de :
« L’ennemi est clairement identifié. Il veut notre mort. Nous allons donc livrer un combat à mort… La république est bonne fille, mais elle ne se laissera pas violer. […] »
Emmanuel Macron a urgemment besoin d’une radicale formation féministe. 43 (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Langage)
Viols (Maternité) : (29 juillet) 2016. Une maternité ouvre à Londres « pour les femmes victimes de viol », « la première au monde », « en partenariat avec l'organisation My body back, spécialisée dans l'aide aux femmes victimes d'abus sexuels. » 44
À la lecture, étrange sentiment… (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Viols (Marzouki Moncef) : 2013. Moncef Marzouki, dans L’invention d’une démocratie. Les leçons de l’expérience tunisienne, alors président de la République tunisienne, auteur de :
« Le viol est avec la torture, le crime le plus odieux qui soit. […] » 45
Viols (Maupassant Guy de) : 1883. Guy de Maupassant [1850-1893], dans Une vie, auteur de :
« […] Il la saisit à bras-le-corps, rageusement, comme affamé d'elle ; et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous, toute sa face et le haut de sa gorge, l'étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce qu'elle faisait, ce qu'il faisait, dans un trouble de pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aigue la déchira soudain ; et elle se mit à gémir, tordue dans ses bras, pendant qu'il la possédait violemment. Que se passa-t-il ensuite ? Elle n'en eut guère le souvenir, car elle avait perdu la tête ; il lui sembla seulement qu'il lui jetait sur les lèvres une grêle de petits baisers reconnaissants. Puis il dut lui parler et elle dut lui répondre. Puis il fit d'autres tentatives qu'elle repoussa avec épouvante ; et comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu'elle avait déjà senti sur sa jambe, et elle se recula de saisissement. Las enfin de la solliciter sans succès, il demeura immobile sur le dos. Alors elle songea ; elle se dit, désespérée jusqu'au fond de son âme, dans la désillusion d'une ivresse rêvée si différente, d'une chère attente détruite, d'une félicitée crevée : ‘Voilà donc ce qu'il appelle être sa femme ; c'est cela ! c'est cela !‘ » 46 (Cf. Corps. Femmes, Famille. Mariage, Patriarcat, Sexes […])
Viols (Métis) : De combien de viols, de par le monde, les métis sont-ils les enfants ? (Êtres humains, Enfants, Politique. Colonialisme, Histoire)
Viols (Michelet Jules) : 1833. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la Révolution française, auteur de :
« […] Les nations n’ont-elles pas aussi leur inviolabilité ? La France n’est-elle donc pas aussi une personne, et une personne vivante, une vie sacrée à garantir par les pénalités du droit. Ou bien, serait-ce une chose envers qui tout est permis ?
Tuer un homme, c’est un crime. Mais qu’est-ce que tuer une nation ? Comment qualifier ce forfait ? - Eh bien ; il y a quelque chose de plus fort que la tuer, c’est de l’avilir, la livrer à l’outrage de l’étranger, c’est de la faire violer et de lui ôter l’honneur.
Il y a, pour une nation, comme il y a pour une femme, une chose qu’elle doit défendre, ou plutôt mourir. » 47 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes, Politique. Frontières. Nationalisme, Patriarcat, Histoire)
Viols (Morali-Daninos André) : 1982. André Morali-Daninos [1909-1986], dans Sociologie des relations sexuelles, auteur de :
« Dans l’étreinte la plus sommaire, il existe un embryon de tendresse. » 48
Viols (Mo Yan) : 1995-2001. Mo Yan, dans Beaux seins, belles fesses, auteur de :
- « Les membres de la troupe violèrent ma mère, l’un après l’autre. […] Une fois satisfaits, les hommes nous jetèrent, ma mère, ma sœur et moi dans la grande rue. »
- « Le jour sacré de mon baptême, ma mère avait été violée. Tous ceux-ci étaient des soldats en uniforme vert engendrés par la troupe aux carabines, ils étaient mes ennemis. À présent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut vous châtier, amen. » 49 (Cf. Politique. Guerre. Femmes)
Viols (Naouri Aldo) : 2013. Aldo Naouri, « pédiatre et spécialiste des relations intrafamiliales » [Wikipédia. août 2017] », auteur de :
« Mais violez-la, Monsieur ! »
- Il s’agissait d’une injonction adressée à un mari concernant son épouse, laquelle, à l’écoute de ce ‘conseil’ donné à son mari, avait, selon lui, « un sourire jusqu’aux oreilles ».
- Il ne s’agit pas, tel que je l’ai lu dans un article, d’une « apologie du viol conjugal », mais d’une légitimation du viol. (Cf. Langage. Adjectif)
- Explication du contexte par Aldo Naouri (critique du comportement du mari insuffisamment exigeant, selon lui) :
« Il attendait qu’elle veuille bien. Elle [ne] lui demandait rien, donc il [n’] y va pas ». [!]. Et il poursuit, je n’ose dire, analyse :
« … C’est à dire quelque chose qui véritablement remet en place la différence des sexes, avec leur fonctionnement qui est totalement différent. Le fait qu’il y ait éventuellement du désir ou pas du désir, est toujours problématique... ».
N’est-ce pas, plus justement, le « désir » de l’épouse, qui, pour lui, serait « problématique » ? Non, car le désir n’a rien à voir avec un viol.
- Cette histoire vraie était racontée par lui - qui en était « tout à fait tranquille » - après avoir justifié qu’il fallait « apprendre à l’enfant à réprimer ses pulsions ». 50
Et c’est ce même homme qui a été considéré par les médias pendant des années, comme un « expert » des enfants et de la famille. (Cf. Êtres humains, Enfants)
* Ajout. 17 mai 2016. À son nom, je lis sur Wikipédia :
« D'autres de ses propos sur le viol parus dans un ouvrage en 1998 ont aussi suscité polémique et l'ont ‘totalement disqualifié’ pour Janine Mossuz-Lavau qui a décidé de ne plus le citer lors de ses dîners en ville. » [Phrase supprimée en août 2017]. (Cf. Penser. Polémique, Proxénétisme. Mossuz-Lavau Janine)
Viols (Négation) : (mars) 2024. Je lis, dans Le Monde Diplomatique, que Loïc Wacquant, dans un texte intitulé : « Au temps où la démocratie américaine organisait le terrorisme racial » emploie, concernant l’esclavage et le post-esclavage aux États-Unis, les termes de « mixité sexuelle généralisée », de « parents racialement mixtes », considérant comme « parents » à équivalence hommes violeurs et femmes violées.
Il s’agit là d’une négation de la réalité de l’esclavage, d’une négation des viols institutionnalisés, des viols de facto légitimés par l’esclavage, d’une négation des viols imposés aux femmes esclaves noires américaines, d’une négation de leurs souffrances, d’une négation de leurs enfants qui ne leur appartenait pas, qui qu’elle que soit le couleur de leur peau, non seulement demeuraient esclaves et mais participaient par l’offre d’une main d’oeuvre renouvelée à la reproduction de l’esclavage.
Il s’agit donc alors, faute de mots appropriés, d’une permanence de ces violences dans la société américaine jusqu’à nos jours, tous ces rapports de violences, de dominations, occultés, niés, étant dès lors, considérés comme pouvant se prolonger.
À ne voir que la couleur de la peau, à exclure toute approche féministe, anti-patriarcale, c’est l’esclavage - que Loïc Wacquant, sans rigueur, assimile à « la servitude » - qui ne peut être analysé.
N.B. Ce texte est issu de son Livre : Jim Crow. Le terrorisme de caste en Amérique, à paraître en avril 2024 aux Éditions Raisons d’agir] (Cf. Politique. « Terrorisme »)
Viols (« Orgie ») : (25 mai) 1926. Samuel Schwartzbard [1886-1938] assassina à Paris Simon Petlioura [1879-1926], ancien chef des armées de la ‘République populaire d’Ukraine’, qu’il jugeait responsable d’avoir organisé les pogromes et les massacres de la population juive en 1918-1920.
Lors du procès qui eut lieu en 1927, plusieurs personnes furent appelées à témoigner par l’avocat de Schwartzbard, Henry Torrès [1891-1966]. Parmi eux, M. Goldstein, président de la « Commission d’enquête sur les pogromes d’Ukraine », qui déclara notamment :
« [À Ovrourtch], on fit venir « les rabbins, les vieillards à barbe blanche, les religieux […] On leur rase la barbe. Puis on les fait danser et chanter leurs chants religieux. Après quoi commence l’orgie. Pour l’orgie, sont amenées les femmes et les filles de ces Juifs, leurs sœurs ; tout est possible : on viole ces femmes et ces jeunes filles sous les yeux de leurs maris, de leurs pères, de leurs frères. Et le matin, quand l’orgie est finie, on tue ces malheureuses, pas une ne reste vivante. » 51 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Langage, Histoire)
Viols (« Pudeur ») : (9 novembre) 1900. Émile Zola [1840-1902] écrit à Ernest Vizetelly (1853-1922] concernant la traduction de Travail :
« Travail n’effarouchera pas la pudeur anglaise. C’est tout au plus si, dans une unique scène, un peu vive, vous aurez à éteindre les couleurs du tableau. » Et, en note, je lis :
« Zola fait allusion sans doute à la scène au cours de laquelle Fernande est violée par Ragu. » 52 Les termes de pudeur, d’attentats à la pudeur, prennent alors une toute autre signification. (Cf. Femmes. Pudeur)
Viols (Proust Marcel) : 1992. Je lis dans la Préface d’Antoine Compagnon à Sodome et Gomorrhe [1821] de Marcel Proust [1871-1922] :
- « […] Dans une lettre à Raoul Versini [1870-1939] autre condisciple au lycée Condorcet, Proust raconte une aventure homosexuelle : ‘D’ailleurs si dans un moment de surprise et de folie, supplié par ce garçon je me suis rendu, quand j’ai cru qu’il était temps encore j’ai eu des remords, je les lui ai dits, je l'ai prié. Mais il était plus fort que moi et je n'ai pu l'arrêter ». Suivi de :
- « Son père, qui sut l’incident, le soir même n’a considéré [sa] faute que comme une ‘surprise’ (sens du dix-septième siècle) que [lui] auraient faite [ses] sens’. » 53
N.B. Pour une autre version, lire le passage consacré à leurs relations dans Raoul Versini. [Wikipédia].
Viols (Racisme) : (17 octobre) 2016. Une interprète en pachtoune, dans la « jungle » de Calais, a été violée par un Afghan. Je lis sur Paris Luttes.info :
« [...] Face à la répression qui tente de rameuter à sa cause, nous ne pouvons pas laisser la tribune aux idéologies stigmatisantes et simplificatrices. Le jour où le racisme sera mort et que nous banniront l’imaginaire de la race, nous étudierions enfin les cascades d’oppressions complexes qui dégueulent jusqu’à cette femme interprète. »
- Et ses auteur[e?]) osent signer :
« Contre les frontières, les nations et le patriarcat ! » 54
- Oseraient-ils lire leur texte à la jeune femme ?
À l’extrême gauche, la priorité à la lutte de classes - ici prolongée et reconvertie en lutte antiraciste - que l’on espérait révolue, n’est toujours pas morte… (Cf. Patriarcat, Politique. Idéologie)
* Ajout. 14 août 2023. À la relecture, pas clair.
Viols (Romans anglais. XIXème siècle) : 1891. 1924. Le viol est au cœur de deux grands livres de la littérature anglaise, Tess d’Uberville de Thomas Hardy [1840-1926] et La route des Indes - A passage to India - de E.M. Forster [1879-1970]. Dans le premier, le viol n’est que très allusivement évoqué (en son temps, le court passage concernant le viol, et ce alors que je n’étais pas consciente de ce qui était écrit, était pourtant resté, caché, vivace, dans ma mémoire) ; dans le second, l’auteur laisse planer l’ambiguïté sur sa réalité [ce qui n’est pas le cas du film du même nom de David Lean. 1984]. (Cf. Culture. Cinéma)
Viols (Roy Arundhati) : 2020. Arundhati Roy, dans Mon cœur séditieux, auteure de :
« Des femmes ont été l’objet de viols en réunion. » Non. Des hommes ont, systématiquement ? régulièrement ? ponctuellement ? conjointement, l’un après l’autre, ? violé des femmes. 55
Viols (Roy Claude) : 1972. Claude Roy [1915-1997], dans Nous, auteur de :
« […] Mais une pensée glaçante me torturait, le sot ! J’étais dans le lit d’une ennemie de classe, d’une anti-communiste. Je fis donc là-dessus (sic) un fiasco, dogmatiquement marxiste, tout à fait stendhalien, et deux fois ridicule. M. von G. eut la gentillesse d’en rire, gentillesse que je ne trouvais pas si gentille que ça. Je me rhabillai, boudais, partis. Mais c’était du matin, sans l’avoir eue et sans gloire. (Nous avions à l’époque le sexe volontiers cocardier, et national, comme la ‘poésie nationale’). Sur le Prater [au centre de Vienne], je m’insultais : le beau défenseur des Russes que j’étais ! À ma place, ils auraient, bien sûr, violé la comtesse. Ils auraient eu raison. Mais ne viole pas qui veut. » 56 (Cf. Hommes. Bander. Orgueil, Langage. Verbe. Avoir, Politique. Nationalisme, Sexes […])
Viols (Sylvestre Anne) : 1978. Anne Sylvestre [1934-2020] chante Douce maison dont le refrain est :
« Non, non je n’invente pas, mais je raconte tout droit. »
Viols (Taïa Abdellah) : (13 août) 2025. Abdellah Taïa, dans l’émission de France Culture consacrée à Jean Genet 51910-1986] intitulée Mise en pièce, évoque « les plus grands violeurs que ceux que l’on côtoie tous les jours ».
Viols (Tentative de) : 1996. Est qualifié « la tentative de viol » le fait que la personne ait pu s’échapper au violeur, que celui-ci ait été contraint de fuir, ou qu’il n’ait pas bandé et / ou n’ait pas éjaculé ? Sans répondre à cette question, la cour de Cassation (Chambre Criminelle. 10 janvier 1996 n° 95-89284) a considéré que :
« Commet une tentative de viol celui qui, après avoir mis un préservatif pour pénétrer la victime, renonce à son acte en raison d’une déficience physique momentanée. » Comment distinguer, en termes de responsabilité de l’auteur du crime, ce qui relève d’une « déficience physique momentanée » dont le violeur ne serait pas maître, ce qu’il n’aurait pas voulu, d’une décision de sa part, après avoir voulu violer sa victime, de cesser ses agissements criminels ? (Prolonger) (Cf. Droit)
Par ordre chronologique. Viols. Jean Tulard :
Viols (Tulard Jean) (1) : 1991. Jean Tulard dans son Dictionnaire du cinéma [1991], présente ainsi l’actrice Julie Christie :
« Née aux Indes, elle a suivi à Londres des cours d’art dramatique avant d’être révélée au cinéma par Schlesinger [John. 1926-2003]. Elle entame une carrière qui la conduira de l’héroïne romantique [Docteur Jivago, Loin de la foule déchaînée] et les personnages les plus ambigus [Ne vous retournez pas et Le Messager] à la femme moderne [Petulia, Shampoo] qui finira même par être violée par un robot [Demon seed]. Heureux robot ! »
Du même Jean Tulard, dans son même Dictionnaire du Cinéma concernant l’actrice Wray Fay :
« Très belle, elle fut parmi les stars celle qui était toujours préposée au rôle de victime […] Que de cris n’a-t-elle pas poussés ! La terreur se lisait dans ses yeux, son corps se convulsait tandis que le monstre s’approchait et commençait ses assauts. Hélas ! Elle était toujours sauvée des pires sévices au dernier moment. » 57
- Jean Tulard est présenté par Wikipédia en ces termes :
« Il est l'un des spécialistes français de Napoléon 1er et de l'époque Napoléonienne, ainsi que de l'histoire du cinéma. Jean Tulard a contribué à plus d'une cinquantaine d'ouvrages, comme auteur unique, en collaboration ou en tant que directeur de la publication. »
- Jean Tulard fut nommé, en 2016, entre autres ‘distinctions’, commandeur de la Légion d’honneur. (Cf. Culture. Cinéma, Hommes. Grossiers, Histoire)
Viols (Tulard Jean) (2) : 2003. Jean Tulard, dans son Dictionnaire du Cinéma. Les réalisateurs, présentant le film L’amour violé [1977] de Yannick Bellon [1924-2019], auteur de :
« […] D’ailleurs (?) il y a plus d’érotisme dans L’amour violé que dans le cinéma classé X, la scène du viol étant particulièrement réaliste. » Odieux. (Cf. Pornographie. Tulard Jean)
* Ajout. 27 mars 2021. Jean Tulard, dont « l’érotisme » est l’un des principaux critères sur le fondement duquel il ne cessa de juger les films qu’il critique, auteur aussi de :
« C’est le problème du viol qu’abordait Lipstick [1977. Lamont Johnson. 1922-2010], en évitant toute complaisance érotique. » 58 (Cf. Langage. Mots. Critique de : « Érotisme »)
-------------
Viols (Vallet Odon) : 2002. Odon Vallet [philanthrope, il a donné la fortune dont il avait hérité, ‘spécialiste’ des religions], auteur de :
« Entre viols et ‘tournantes’, tourisme sexuel et pédophilie, la justice nationale et mondiale est un tribunal des mœurs. Le légal et le moral ne font qu’un entre les mains des juges et des procureurs, qui ont remplacé prêtres et confesseurs pour défendre le bien et pourfendre le mal. Que les hommes de robe défendent les femmes et les enfants est justifié, mais le bras séculier de la puissance publique leur donne les armes redoutables du procès et de la prison : la moitié des crimes condamnés en France sont des crimes sexuels. [...] On se féliciterait de ce récent intérêt de la justice pour les victimes d'agressions sexuelles si cette sévérité n'avait de graves inconvénients pour la défense des libertés et n'était de faible utilité pour la prévention des agressions. […] » 59
- Conclusion : Légiférer, condamner ne sert à rien ? à pas grand-chose ? Est, en tout cas : « redoutable ». (Cf. Droit, Justice)
Viols (Vergès Jacques) : 1988. Jacques Vergès [1925-2013], dans Beauté du crime, concernant l’un de ses ‘clients‘, rapporte cet échange entre le juge et lui :
« […] Il (son client) m’appelle au secours ; il était en prison pour viol. Je répondis évidemment à son appel et vins le soir dans sa prison. J’allais voir le juge et le dossier.
- Monsieur le Juge, le viol implique un refus du rapport sexuel. Dans ce dossier, je vois bien l’hémorragie, mais pas le refus
- Cette femme, maître, vous le savez, est plus jeune que lui de trente-cinq ans. Il a abusé de sa supériorité intellectuelle
- Sur ce plan, je pourrais vous opposer Baudelaire : ‘Maudit soit à jamais le rêveur inutile / Qui voulut le premier dans sa stupidité / S’éprenant d’un problème insoluble et stérile / Aux choses de l’amour mêler l’honnêteté’. »
- Votre jugement moral a sa valeur, il ne peut remplacer la loi.
- Qui sait ? »
Et Jacques Vergès conclut :
« Ainsi, dans notre société prétendument permissive, le stérilet à la main de nouveaux Savonarole, enferment les adorateurs de Civa [Shiva]. » 60 (Cf. Culture, Droit, Êtres humains, Justice, Patriarcat, Politique. Morale)
Viols (Violarcat) : (25 décembre) 2016. « Solidarité féministe contre le violarcat » : pochoir lu sur le trottoir devant le 8 rue des Fossés Saint Jacques. [Paris. 5ème] (Cf. Patriarcat)
Viols et vols :
Viols (et Vols) (1) : 2014. Ne pas radicalement dissocier un viol d’un vol - qui plus est, considérer qu’un « braquage tourne au viol » 61 - c’est assimiler un être humain et une carte de crédit (avec ou sans son code). (Cf. Langage)
Par ordre chronologique. Viols et vols :
Viols (et Vols) (1) : 1831. Victor Hugo [1802-1885], dans Notre-Dame de Paris, évoquant les révoltes populaires à Paris, au Moyen-Âge écrit :
« Les maris songeaient au vol, les femmes, au viol, et tous tremblaient. » 62 (Cf. Patriarcat, Histoire)
Viols (« en série », en bande organisée, en réunion, collectifs) : 2015. Victimes et violeurs indissociés. Inapproprié, invalide donc.
* Ajout. 26 novembre 2016. Le commentaire ci-dessus n’est pas approprié et n’est donc pas juste. Pourquoi ? Parce qu’en ne critiquant pas les termes employés, ma critique les conforte. Ainsi :
L’expression de « viols en série » assimile des produits « en série » à des victimes « singulières ».
L’expression de « viols en réunion » - qui se réfère aux circonstances dans lequel le viol a été commis - non critiquée est légitimée : or, elle est trompeuse car sa signification juridique ne correspond pas à la signification courante.
L’expression de « viol de bande organisée » occulte les auteurs du crime, subsumés dans leurs « bandes ».
L’expression de « viols collectifs », certes signifie que la victime a été violée par plusieurs hommes mais la singularité de chaque violeur est noyée dans le « collectif [des hommes] ». (Cf. Langage)
-------------
Viols. Violeurs :
Viols (Violeurs. Dénégation) : (19 février) 2014. Docteur André Hazout, auteur de :
« Je ne suis pas un violeur, je n'ai jamais violé personne. » Accusé de viol et agressions sexuelles sur six femmes, dont cinq se sont constituées partie civile, tandis que trente autres n’ont pu se joindre à elles, du fait de la loi en matière de délit de prescription. Condamné à huit ans de prison pour viols et agressions sexuelles et arrêté à l’audience. 63 L’usure de l’argument de la dénégation ? (Cf. Femmes. Silence, Justice. Imprescriptibilité des crimes en matière de violences à personnes)
Viols (Violeurs. Tordjman Gilbert) : 1989. 2002. Gilbert Tordjman [1927-2009], considéré comme « le pape de la sexologie française », un « sexologue de renommée internationale », médecin gynécologue, pédiatre, président de l'Association mondiale pour la sexologie, auteur de nombreux livres, a été mis en examen en 2002, accusé de viols, d’agressions sexuelles et d’attouchement sexuels par quarante patientes.
- Or, que lisait-on dans le livre intitulé La femme et son plaisir, publié en 1989, soit 20 ans auparavant ? Quelques citations :
- « Il est remarquable à quel point certaines femmes ignorent tout de leur anatomie. Elles ignorent notamment que l’orgasme est une série de contractions musculaires involontaires dont on facilite le déclanchement par une participation active et rythmée. » ;
- Dans un paragraphe intitulé : L’affirmation de soi : « Sous hypnose, nous apprenons à la consultante à moduler ses émotions de colère, de jalousie, d’excitation érotique ou de joie profonde. La femme anorgasmique, en effet, tend à inhiber l’expression de ses émotions. Nous lui apprenons aussi à aimer son corps. » ;
- Dans un paragraphe intitulé : La désensibilisation de l’angoisse : « Mieux que la relaxation, l’hypnose permet un déconditionnement de l’angoisse sexuelle, et des différentes phobies qui grèvent la comportement de la femme anorgasmique. » ;
- Dans un paragraphe intitulé : Parfaire l’éveil sensoriel : « Nous avons été surpris par la fréquence selon laquelle nos consultantes se révèlent inaptes à prendre conscience de leur état de désir, ou d’excitation érotique. L’hypnose peut leur faciliter cette prise de conscience, et les aider surtout à reconnaitre le lien entre leurs fantasmes et leurs réactions physiologiques. » ;
Et même : « Le cerveau est et reste notre organe sexuel essentiel. »
64 Moralité : Apprendre à bien lire, à temps. (Cf. Culture. Livres, Êtres humains. Cerveaux, Sexes. Sexualité)
Viols (Violeurs. Paroles de violeurs) : (5 janvier) 2022. « Je n’ai pas réussi à me retenir » ; « C’était une pulsion » ; « C’était compulsif » ; « J’avais une grande soif de sexe » ; « Si j’avais pas ça, j’allais péter un câble » ; « Il faut décharger tout ça » ; « C’était une drogue » ; « C’était un besoin physique, viscéral ». »65
Et aussi : « On multipliait les conquêtes pour se prouver qu’on n’était pas homos [des hommes violés]. (Cf. Langage, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Sexes […])
Viols (Violeurs. Soldats Russes en Allemagne) : 1985. Svetlana Alexievitch, dans La guerre n’a pas un visage de femme, transmet la parole d’un soldat :
« L’offensive progressait… Mes premiers villages allemands… Nous étions jeunes. Vigoureux. Quatre années sans femmes. Dans les caves : du vin. Et puis, de quoi le faire passer. On chopait les filles et… On s’y mettait à dix pour en violer une… Il n’y avait pas assez de femmes, la population fuyait l’armée soviétique. On en chopait qui étaient toutes jeunes. Des gamines... Douze ans… Si la gosse pleurait, on la battait, on lui fourrait un chiffon dans la bouche. Elle avait mal et nous, ça nous faisait rire. Aujourd’hui, je ne comprends pas comment j’ai pu participer à ça… Un garçon sortant d’une famille cultivée… Mais c’était bien moi…
La seule chose dont nous avions peur, c’était que nos filles, à nous, l’apprennent. Nos infirmières. Devant elles, nous avions honte… » 66 (Cf. Enfants. Hommes. Un homme à Berlin, Violences. Niées)
-------------
Par ordre chronologique. Viols. Émile Zola :
Viols (Zola Émile) (1) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de
« La faute [de Renée] qui amena plus tard son mariage avec Saccard, ce viol brutal qu’elle subit avec une sorte d’attente épouvantée, la fit ensuite se mépriser, et fut pour beaucoup dans l’abandon de toute sa vie. Elle pensa qu’elle n’avait plus à lutter contre le mal, qu’il était en elle et que la logique l’autorisait à aller jusqu’au bout de la science mauvaise. Elle était plus encore une curiosité qu’un appétit. » 67
Viols (Zola Émile) (2) : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon, auteur de :
« Les jupons ne le dérangeaient guère. Quand le sang lui montait à la tête, parbleu ! il était comme tous les hommes, il aurait crevé une cloison d’un coup d’épaule, pour entrer dans une alcôve. Il n’aimait pas à s’attarder aux bagatelles de la porte. Puis, lorsque c’était fini, il redevenait bien tranquille. » 68 (Cf. Hommes. Violents, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
Viols (Zola Émile) (3) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« […] [Marie] - Pas ça, oh !, non, oh !, non. C’est défendu.
Lui [Octave Mouret], ardemment, répétait :
- ‘On ne le saura pas, je ne le dirai à personne.
- Non, Monsieur Octave. [...]
Alors, il ne parla plus, ayant une revanche à prendre [sa maîtresse, Valérie, l’avait repoussé : ‘Elle n’aimait donc pas ça ?’], se disant tout bas, crûment : ‘Toi, tu vas y passer !’
Comme elle refusait de la suivre dans la chambre, il la renversa brutalement au bord de la table ; et elle se soumit, il la posséda entre l’assiette oubliée et le roman qu’une secousse fit tomber par terre. […]
Lorsque Marie et Octave se furent relevés, dans le désordre des jupes, ils ne trouvèrent rien à se dire. […] » 69
Viols (Zola Émile) (4) : 1885. Émile Zola [1840-1902], dans Germinal, auteur de :
« Justement, comme Étienne restait assis, immobile dans l’ombre, un couple descendait de Montsou le frôla sans le voir, en s’engageant dans le terrain vague de Réquillart. La fille, une pucelle bien sûr, se débattait, résistait avec des supplications basses, chuchotées ; tandis que le garçon, muet, la poussait quand même vers les ténèbres d’un coin de hangar […]. C’étaient Catherine et le grand Chaval. […] Pourquoi serait-il intervenu ? Lorsque les filles disent non, c’est qu’elles aiment à être bourrées d’abord. […]
Il l’avait empoignée solidement, il la jetait sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages, elle cessa de se défendre, subissant le mâle avant l’âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l’enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s’éteignirent, on n’entendit plus que le souffle ardant de l’homme.
Étienne cependant, avait écouté, sans bouger. Encore une qui faisait le saut ! » 70 (Cf. Enfants, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Violences. Violences à l’encontre des enfants. « Droit de cuissage ». Zola Émile)
-------------
Viols (Zemmour Éric) : 2006. Éric Zemmour, dans Le premier sexe évoque la « peur archaïque du phallus, du ‘viol de la pénétration‘ » des « femmes d’aujourd’hui ». 71
N.B. « Archaïque » : « Qui est très ancien. » Et qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui ? (Cf. Femmes. Peur, Patriarcat, Sexes. Hommes. Zemmour Éric)
-------------
II. Violences :
Violences :
Violences (1) : Avant toute dénomination, spécification et donc analyse de la violence, des violences, partir de ses prémisses : la violence, où qu’elle soit mise en œuvre et qu’elle qu’en soit les auteur-es, est utilisée afin de perpétuer et /ou de changer un rapport de forces, et/ou d’empêcher que le dit changement n’advienne.
* Ajout. 20 août 2017. Pour la critique de l’emploi du terme, cf. notamment « Violences à l’encontre des femmes ». (Poursuivre) (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Violences (2) : Le lien entre pauvreté / banlieues, émigrés / étrangers, violences / sexuelles / à l’encontre des femmes, et ce, en lien avec « peur », « in-sécurité », « nationalisme » ne cesse de se renforcer. Sans cesse, briser le nœud coulant.
Violences (3) : Penser que la diversité des termes, sans cesse accentuée, a à voir avec la permanence de toute réelle lutte contre elles : « violences familiales », « violences infra-familiales », « violences conjugales », « violences sexuelles », « violences faites aux femmes, sur les femmes, à l’encontre des femmes », « violences faites aux enfants, sur les enfants, à l’encontre des enfants », « violences pédophiles », « violences incesteuses », « violences des hommes, des femmes, des enfants » etc…, auxquels ajouter, tout cela, mâtiné du « genre ».
Violences (4) : Vous mêlez, amalgamez, supprimez auteur-es / victimes, il ne reste plus que des « violences ». Alors, toutes confondues, dépolitisées, abstraitisées, il ne reste plus à l’État qu’à affirmer vouloir les réprimer. Et lui aura principalement gagné.
Violences (5) : Toute - première, a fortiori seule - attention portée sur la, sur les violences des opprimé-es détourne le regard sur les innombrables, ancestrales modalités des répressions exercées à leur encontre. (Pas clair ; à reprendre)
Violences (6) : Combien faut-il de siècles de violences subies et d’impuissances intériorisées, justifiées, pour se satisfaire de, se limiter à leur destruction symbolique ?
Violences (7) : (24 novembre) 2018. Entendu un « Gilet jaune » affirmer : « La violence vient d’en haut ».
Tant que le même terme sera employé pour signifier les violences exercées par la police et celle exercée par les manifestant-es persistera, la demande - obsessionnelle et donc essentielle - de condamner les violences - exprimée par les journalistes aux « gilets jaunes », à leurs soutiens politiques, est inacceptable.
Plus encore, tant que le terme de « violences », tel qu’il nous est imposé à longueur de journées par les médias, occultera les violences quotidiennes que sont les conditions de vie et de mort imposées, sans même que leurs avis soit requis, contre leur gré, aux millions de personnes victimes de la politique menée, alors leur demander de condamner les violences étatiques, celles que l’État impose aux policier-ières d’exercer est honteux.
La revendication, certes polysémique : « La police avec nous » - a souvent été entendue dans les manifestations.
(Violences) (8) : 2019. Lutter contre les [seules] violences du patriarcat, c’est aussi légitimer les principes qui fondent ce contre quoi on affirme lutter.
(Violences) (9) : Il est impossible de parler de, de penser en termes de « violences », sans plus de spécification. Dans cette hypothèse, se mêlent violences et contre-violences, êtres humains singuliers et État, hommes, femmes et enfants, il-légales et il-légitimes, policiers-ières et manifestant-es, etc…
* Ajout. 26 décembre 2023. Lu sur Franceinfo : « Une mère et ses quatre enfants, âgés de 10 mois, 4, 7 et 10 ans, ont été retrouvés morts. Le père de famille a été interpellé à Sevran, (Seine-Saint-Denis). Une enquête pour ‘homicides volontaires avec préméditation’ a été ouverte. Il avait déjà, porte un coup de couteau à sa femme en 2019 »
Comment qualifier un père de famille qui assassine son épouse et son enfant : ici ses quatre enfants donc cinq « cadavres » ?
En tout état de cause, cette dramatique réalité est à ajouter à mes critiques du terme de féminicide.
(Violences) (10) : La révolution que progressivement les féministes ont provoqué par la dénonciation des violences exercées par les hommes - autrefois cadenassées dans la sphère dite privée, celle où ils étaient privés de toute atteinte de leurs pouvoirs singuliers, transformés en droits génériques - ne le furent plus. Dorénavant les hommes, tous les hommes, ne peuvent plus mettre en avant leurs œuvres au lieu et place de leurs conduites. Plus encore, ils sont d’abord redevables de ces dernières.
(Violences) (11) : Combien de violences contre les enfants, les femmes, les hommes qui expriment, des années après, le cri étouffé du petit garçon, son impuissance, sa colère rentrée, au vu, à l’écoute des violences de leur père à l’encontre leur mère ? (Cf. Patriarcat)
Par ordre alphabétique. Violences :
Violences (Afghanistan) : (17 août) 2021. Les premières, les plus nombreuses, les plus aisément identifiables victimes des Talibans dorénavant au pourvoir en Afghanistan sont et seront les femmes, soit la moitié de la population, dont tant et tant doivent actuellement vivre sous la terreur. Et moi, dans mon confort, ma sécurité, je me limite à écrire ces trois malheureuses lignes. (Cf. Politique. Impérialisme)
Par ordre chronologique. Violences. « Bizutages » :
Violences (« Bizutages ») (1) : 1992. Excellent numéro de la revue Panoramiques, Coordonné par Marie-Odile Dupé. Tout est à lire. 72 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Bizutages »)
Violences (« Bizutages ») (2) : (23 septembre) 2024. Entendu Claude Ponti, sur France Culture, se remémorer un « bizutage » dans une école des Beaux-Arts : un garçon nu peint en bleu était enfermé avec une femme peinte en jaune et ils devaient ressortir verts.
-------------
Violences (Brecht Bertolt) : Bertolt Brecht [1898-1956] (sans source, ni date), auteur de :
« On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent. Mais on ne dit jamais rien des rives qui l’enserrent. » 73
Violences (Breton André) : 1946. André Breton [1896-1966], dans le Second Manifeste du surréalisme, auteur de :
« […] C’est même du bouillonnement de ces représentations vides de sens que naît et s’entretient le désir de passer outre à l’insuffisance, à l’absurde distinction du beau et du laid, du vrai et du faux, du bien et du mal. Et comme c’est du degré de cette résistance que cette idée du choix rencontre que dépend l’envol plus ou moins sûr de l’esprit vers un monde enfin habitable, on conçoit que le surréalisme n’ait pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, de l’insoumission totale, du sabotage en règle, et qu’il n’attend encore rien que de la violence. L’acte surréaliste le plus simple consiste, révolvers au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut dans la foule. Qui n’a pas eu, au moins une fois, envie d’en finir de la sorte avec le petit système d’avilissement et de crétinisation en vigueur a sa place toute marquée dans la foule, ventre à la hauteur du canon. » [Suit une longe note qui se veut d’interprétation de ce qu’il vient d’écrire…] 74 (Cf. Culture, Violences. Sade. Breton André)
(Violences. Burke Edmond) : 1790. Edmund Burke [1729-1797], dans ses Réflexions sur la Révolution de France, a défini l’essence du pouvoir, en évoquant « les rois […] qui savent se maintenir fermes sur le trône, tenir la bride haute à leurs sujets, faire respecter leurs prérogatives, et se garder, par la vigilance renouvelée d’un despotisme sévère, des premiers germes de la liberté. » 75 (Cf. Droit. Jurisprudence, Êtres humains. Soi. Burke Edmund, Histoire. Burke Edmund)
Remplacer « rois », sans pour autant le supprimer par : homme, mari, père, frère, amant [violents]. Et ajouter dieu : beaucoup est déjà dit du pourquoi de la violence. (Cf. Patriarcat)
Violences (Churchill Winston) : (4 juin) 1940. Winston Churchill [1874-1965], dans son discours, auteur de :
« We shall never surrender ». [« Nous ne nous rendront jamais »] (Cf. Histoire)
Par ordre chronologique. Violences. Cologne. 31 décembre 2015 :
Violences (Cologne. 31 décembre 2015) (1) : 2015. Des étrangers, non : des hommes étrangers ont violé, violenté des femmes Du nécessaire oubli des « hommes » …
Sans préjuger de la validité de l’accusation concernant les auteurs de ces violences. (Cf. Hommes, Langage, Patriarcat)
* Ajout. 21 avril 2021. Je me rends compte que malgré toute la couverture médiatique, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé à Cologne ce jour-là. Seules les victimes le savent sans doute. Comment connaitre leurs analyses ?
Violences (Cologne. 31 décembre 2015) (2) : 2017. Je lis dans un interview d’Alice Schwarzer que 624 femmes ont porté plainte pour agressions sexuelles. Son analyse :
« Les hommes étaient mus par un mélange d’idées patriarcales et d’islam politique. » 76 (Cf. Politique. Islam, Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Par ordre chronologique. Violences. « Conjugales » :
Violences (« Conjugales ») (1) : (13 juin) 2016. Sur France Culture, Dounia Bouzar, interrogée par Alain Lewkowicz évoque ses parents qui « se séparent dans un contexte de violences conjugales ».
L’interviewer poursuit :
« Vous parlez d’une violence conjugale. Vous savez pourquoi votre père et votre mère se tapaient dessus ? »
Si la grossièreté de ce langage est inacceptable, sémantiquement, la clarification de l’expression utilisée par Donia Bouzar - ne distinguant ni l’auteur ni la violence, indissociablement mêlés - n’est pas erronée. 77 En revanche, dans les deux cas, l’auteur des violences n’est pas nommé. (Cf. Violences. Patriarcales)
Violences (« Conjugales ») (2) : (octobre) 2018. Un clip gouvernemental, Une femme :
« Je suis victime de violences conjugales ». Non. Elle est la victime des violences de son mari / compagnon / amant. (Cf. Langage, Patriarcat. Permanence)
Violences (« Conjugales ») (3) : (janvier) 2023. Violences conjugales : le fils du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti mis en examen. Réaction - partielle - du ministre :
« […] En tant que ministre je n’ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et que pour que leur parole soit prise en compte. En tant que citoyen je demande à ce qu'on respecte ma vie familiale. »
Éric Dupond-Moretti a-t-il jamais pensé que la dénonciation des violences-dites-conjugales, non seulement remettent en cause ce qu’il nomme - de manière injustifiée - « la vie familiale », mais ne s’expliquent et ne sont justifiées que par la famille ? Et c’est cet homme qui est censé définir la vie des hommes et des femmes vivant dans notre société. Quant à son autosatisfaction concernant les violences à l’encontre des femmes, il suffit d’écouter les femmes victimes de violences patriarcales qui ont cru à la justice. Et enfin, concernant sa demande de « respect de [sa] vie familiale », traduction : ne me cherchez pas, vous pourriez le regretter. J’en ai les moyens. Mais plus profondément, sous couvert de cet ‘argument’, c’est le traitement par la justice des violences inscrites dans la sphère-dite-privée qui pourrait bien être invalidée. (Cf. Justice. Dupond-Moretti Éric, Patriarcat. Pères, Politique. Hommes. « Politiques ». Dupond-Moretti Éric, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Violences (Conséquences) : Dénoncer une violence au nom de ses conséquences, fut-ce-t-elle sur les femmes et les enfants, c’est en légitimer le principe, dès lors, fondé.
Violences (« Consentement ») : Cf. Penser. Consentement. Violences à l’encontre des femmes. « Consentement »
Violence (« Cycle de la violence ») : Pour relativiser ce qui est présenté comme étant « le cycle de la violence » [exercée par les hommes à l’encontre des femmes], entendu dans le film de Carlos Saura, La chasse [1974] :
« Plus l’ennemi se défend, meilleure est la chasse. »
Pour relativiser l’analyse ou, plutôt, pour l’invalider ? (Cf. Culture. Cinéma)
Violence (Cyrulnik Boris) : (30 janvier) 2021. Boris Cyrulnik, sur France Inter, auteur de :
« Les femmes sont moins douées pour la violence que les hommes. »
Vu comme cela…, si c’est une question de don… 78 (Cf. Féminismes. Antiféminisme, Patriarcat)
Violences (David-Neel Alexandra) : 1915. Alexandra David-Neel [1868-1969] « bastonne » en Inde ses deux « domestiques » [surpris par elle à « lui voler la petite moitié d’un petit sac d’orge » âgés de 20 et 22 ans, et ce après avoir précisé qu’elle « ne leur donne pas d’argent, mais seulement de la nourriture et des vêtements. »]
Elle écrit alors que « chacun des deux coupables ne tentent pas même d’esquiver les coups sentant qu’ils les ont mérités » et s’étonne qu’après « leur bonne volée »
« C’est drôle, n’est-ce pas ? », écrit-elle à son mari - qu’ils « ont été d’une docilité et d’une attention remarquable à [son] service. »
Et, « philosophe », elle poursuit ses réflexions :
« Mais le plus singulier, pour le philosophe que je suis, c’est d’avoir constaté que cette exécution commencée très froidement, peu à peu, éveillait la colère en moi ; parfois, voire le même le plus souvent, le mouvement de l’esprit déclenche le geste physique qui lui correspond : on est en colère, alors on cogne. Mais, ici, c’était le contraire, le geste physique allait réveiller des centres nerveux correspondant à un sentiment mental : je cognais et je sentais la colère se produire […]. » 79 (Cf. Êtres humains. Domestiques)
Violences (Décapitation) : (21 octobre) 2020. Gilles Kepel, sur France Culture, après l’assassinat de Samuel Paty, pose la question :
« Comment [l’assassin] a-t-il appris à décapiter, car cela s’apprend. » (Cf. Politique. Médias)
* Ajout. Même jour, sur France Inter, Michel Wieviorka, auteur de :
« Techniquement, ça doit être très difficile. » Là, c’est clairement odieux.
J’apprends, au cours de la même émission, que Charles Maurras [1868-1952], souvent vanté sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite), avait en mai 1936 écrit :
« Il faut tuer Léon Blum [1872-1950] avec un couteau de cuisine. » La citation n’est pas la bonne - et je n’ai pas envie de restituer son exactitude - mais l’idée, le projet était bien celui-là.
Violences (Diderot Denis) : (? octobre) 1767. Denis Diderot [1713-1784], dans une lettre à madame d’Épinay [1726-1783], auteur de :
« Ce n’est pas à celui qui frappe, c’est à celui qui est frappé à estimer la violence du coup ». (Cf. Justice) 80
- Idée répétée, le 6 septembre 1768. Denis Diderot, dans une lettre à Falconet [1716-1791], auteur de :
« C’est à celui qui est frappé et non à celui qui frappe, qu’il appartient d’apprécier la violence du coup. » 81
Essentielle inversion de l’analyse, dès lors, considérablement complexifiée. (Cf. Justice)
-------------
Violences (Distinction mineur-es / majeur-es) : (8 octobre) 2021. Juliette Pierron, #me tootheatre, auteure de :
« C'était mon prof de théâtre, il me connaissait depuis mes 14 ans, lui il en avait 42. Son comportement change le jour de mes 18 ans. J'en suis sûre, parce qu'il voulait être protégé par la loi. » (Cf. Droit, Justice, Politique. Lois)
Violences (« Dix commandements ») : « Tu ne violeras pas » n’en fait pas partie. Et « la femme » fait partie, au même titre que « la maison », du « bien du prochain ». (Cf. Patriarcat, Politique. Lois, Violences. Lois religieuses,)
Violences (Eros et thanatos) : « La guerre et la mort » : ou comment sous des termes et des liens faciles furent expliquées, cachées, justifiées les violences à l’encontre des êtres humains. (Langage. Conjonction)
Par ordre chronologique. Violences. Église catholique :
Violences (Église catholique. Jésuites) : 2014. Pascal Bruckner, dans Un bon père, évoquant le collège de Jésuites à Lyon, dans les années 1960, auteur de :
« Par ailleurs, ils formaient une organisation hiérarchique assez stricte qui étouffait les scandales, les pères peloteurs de gamins (plutôt rares), les confesseurs lestes qui engrossaient leurs paroissiennes et dont les collèges prenaient en charge les enfants sans pouvoir toujours dissimuler leur origine. »
Et je lis, page suivante : « Rien de plus doux qu’une grande religion quand elle a renoncé à la violence, au prosélytisme, et n’exhale que son message spirituel : la foi s’est muée en émotions esthétique, en nostalgie de l’enfance. » 82 (Cf. Enfants. Bâtards, Politique. Hiérarchie, Violences. CIASE. CIIVISE)
Violences (Église catholique. Évêques) : (7 novembre) 2022. Lu sur France Culture :
« Un aveu qui fait l'effet d'une bombe dans l'Église Catholique de France ce lundi. Onze évêques sont mis en cause devant la justice civile ou la justice de l'Église pour abus sexuel, parmi eux, Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux. Alors que la Conférence des évêques se réunit depuis jeudi à Lourdes, son président, a tenu un point presse exceptionnel. Éric de Moulins-Beaufort révèle que onze évêques ou anciens évêques sont ‘mis en cause’ dans des affaires de violences sexuelles. Six sont connus du public. Ce sont d'anciennes affaires. Mais à ces six prélats s'ajoutent deux autres personnes : Jean-Pierre Ricard, cardinal et archevêque émérite de Bordeaux et Michel Santier, ancien évêque de Créteil. Pour ce dernier, l'affaire a été révélée il y a quelques semaines dans la presse.
Éric de Moulins-Beaufort a évoqué également le cas de trois autres ex-prélats sans toutefois préciser leurs noms ou la nature des faits. »
* Ajout. 9 janvier 2025. J’entends, ce jour, qu’aucun évêque n’a, à la suite de la dénonciation des violences sexuelles dans l’église catholique, démissionné.
Violences (Église catholique. Pape) : 2022. Le pape François a refusé de recevoir Jean-Marc Sauvé et les membres de la CIASE.
-------------
Violences (« Folie Meurtrière ») : (25 mai) 2022. Entendu, sur LCI, évoquer « la folie meurtrière » (au singulier ou au pluriel, et peu importe en l’occurrence, laquelle) : et si l’on remplaçait « la folie » par la norme, la culture, la réalité quotidienne, universelle, meurtrière, ne comprendrait-on pas mieux, beaucoup, beaucoup mieux, le monde, passé, actuel, futur ?
Par ordre chronologique. Violences. France Culture :
Violences (France Culture) (1) : (20 août) 2020. France Culture ose nommer son débat du jour : L’affaire Dupont de Ligonnès, polar de l’été ? Et j’entends rapidement l’un des « spécialiste » invité, entre autres analyses longuement reproduites sur le site par écrit - pour nous aider à mieux réfléchir sans doute - déclarer : « Xavier de Ligonnès, lui-même a créé une fiction » ; suivi de « ça rajoute une couche à la fictionnalité du fait-divers ».
N.B. Pour rappel : Xavier de Ligonnès a assassiné son épouse Agnès Hodanger et ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne, Benoit. (Cf. Êtres humains)
Violences (France Culture) (2) : (10 mars) 2021. Une jeune fille de 14 ans est assassinée par un jeune garçon et une jeune fille du même âge. Présentation par France Culture [08h 10] :
« Une querelle qui tourne mal et qui fait des blessés et des morts. »
Ni sujet, ni victime, ni auteur-e, ni responsabilité de quiconque, ni analyse, ni spécificités d’aucune sorte ne sont possibles…
Violences (France Culture) (3) : (16 octobre) 2021. Sur France Culture [9h 07], au terme de la présentation de la manifestation du jour pour dénoncer les violences sexuelles dans les milieux du théâtre, il est dit qu’il est demandé « une enquête quantitative. » Une manipulation, un mensonge.
-------------
Violences (Gresh Alain) : (juin) 2021. Dans Le Monde Diplomatique, Alain Gresh, concernant la Palestine, évoque si justement « ceux qui prennent le silence des médias pour l’acquiescement des victimes ». 83 Universel. (Cf. Politique. État. Israël. Médias, Violences. Victimes)
Violences (Jarry Alfred) : 1940. Alfred Jarry [1873-1907], rapporté dans L’Anthologie de l’humour noir, d’André Breton [1896-1966] :
« Une autre fois, dans un jardin, il s’amuse à déboucher le champagne à coups de révolver. Des balles s’égarent par-delà la clôture, entrainant l’irruption d’une dame dont les enfants jouaient dans le jardin voisin. ‘S’ils les atteignaient, pensez donc !’ ‘Eh ! dit Jarry, qu’à cela ne tienne, nous vous en ferons d’autres.’ »
Ne pas oublier que c’est à ce type d’humour, et à cette aune, que tant ont été contraint-es de trouver cela drôle. 84 (Cf. Culture, Êtres humains. Relations entre êtres humains. Humour, Féminismes. Humour)
Violences (Kropotkine Pierre) : 1889. Pierre Kropotkine [1842-1921], dans La morale anarchiste, auteur de :
« Aujourd’hui, quand nous voyons un Jacques l’Éventreur égorger à la file dix femmes des plus pauvres, des plus misérables, - et moralement supérieures aux trois quarts des riches bourgeoises - notre premier sentiment est celui de haine. Si nous le rencontrions le jour où il a égorgé cette femme qui voulait se faire payer par lui les six sous de son taudis, nous lui aurions logé une balle dans le crâne, sans réfléchir que la balle eût été mieux à sa place dans le crâne du propriétaire du taudis.
Mais quand nous nous ressouvenons de toutes les infamies qui l’ont amené, lui à ces meurtres ; quand nous pensons à ces ténèbres dans lesquelles il rôde, hanté par des images puisées dans des livres immondes ou par des pensées soufflées par des livres stupides, - notre sentiment se dédouble. Et le jour où nous saurons Jacques entre les mains d’un juge qui, lui, a froidement massacré dix fois plus de vies humaines, d’hommes, de femmes et d’enfants, que tous les Jacques ; quand nous le saurons entre les mains de ces maniaques à froid où de ces gens qui envoient un Borras [Joseph. ?-?] au bagne pour démontrer aux bourgeois qu’ils montent la garde autour d’eux - alors toute notre haine contre Jacques l’Éventreur disparaîtra. Elle se portera ailleurs. Elle se transforme en haine contre la société lâche et hypocrite, contre ses représentants reconnus. Toutes les infamies d’un éventreur disparaissent devant cette série séculaire d’infamies commises au nom de la Loi. C’est elle que nous haïssons. » 85
Si les femmes misérables sont « moralement supérieures aux trois quart (sic) des riches bourgeoises » … [Poursuivre la critique de ce riche tissu de contradictions]. (Cf. Culture, Corps. Crâne, Droit, Justice, Relations entre êtres humains. Haine, Politique. Anarchisme. État. Lois, Patriarcat, Économie)
Violences (Logement) : 1986. Lu dans Hard Times. Histoires orales de la grande dépression de Studs Terkel [1912-2008] :
« Dans l’appartement de trois pièces, le père revenait ivre le soir et battait sa femme. La fille était juste à côté. Ça avait évidemment un effet sur elle. Dans le nouveau logement, quand le père voulait battre sa femme, les garçons le mettaient dans la chambre du fond, et ils l’y enfermaient. Et la fille n’était plus témoin de toute cette violence. C’est arrivé par la seule vertu de l’espace. »
N.B. Et l’épouse n’était plus battue… ? 86 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Violences (Luttes) : (14 septembre) 2024. J’entends concernant les enfants, les femmes, les êtres violentés, violé-es :
« Il faut vite les accompagner » ; « Il faut une prise en charge » …
Il faut des solidarités, des partages et des luttes.
Violences. Loi :
Violences (Loi) (1) : Le vice rédhibitoire de la pensée juridique : elle ne peut aborder la question des violences intrinsèques à la loi, la violence étant inhérente à tout système de domination politique.
Violences (Loi) (2) : La pensée juridique féministe doit à la fois tenir compte de la critique du droit libéral et de la critique patriarcale : complexe.
-------------
Violences. Lois religieuses :
Violences (Lois religieuses) (1) : Animistes, bouddhistes, chrétiennes, hindouistes, juives, musulmanes, etc.., toutes patriarcales, toutes injustes, toutes à abolir. Ceci posé, on peut alors poursuivre dans l’analyse des distinguos entre elles. Et dans leur condamnation. Pas avant.
Violences. Lois religieuses. Christianisme :
Violences (Lois religieuses. Encyclique « Rerum Novarum ») : 1891. L’Encyclique Rerum Novarum est considérée comme l’Encyclique qui posa les fondements dits ‘progressistes‘ de la « doctrine sociale » de l’Église catholique. On y lit :
« Il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques ; ouvrages d'ailleurs qui sauvegardent admirablement l'honneur de son sexe et répondent mieux, par nature, à ce que demandent la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille. » (Cf. Êtres humains. Domestiques, Femmes, Famille, Patriarcat. Église catholique, Politique. État. Lois, Violences. Église catholique)
* Ajout. 19 mai 2017. 1936. Dans le Journal d’un curé de campagne de Georges Bernanos [1888-1948], un prêtre plus âgé que ledit curé de campagne lui demande de « se rappel[er] l’histoire ! » et il en donne comme exemple « la fameuse Encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum » :
« Vous (les prêtres d’alors, en 1936, donc) lisez cela tranquillement, du bord des cils, comme un manquement de carême quelconque. À l’époque, mon petit, nous avons cru sentir la terre trembler sous nos pieds. Quel enthousiasme ! J’étais, pour lors, curé de Norenfontes, en plein pays de mines. Cette idée si simple que le travail n’est pas une marchandise, soumise à la loi de l’offre et de la demande, qu’on ne peut pas spéculer sur les salaires, sur la vie des hommes, comme sur le blé, le sucre et le café, ça bouleversait les consciences crois-tu ? Pour l’avoir expliquée en chaire à mes bonshommes, j’ai passé pour un socialiste et les paysans bien-pensants m’ont fait envoyer en disgrâce à Montreuil. […] » 87 (Cf. Patriarcat, Histoire)
En retranscrivant ce texte, je me rends mieux compte de l’importance qu’eut pu avoir une Encyclique concernant le proxénétisme, indissociable de toutes les manifestations de la marchandisation des êtres humains. (Cf. Proxénétisme)
Violences. Lois religieuses. Islam :
Violences (Lois religieuses. Islam) (1) : Ce n’est pas parce que les violences commises au nom de l’Islam sont contraires aux « valeurs-de-la-République » qu’elles doivent être condamnées, mais parce qu’elles sont inhumaines. Rappeler une telle évidence [me] met mal à l’aise. (Poursuivre) (Cf. Famille, Politique. État. Islamisme. Lois)
Violences (Lois religieuses. Islam) (2) : Dès lors que l'Islam est religion d'État, toute législation, et plus spécifiquement tous les codes de la famille, ne peut en être que dépendante ; dès lors toute politique faisant, dans ces États, référence aux droits des femmes, à quelconque égalité entre les hommes et les femmes, à une lutte contre les violences faites aux femmes repose sur une contradiction indépassable.
- Lire en ce sens l’incohérence et surtout l’absurdité du communiqué de la présidence de la République Algérienne, à l’occasion d’une modification du code pénal algérien :
« Notre pays démontre encore une fois son attachement au respect de la dignité humaine qui est au centre de nos valeurs spirituelles et figure aussi parmi les priorités du droit international contemporain » apparait alors au grand jour. Mais il permet aussi de dévoiler que le droit dit international se satisfait fort bien de la permanence de ces lois religieuses. En droit, donc en fait, il les cautionne, les entérine, les légitime. 88 (Cf. Droit. CEDAW, Famille. Code de la famille, Femmes, Relations entre êtres humains. Attachement, Patriarcat, Politique. État. Islamisme)
-------------
Violences (Marat) : 1771. Marat [1743-1793], dans Les aventures du jeune comte Potowsky, auteur de :
« Ils [les princes] doivent à leurs peuples l’exemple des bonnes mœurs et des vertus ; ne sont-ils donc pas inexcusables lorsqu’ils ne leur donnent que celui des vices, lorsqu’ils s’abandonnent aux voluptés les plus honteuses et qu’ils sont les premiers à débaucher les femmes, à débaucher leurs sujets ? » 89
Violences (« Métaphore de la tasse de thé ») : (20 août) 2019. Lu dans Le Monde cette si éclairante « métaphore de la tasse de thé », telle qu’exprimée par l’actrice Emma Thomson :
« C’est très simple, explique-t-elle. Imaginez que la relation sexuelle est comme une tasse de thé. Si vous demandez à quelqu’un : ‘Voulez-vous une tasse de thé ?’ et que la personne s’exclame : ‘J’adorerais !’, courez faire chauffer la bouilloire. Si vous revenez avec la tasse et que la personne vous dit : ‘Hum, Finalement, je n’en ai pas très envie’, vous n’allez quand même pas lui pincer le nez et lui verser de force la tasse dans la bouche ! Ce serait un comportement de fou ! Elle a le droit de changer d’avis. Respect. Autre hypothèse : vous revenez avec la tasse et le lait et voilà que la personne s’est endormie. Vous êtes déçu, mais vous n’allez pas la réveiller pour la forcer à boire. Une personne inconsciente ne peut vouloir de thé ! Vous voyez, c’est simple comme une tasse de thé. » 90 (Cf. Patriarcat, Sexes […])
Violences (Montesquieu) : 1734. Montesquieu [1689-1755], dans les Considérations sur les causes de la grandeur des romains et leur décadence, auteur de :
« La vue continuelle des combats de gladiateurs rendaient les Romains extrêmement féroces. » 91
Violences (« Motifs ») : Pourquoi les médias [s’] interrogent-ils avec tant de ténacité sur les motifs d’un assassinat, d’une violence, d’une tuerie… ? Parce qu’il n’y pas de réponse, ou plutôt, parce qu’il est impossible d’y répondre, que celles, généralement avancées, sont inappropriées, tandis que les plus que probables sont exclues de l’analyse.
Violences (Nietzsche Friedrich) : 1884. Friedrich Nietzsche [1844-1900], dans Contribution à l’histoire naturelle de la morale, auteur de :
« La cruauté est l’une des plus antiques réjouissances de l’humanité. » 92 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. Nietzsche Friedrich)
Violences (Niées) : Les qualificatifs : « Viril », « Grivois », « Gaulois », « Scabreux », « Licencieux », « Libertin », « Déplacé », « Grossier », « Insane », « Vulgaire », « Mal compris, interprétés » … ont souvent été employés, en tant que masques des violences, bel et bien, exercées. Et, leur auteur - dont, faute de radicale critique patriarcale, seule la croyance au mythe de la justice interdit de voir l’évidente culpabilité - doit bénéficier de la « présomption d’innocence ». (Cf. Justice, Langage. Adjectif)
Violences (Nin Anaïs) : (avril) 1940. Anaïs Nin [1903-1977], dans son Journal, écrit :
« Je ne crois plus que le marxisme offre une solution aux misères du monde, parce qu’il ne guérit pas l’homme de la violence » ; elle évoque aussi « l’atrophie des sentiments qui crée des criminels. » 93 (Cf. Politique. Marxisme)
Violences (Pascal Blaise) : 1670. Blaise Pascal [1623-1662], dans les Pensées, auteur de :
« Es-tu moins esclave pour être aimé et flatté de ton maître ; tu as bien du bien esclave, ton maître te flatte. Il te battra bientôt. » 94 (Cf. Relations entre êtres humains. Flatterie. Aimer, Patriarcat, Violences. Patriarcales)
Violences (Pareto Vilfredo) : 1917. Vilfredo Pareto [1848-1923], dans son Traité de sociologie générale, auteur de :
« Les détracteurs de la révolution française l’accusent d’avoir fait largement emploi de la force ; ses admirateurs s’efforcent d’excuser cet emploi. Les uns et les autres ont raison, s’ils cherchent à trouver des dérivations, lesquelles agissent sur les gens qui éprouvent une répugnance instinctive, et non raisonnée pour les souffrances. Ils se trompent, s’ils ont objectivement (sic) en vue les conditions de l’utilité de la société ; et à ce point de vue, il faut reconnaître que l’emploi de la force fut le principal mérite de la révolution, et non une faute. » 95 (Cf. Penser. Utilitarisme, Politique. État. Répression, Histoire. Pareto Vilfredo. Révolution française)
Violences (Prêtres) : Concernant les violences exercées par les prêtres, les moines…, le plus fascinant, le plus inquiétant, le plus intéressant est que l’on ait pu, si aisément, pendant des siècles, ‘oublié’ qu’ils étaient des hommes. (Cf. Hommes, Patriarcat, Violences à l’encontre des enfants. Prêtres)
Violences (« Pudeur ») : Si l’on veut rechercher dans l’histoire comment furent cachées, et donc légitimées les violences patriarcales, focaliser son attention sur ce que l’on a qualifié de « pudeur » - ce que le droit nommait « atteintes à la pudeur » - et qui aujourd'hui seraient nommé-es : viols, agressions sexuelles, violences sexuelles… (Cf. Droit, Êtres humains. Pudeur. Femmes. Pudeur, Langage, Penser. Méthode, Histoire, Violences. Patriarcales)
Violences (Regrets) : (22 juillet) 2018. Dans une émission intitulée : « Alexandre Benalla, avant la révélation de l’affaire : ‘J’ai pété les plombs’ » dont la présentation est :
« Quelques semaines après son intervention (sic) auprès (sic) des CRS, lors des manifestations du 1er mai, Alexandre Benalla aurait confié ses regrets sur son comportement à un haut-fonctionnaire, selon le Journal du Dimanche’ », que lit-on en matière de « regrets » ? :
« J’ai une merde sur le dos. Je suis allé sur la manif. C’était chaud. Les CRS en prenaient plein la gueule. J’ai pété les plombs. » 96 (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emanuel. « Une tempête dans un verre d’eau », Langage. Verbe. Avoir)
Violences (Respect) : (18 octobre) 2016. Concernant la lutte des Conti[nental], Xavier Mathieu, ancien délégué syndical CGT, auteur de :
« À partir du moment où on a montré qu’on était méchants, on a été respectés. » 97 (Cf. Politique. Luttes)
Violences (Rousseau Jean-Jacques) : 1761. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans La nouvelle Héloïse, justifie les violences paternelles. Julie, après avoir été frappée par son père, scène qui fut suivie de « regrets de son emportement », écrit à Claire, sa confidente :
« Pour moi, je lui ai dit, et je le pense, je serais trop heureuse d’être battue tous les jours au même prix et qu’il n’y a point de traitement si rude qu’une seule de ses caresses n’efface au fond de mon cœur. » 98 (Cf. Femmes, Famille, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Violences (Roy Arundhati) : 2018. Arundhati Roy, dans Le Ministère du Bonheur Suprême, auteure de :
« […] On leur donnait à chacun une arme, alors, après avoir replié le doigt autour de la détente et senti, d’une pression si légère soit-elle, qu’elle répondait, après avoir évalué leurs chances et décidé que c’était une option possible, alors seulement, ils laissaient la rage et la honte de la sujétion dans laquelle ils vivaient depuis des décennies, des siècles, se ruer à travers leurs veines et y changer le sang en fumée. » 99
Bouleverse tant et tant d’analyses sur ‘les violences’. (Poursuivre)
Violences (Servage) : 1878. Léon Tolstoï [1868-1910], dans Souvenirs, auteur de :
« Dans l’ancien temps, tous les seigneurs, surtout ceux qui chassaient, avaient leurs favoris. Chez mon père, c’étaient deux frères, Petroucha et Matioucha, tous deux, beaux, forts, chasseurs habiles. Ils furent tous deux émancipés et reçurent de mon père toutes espèces de privilèges et de cadeaux. Lorsque mon père mourut subitement, on les soupçonna de l’avoir empoisonné. Si l’on eut ces soupçons, ce fut parce que tout l’argent et les papiers que mon père avait sur lui furent volés et les papiers seuls, lettres de change et autres, renvoyés à notre maison par l’intermédiaire d’une mendiante. Je ne pense pas que cela soit vrai, mais c’est possible. Il y eut en effet souvent des cas où des serfs, élevés particulièrement hauts par leurs maîtres et troquant soudaine leur servitude contre un pourvoir considérable (sic), perdirent la tête et tuèrent leurs bienfaiteurs. Il est difficile de se représenter tout ce passage de l’esclavage complet non seulement à la liberté, mais à un pouvoir considérable (re-sic). J’ignore comment et pourquoi, mais je sais que cela arrivait, et que Petroucha et Matioucha furent précisément de ces hommes qui avaient perdu la tête, qui ne pouvaient se contenter de ce qu’ils avaient reçu (sic) et qui désiraient naturellement s’élever de plus en plus haut. » 100 (Cf. Êtres humains, Politique. Esclavage)
Violences (Sexuelles) : 1987. Fannie Flagg dans Beignets de tomates vierges, auteure de :
« Evelyn se demandait pourquoi les insultes avaient toujours une connotation sexuelle. Pourquoi les hommes, quand ils voulaient en humilier d’autres, les traitaient-ils de femmelette ? Comme si être une femme était ce qui pouvait arriver de pire ! On n’insultait plus ni les Noirs, ni les Japonais, ni les Italiens, les Polonais ou les Irlandais, en tout cas en public. Seules les femmes continuaient de faire l’objet de lazzis et d’injures. » 101 (Cf. Patriarcat. Flagg Fannie)
Par ordre chronologique. Violences. Sports :
Violences (Sports) (1) : 1981. Georges Simenon [1903-1989], dans Mémoires intimes, auteur de :
« Les matchs professionnels - concernant « le hockey sur glace », sport pratiqué par son fils Marc - qui rassemblent des milliers de supporters, sont si passionnés, surtout entre Canadiens et Américains, qu’on entend la foule crier : ’Kill him’. » 102
Violences (Sports) (2) : (6 juin) 2020. JORF n°0138 du 6 juin 2020. Décret n° 2020-688 du 4 juin 2020 portant création d'un délégué ministériel en charge de la lutte contre les violences dans le sport.
Article 1 : Il est institué, auprès du ministre chargé des sports, un délégué ministériel à la lutte contre les violences dans le sport. Il est nommé par décret, sur proposition de ce ministre. » (Cf. Patriarcat, Politique. État)
Violences (Sports) (3) : (9 mars) 2022. Selon la cellule ministérielle qui recense les violences sexuelles dans le sport, plus de 600 signalements ont été enregistrés depuis 2020. 655 personnes sont mises en cause, dont 97 % d’hommes, dans le cadre de 610 affaires au total, concernant 54 fédérations sportives, à la date de fin décembre 2021 :
« Près de 70 % des enquêtes sont closes. 47 % des mis en cause dans les affaires remontées à la cellule ont fait l’objet d’une plainte au pénal ou d’une main courante. Au niveau administratif, 291 mesures ont été prononcées par les préfets. La mise en place du contrôle d’honorabilité des bénévoles progressivement depuis septembre 2021 a permis de contrôler 341 000 bénévoles de 68 fédérations. Ces contrôles ont abouti à 17 mesures d’incapacité d’exercer comme éducateur sportif ou exploitant. »
N.B. L’article de Libération dont ces lignes sont extraites est ainsi présenté : « Fléau » dont la signification est : « catastrophe, calamité, désastre ». Quant aux femmes, elles ne sont pas des victimes, elles sont « majoritairement visées. » 103 (Cf. Justice, Langage, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Violences (Statistiques) : Une fois que l’on aura des statistiques des violences concernant les femmes, les enfants, les policier-ères, les manifestant-es, les maires, le personnel médical, les juifs-ves, les musulman-es, les homosexuel-les… ; sans oublier dans les rues, les stades, l’hémicycle, les commissariats, les écoles, etc…, on fait quoi ?
Violences (« Stress post-traumatique ». Critique) : Ne pas oublier de penser à la signification et la fonction politique de l’emploi de ce nouveau ‘concept’ : Stress post-traumatique. En effet, en évacuant la question de la responsabilité de l’auteur - fut-il un État - de l’agression, il peut être employé ‘à égalité’ concernant l’auteur ou les auteurs et la ou les victimes d’une violence. Il peut en outre concerner tout à la fois indifféremment les conséquences d’une guerre, d’une torture, d’un accident, d’un choc, d’un évènement climatique, d’un viol…
Violences (Styron William) : 1979. William Styron [1925-2006], dans Le choix de Sophie, auteur de :
« Mon Dieu, comme j’étais vulnérable ! Une vague de désespoir me submergea aussitôt. N’importe qui aurait pu me parler ainsi, mais Nathan ! Mais par ces paroles, il avait totalement sapé la confiance et l’allégresse joyeuse que ses encouragements antérieurs avaient fait naître en moi à propos de mon travail. Elle était écrasante, indiciblement écrasante, cette brusque et brutale rebuffade, tellement écrasante qu’il me sembla que certains étais de mon âme elle-même se mettaient à trembler et à se désagréger. La gorge serrée, je m’efforçais de m’arracher une réponse, mais j’eus beau faire, aucun mot ne franchit mes lèvres. » 104 (Cf. Femmes. Silence)
Violences (Suicides) : (17 mars) 1896. Article paru dans Le Radical, signé Un parisien :
« Une femme se jette par la fenêtre avec son enfant. Son amant est d’abord soupçonné de l’avoir précipitée. Mais bientôt, réflexions venues, on conclut au suicide. L'homme accusé sera remis en liberté, indemne. En effet, paraît-il, il n’a pas - ce jour là - tué sa femme. Seulement, tous les autres jours, il la rouait de coups, l’assommait, la martyrisait, si bien qu’en une minute d’affolement, elle a préféré la mort à cette vie atroce et a sauté par la fenêtre. L’homme est-il innocent ? La loi dit oui. Parce qu’il n’a pas commis l’assassinat définitif, avec ses bras, ses pieds, avec ses dents. Il peut dire qu’il n’a pas touché cette femme. Elle s’est tuée volontairement. Ironie sinistre des mots et si contraire à l’équité ! Est-ce donc un suicide que cette évasion de la douleur dans la mort ? Est-ce donc une mort volontaire que cet élan dans le vide pour échapper à une vie de torture et d’angoisse ? Enfin, l’homme dont les brutalités perpétuelles ont déterminé cet acte de désespoir est-il ou n’est-il pas un assassin, au même titre que s’il avait planté son couteau entre les épaules de sa victime ? […]
Nous ne voulons pas comprendre que chaque crime, chaque délit n’est que la synthèse des crimes et délits préalables, commis le plus souvent par tous les autres personnages que ceux qu’on stigmatise. L’agent provocateur du crime généralement se promène paisiblement les deux mains dans les poches tandis que son élève direct croupit dans les prisons. C’est notre philosophie. Elle parait évidente dans le banal fait-divers dont je parle. L’amant de la suicidée restera indemne et circulera à son aise. C’est elle qui a eu tort de se tuer et si elle s’était manquée, c’est elle qui serait poursuivie pour avoir attenté aux jours de son enfant. Ça s’appelle la légalité et ça se corrobore de la jurisprudence. Et la société est contente. Avouons qu’elle n’est pas difficile. »
Un mois après cet article, le 27 avril 1896, Leroi fut condamné par le tribunal correctionnel de la Seine à un mois de prison. 105 (Cf. Droit. Patriarcal, Justice. Procès. Patriarcal, Politique. Lois)
Violences (Suicides après assassinat[s]) : (24 mars) 2017. Lu la présentation du livre de Pierre Adrian, Des âmes simples [Les Équateurs], dans Le Monde. Critique. Littérature :
« […] Il est des terribles drames qui foudroient les cœurs et qui meurtrissent les consciences. Comme le suicide de ce père de famille incapable de supporter son divorce et qui a entrainé dans la mort son fils de 8 ans et sa fille de 3 ans. ‘Je me souviens de trois cercueils dans l’Église’… » 106
Il tue ses deux enfants : ce père assassin est, tel que présenté ici, dédouané par la justice, réhabilité par la presse, lavé de tout péché par l’église catholique. (Cf. Justice. Suicides après assassinat, Patriarcat. Église catholique)
Violences (Symboliques) : Attention, la référence aux violences dites « symboliques » ont souvent pour objet, sinon pour fonction de masquer les violences…disons réelles ; en attendant une meilleure formulation.
Pierre Bourdieu [1930-2002], dans La domination masculine [1998] en fut un bon exemple. (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Bourdieu Pierre)
Violences (Tchékhov Anton) : 1895. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Trois années, auteur de :
« Notables en quoi ? dit Laptev, en contenant son irritation. Une famille de notables ! Ses maîtres faisaient donner les verges à notre grand-père et le dernier petit fonctionnaire venu lui tapait sur la gueule. Notre grand-père battait notre père et notre père nous battait tous les deux. […] Et moi, et moi, regarde-moi… Aucune souplesse, aucune hardiesse, aucune volonté, j’ai peur à chaque pas que je fais, comme si on allait me battre, je me laisse intimider devant des nullités, des idiots, des abrutis, qui me sont incommensurablement inférieurs intellectuellement et moralement ; j’ai peur des concierges, des suisses, des agents de police, des gendarmes, j’ai peur de tout le monde, parce que je suis né d’une mère traquée, que depuis l’enfance, j’ai été assommé de coups et terrorisé ! » 107 (Cf. « Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage ». Tchékhov Anton)
Violences (Terkel Studs) : 1984. Studs Terkel [1912-2008], dans « La bonne guerre ». Histoires orales de la seconde guerre mondiale, auteur de :
« Jusqu’à la guerre, il n’avait jamais bu. Il n’avait jamais fumé non plus. Quand il est revenu, c’était un ivrogne fini. Il avait des cauchemars épouvantables. Il se réveillait en pleine nuit en hurlant. Il était agité de tremblements et je restais des heures, assise à la soutenir. Si on allait au cinéma et qu’il y avait des scènes de violences, il se mettait à trembler et il fallait qu’on s’en aille. Il a commencé à nous battre, moi et les gosses ; c’est devenu une brute. » 108 (Cf. Politique. Guerre, Violences. Patriarcales)
Violences (Tolstoï Léon) : (29 mars) 1904. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« La liberté des hommes peut être atteinte seulement quand les hommes cesseront, usant l’un contre l’autre de violence, de justifier celle-ci. »
Ambigu et / ou mal exprimé : serait-ce légitimer la violence, si elle n’est pas justifiée ? 109
Violences (Vallès Jules) : (19 décembre) 1864. Jules Vallès [1832-1885], dans Le Progrès de Lyon, auteur de :
« […] Il est de situations pénibles, affreuses, que crée, à ceux qui s’aiment ou à ceux qui pensent, l’état actuel et des moeurs et des lois. Il y a des âmes que ravagent des douleurs cachées, mais des douleurs fécondes. Elles sont écrasées sous la tyrannie de la famille qui ne veut pas, du pouvoir qui fait taire, de la misère qui fait mourir ; les plus nobles et les plus hauts sentiments sont écrasés par la boue des réalités. » 110 (Cf. Famille)
Par ordre chronologique. Violences. Victimes :
Violences (Victimes) (1) : (5 octobre) 2021. Lu dans le résumé de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église catholique [CIASE] :
« La commission a entendu placer les victimes au cœur de ses travaux. Ses membres ont écouté́ de nombreuses personnes ayant subi des agressions, non comme des experts, mais comme des êtres humains acceptant de s’exposer et de se confronter personnellement et ensemble à cette sombre réalité́. Par cette plongée, ils ont entendu assumer la part de commune humanité́, ici blessée et douloureuse, que nous avons en partage. On ne peut en effet connaitre et comprendre le réel tel qu’il est, et en tirer les conséquences, si l’on n’est pas capable de se laisser soi-même toucher par ce que les victimes ont vécu : la souffrance, l’isolement et, souvent, la honte et la culpabilité́. Ce vécu a été́ la matrice du travail de la commission.
Une conviction s’est imposée au fil des mois : les victimes détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu’il puisse être restitué. C’est par conséquent leur parole qui sert de fil directeur au rapport de la commission. Ces personnes étaient victimes, elles sont devenues témoins et, en ce sens, acteurs de la vérité́. C’est grâce à elles que ce rapport a été́ conçu et écrit. C’est aussi pour elles, et pas seulement pour nos mandants, qu’il l’a été́. C’est sur cet échange singulier et invisible qu’il a été́ construit, sans que tout cela ait été́ aussi clairement pensé à l’avance. » 111
* Ajout. 16 octobre 2021. Une victime auditionnée par la CIASE :
« La fausse compassion, il n’y a rien de pire. » (Cf. Droit. CIASE, Relations entre êtres humains. Compassion, Patriarcat. Église catholique)
Violences (Victimes) (2) : (5 octobre) 2021. A la suite de la publication de ce rapport, Véronique Margron, dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France [CORREF], à la question :
« Face à ce constat impitoyable, que dire aux victimes ? répond :
« D’abord se faire tout petit ». 112 (Cf. Dialogues)
* Ajout. 5 octobre 2021. François Devaux, s’adressant aux évoques, auteur de :
« […] le mieux que vous auriez à faire, ne serait-ce que pour la survie de l’Église avant même celle de votre âme, serait encore de vous taire et de commencer à vous exécuter avec ardeur et célérité… »
* Ajout. 11 octobre 2021. Un immense pas en avant institutionnel : certain-es (dont François Devaux, ex-président de La parole libérée, Anne Soupa, Christine Pedotti) demandent « la démission collective de l’ensemble des évêques en exercice » de France :
« Sans doute, tous les évêques français n’ont-ils pas couvert des crimes, mais la structure même de la hiérarchie catholique suppose une continuité et une solidarité entre chaque évêque et son prédécesseur. À ce titre, si tous ne sont pas coupables, tous sont responsables. » (Cf. Droit. CIASE, Patriarcat. Église catholique, Politique. Hiérarchie)
Mais avec de tels séismes - celui-là n’étant pas le seul - que va-t-il rester de l’institution église catholique ?
* Ajout. 19 octobre 2022. Lu dans Le Canard enchaîné (p.1) :
« [alors que 1.500 victimes avaient saisi l’une des deux commissions mises en place dans la foulée du rapport Sauvé] Fin septembre 2022, seules 23 indemnisations avaient été versées, pour des sommes allant de 8.000 à 60.000 euros. »
N.B. J’avais légèrement préjugé du ‘pas en avant’ et / ou lourdement sous-estimé le poids de la structure…’ (Cf. Économie. Argent)
* Ajout. 14 décembre 2022. Lu dans Le Canard enchaîné concernant les richesses du seul évêché de Paris :
« L’an passé, les legs et donations ont atteint 22 millions, les quêtes 10 millions, le denier de l’église 25 millions, la vente des cierges près de 4 millions, les bons vieux troncs, plus d’un million, soit 77 millions d’euros. » Ce à quoi, il faut ajouter « le portefeuille de titres et placements divers 197 millions, dont 78 millions de ‘bons de capitalisation’ ; tandis que « côté immobilier, le bilan s’élèverait à 248 millions » chiffre considéré comme très sous-évalué (estimé entre 400 et 700 millions), sachant que la liste des biens n’a jamais été publiée. » 113 (Cf. Économie. Richesse)
Violences (Victimes) (3) : (8 janvier) 2022. Alain Finkielkraut, sur France Culture, emploie l’expression de « victime consentante ». 114
-------------
III. Violences. Sade :
Violences. Sade :
Violences (Sade) (1) : Sade [1740-1814] est à la justification du patriarcat ce que Marx est à la critique du capitalisme.
Violences (Sade) (2) : Lire, de Sade [1740-1814], les Lettres à sa femme 115 pour être définitivement convaincu-e de l’ignominie du personnage. Un tel jugement n’épuise pas l’homme. (Valable pour tout l’Abécédaire…)
* Ajout. 10 février 2017. (25 juin) 1917. Lu dans le Journal de l’abbé Mugnier [1853-1944] que madame de Chévigné [1859-1936], « arrière-petite-fille de Laure de Noves, petite nièce du marquis de Sade » avait, au cours d’un dîner chez Jean Cocteau, dit qu’il « adorait sa femme et que sa correspondance avec elle étaient des lettres d’amour. » 116
* Ajout. 8 août 2016. Les Lettres de Sade à sa femme peuvent être utilement comparées avec, par antithèse, les lettres rédigées, elles aussi en prison, que Choderlos de Laclos [1741-1803], avaient écrites à son épouse. 117
* Ajout. 9 février 2020. Pierre Guyotat [1040-2020] pour qui Sade était « bien sûr », « un héros », « parce qu’il a survécu par la seule force de son esprit » évoquait dans un interview en 2014 ses « lettres les plus charmantes à sa femme qui montrent son caractère joueur. » 118
* Ajout. 23 janvier 2021. 1967. Gilbert Lely [1904-1985], dans son Sade, auteur de :
« On le verra, en avril 1767, partir pour Lyon rejoindre cette demoiselle [« La Beauvoisin »] laissant à Paris sa jeune femme enceinte de cinq mois. Malgré ses bons sentiments pour la marquise - il serait, déclare-t-il- ‘au désespoir de lui déplaire’ - M. de Sade est contraint de se servir d’autres femmes, car il la trouve ‘trop froide et trop dévote’ pour lui. » 119
* Ajout. 24 janvier 2021. 1967. Gilbert Lely [1904-1985], dans son Sade, auteur de :
« […] Il ne faut pas que les sarcasmes, non plus que les accès de fureur de notre héros, à propos de la moindre contrariété - réactions bien excusables dans son atroce réclusion - puissent égarer le lecteur ni sur les procédés de Mme de Sade (?), ni sur les véritables sentiments que son mari lui portait. […] » 120 (Cf. Hommes. « Héros »)
« Réactions bien excusables » … : le patriarcat justifié en trois mots.
Violences (Sade) (3) : 1801. Sade [1740-1814], dans Histoire de Juliette, met dans la bouche de madame Delbène, supérieure de l’abbaye de Panthémont, à Juliette, cette présentation de son avenir :
« Quand tu auras badiné quelques années avec ce que les sots appellent ses lois [celles de «la nature»], quand, pour te familiariser avec leur infraction, tu te seras plu à les pulvériser toutes, tu verras la mutine, ravie d’avoir été violée, s’assouplissant sous tes désirs nerveux, venir d’elle-même s’offrir à tes fers… te présenter les mains pour que tu les captives ; devenue ton esclave, au lieu d’être ta souveraine, elle enseignera finement à ton cœur la façon de l’outrager encore mieux, comme si elle se plaisait dans l’avilissement, et comme si ce n’était réellement qu’en t’indiquant de l’insulter à l’excès, qu’elle eut l’art de te mieux réduire à ses lois. » 121
Violences (Sade) (4) : Qualifier Sade de : « transgressif », c’est s’interdire toute analyse, toute prise de position personnelle, tout jugement de valeur, tout engagement. (Cf. Langage)
Par ordre alphabétique. Violences. Sade :
Violences. Sade. Guillaume Apollinaire :
Violences (Sade. Apollinaire) (1) : 1907. Guillaume Apollinaire [1880-1918], dans Les onze mille vierges [1907], auteur de :
« Le marquis de Sade, cet esprit le plus libre qui ait encore existé, avait sur la femme des idées particulières et la voulait aussi libre que l’homme. Ces idées que l’on dégagera un jour, ont donné naissance à un double roman : Justine et Juliette. Ce n’est pas par hasard que le marquis a choisi des « héroïnes » et non des héros. Justine, c’est l’ancienne femme, asservie, misérable et moins qu’humaine ; Juliette au contraire représente la femme nouvelle qu’il entrevoyait, un être dont on n’a pas encore idée, qui se dégage de l’humanité, qui aura des ailes et qui renouvellera l’univers. »
- En ayant notamment cette analyse en tête, il faut lire Justine et Juliette. 122
- Lire aussi d’Apollinaire l’ignoble Les onze mille verges. 123 (Cf. Femmes. « Héroïnes », Hommes. « Héros »)
Violences (Sade. Apollinaire Guillaume) (2) : 2005. Le Dictionnaire de la pornographie, pour sa part, présente Guillaume Apollinaire [1880-1918] ainsi :
« Un étourdissant pornographe, mêlant virtuosité littéraire et perversion avec un génie inégalé depuis le XVIIIème siècle », et vante l’importance de son « œuvre » pornographique.
Il faut lire Les onze mille verges pour apprécier à leur juste valeur les jugements suivants : « Sade accommodé à la sauce rabelaisienne », « débauches d’éruditions, de jeux de langage et d’humour burlesque » et leur apothéose : « roman de l’amour moderne ».
Une critique cependant, le concernant, dans ce Dictionnaire de la pornographie : Apollinaire n’arrive pas à la hauteur de Sade (et des ambitions de la pornographie ?) : il « ne génère guère d’enjeux philosophies explicites, ce qui constitue une des différences majeures avec Sade ».
Il est enfin incidemment noté, sans plus d’inquiétude, que « l’inceste et la pédophilie y sont omniprésents. » 124 (Cf. Êtres humains. Pervers, Hommes. « Intellectuels », Pornographie, Violences. Incestueuses)
-------------
Violences (Sade. Bataille Georges) : (février) 1957. Georges Bataille [1897-1962], dans un article paru dans Critique concernant Hurlevent - Wuthering Heights - d’Emily Brontë [1818-1848], auteur de :
« […] Dans le sadisme, il s’agit de jouir de la destruction contemplée, la destruction la plus amère étant la mort de l’être humain. C’est le sadisme qui est le mal : si l’on tue pour un avantage matériel, ce n’est le véritable Mal, le mal pur, que si le meurtrier, par-delà l’avantage escompté, jouit d’avoir frappé. » 125 (Cf. Violences. Viols. Bataille Georges)
Violences (Sade. Barthes Raymond) : 2014. Pascal Bruckner, dans Un bon fils, rapporte , selon ses souvenirs et sa mémoire, les critiques de Raymond Barthes [1915-1980], directeur de sa thèse - qu’il accepta de diriger et cautionna donc - : ‘Le corps de chacun appartient à tous’ :
« Barthes remarqua (sic) qu’une telle utopie [!] présentait un aspect coercitif [!] et presque [!] inhumain si elle devait être traduite dans les faits; elles s’apparentait plutôt à l’idéal républicain de Sade [Horresco referens…] qu’au phalanstère fouriériste. » 126 (Cf. Corps. Bruckner Pascal)
Violences (Sade. Blanchot Maurice) : 1949 (?) Maurice Blanchot [1907-2003] (source à retrouver) auteur de :
« Sade a eu la hardiesse d’affirmer qu’en acceptant intrépidement les goûts singuliers (sic) qu’il avait et en les prenant pour le point de départ et le principe de toute raison, il donnait à la philosophie le fondement le plus solide qu’il pût trouver et se mettait en mesure d’interpréter d’une manière profonde le sort humain dans son ensemble. […] Or, il se trouve que cette pensée n’est pas négligeable […]. » 127 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie)
Par ordre chronologique. Violences. Sade. André Breton :
Violences (Sade. Breton André) (1) : (27 janvier) 1928. André Breton [1896-1966], lors de la première séance des « Recherche sur la sexualité », mises en oeuvre par les Surréalistes, après avoir justifié son « accus[ation] des « pédérastes », dont il excluait en premier lieu, Sade, et l’explique ainsi :
« Tout est permis par définition à un homme comme le marquis de Sade, pour qui la liberté des mœurs a été une question de vie ou de mort. » 128
Violences (Sade. Breton André) (2) : 1940. André Breton [1896-1966], dans son Anthologie de l’humour noir auteur de :
« Grâce à M. Maurice Heine [1884-1940], l’immense portée de l’œuvre sadiste est aujourd’hui hors de cause : psychologiquement, elle peut passer pour la plus authentique devancière de cette de Freud et de toute la psycho-pathologie moderne ; socialement, elle ne tend à rien moins que l’établissement, différée de révolution en révolution, d’une véritable science des mœurs. […]
Les excès même de l’imagination à quoi l’entraîne son génie naturel et le disposent ses longues années de captivité, le parti-pris follement orgueilleux qui le fait, dans le plaisir comme dans le crime mettre à l’abri de ses satiétés ses héros, le souci qu’il montre de varier à l’infini, ne serait-ce qu’en les compliquant toujours d’avantage, les circonstances propices au maintien de leur égarement (sic) ont toute chance de faire surgir dans son récit quelque passage (sic) d’une outrance manifeste (sic), qui détend le lecteur (sic) en lui donnant à penser que l’auteur n’est pas dupe. »
Tout est bien, donc : entre hommes avertis, on s’est compris, détendu, joui des violences les plus monstrueuses sur les femmes. 129 (Cf. Hommes. « Héros », Patriarcat, Politique. Révolution, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Violences (Sade. Breton André) (3) : André Breton [1896-1966], auteur de :
« Le marquis de Sade est revenu et plus que jamais, il nous aide à nous voir nous-mêmes et à nous comprendre nous-mêmes. » 130 (Cf. Êtres humains, Hommes, Penser, Patriarcat)
-------------
Violences (Sade. Camps de concentration) : Pourquoi, en France, a-t-on si peu mis en relations les écrits de Sade avec les camps de concentration ?
Violences (Sade. Camus Albert) : 1951. Albert Camus [1913-1960], dans L’homme révolté peut tout à la fois - presque incidemment, il est vrai - écrire que Sade est « professeur de tortures », « théoricien du crime sexuel » et qu’il est - entre autres nombreuses citations de cet acabit - : « […] un homme de lettres parfait. » Bien entendu des femmes, il n’est jamais question.
- On peut aussi noter ce jugement :
« On n’a exécuté Sade qu’en effigie ; il n’a tué de même qu’en imagination. » J’hésite à m’interroger sur la sienne, sur sa cécité, ou à me féliciter de l’avancée - bien trop tardive et dont il porte avec tant d’autres la responsabilité - des luttes féministes contre les violences des hommes à l’encontre des femmes. 131
Violences (Sade. Deforges Régine) : 1978. Régine Deforges [1935-2014], auteure de :
« Il y a un humour dans Sade mais les femmes ne peuvent ou ne veulent le percevoir : il est dirigé contre elles, elles en sont victimes. Encore que cela ne me dérange absolument pas qu’il y ait des victimes et des bourreaux. » 132 La cohérence de la pensée de la domination…
Sur Wikipédia, on peut notamment lire la concernant :
« […] D'un ton très libre, voire libertin, ses romans sont souvent des plaidoyers féministes défendant le droit des femmes à s’assumer seules. […] » (Cf. Femmes. Humour, Hommes. « Libertins », Langage. Mots, Pornographie, Violences. Victimes)
Violences (Sade. Delon Michel) : (28 janvier) 2005. (Après avoir écouté les interventions de Michel Delon, dans l’émission de France Culture : Libertins dans l’âme)
Si vous posez d’emblée - postulez donc - que « le libertinage », est fille de la liberté, issue de la pensée la liberté, alors vous ancrez Sade dans la pensée philosophique. Si vous mêlez libertinage de pensée, de plume et de « mœurs », alors vous accordez aux agissements humains un statut qui les place sous cette aura. Si vous considérez en sus que « la philosophie des lumières », c’est lutter contre « tous les dogmes et les formes d’oppression », alors, comme Michel Delon, vous pouvez considérer que Sade est non seulement l’auteur de « grands romans », mais aussi un « philosophe » inscrit qui plus est dans « la philosophe des Lumières ». Si en sus, vous le justifiez comme analyste politique qui a su critiquer « la double morale » de la Révolution, alors là, Sade a toutes les qualités.
Il manque juste un élément de la pensée, celle qui met à bas tous ces présupposés, « le viol des petites filles », pourtant formellement évoqué par Michel Delon.
Quant aux hommes pour qui ces violences sont perpétrés, ils sont hors sujet de la pensée : ce sont des « personnages livrés à différentes positions de l’orgie », sans aucun lien bien sûr avec les petites filles violées.
Au nom enfin de la « réhabilitation de la nature humaine ».
Celle de Michel Déon ?
Enfin, concernant la critique de la « double morale » dont Sade est gratifié par Michel Delon, là, ce n’est plus une pensée patriarcale, c’est un aveuglement patriarcal. 133 (Cf. Hommes. « Libertins »)
Violences (Sade. Dworkin Andrea) : 1981. Pour une première lecture féministe critique de la vie et des écrits de Sade, Cf. Intercourse et Pornography. Men possessing women d’Andrea Dworkin. 134 (Cf. Féministes. Dworkin Andrea, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Violences. Sade. Gustave Flaubert :
Violences (Sade. Flaubert Gustave) (1) : Lu : « Louise Colet [1810-1876] raconte que Flaubert [Gustave. 1821-1880] a sur sa table de nuit les œuvres complètes de Sade, qu’il met à la disposition de ses invités. » 135
* Ajout. 14 août 2023. Il existe d’innombrables références - systématiquement relevées par La Pléiade, mais jamais commentées - à Sade [« Le Vieux »] dans la correspondance de Gustave Flaubert.
Violences (Sade. Flaubert Gustave) (2) : (24 janvier) 1877. Gustave Flaubert 1821-1880], dans une lettre à Alfred Baudry [1828-1884], qualifie La philosophie dans le boudoir de « divin livre ». 136
-------------
Violences (Sade. France Culture) : (5 février) 2013. Marc Voinchet, responsable de l’émission quotidienne du matin de France Culture, à Jouamana Haddad, féministe, pour son livre : Superman est arabe, après avoir affirmé qu’elle ne « nuançait pas », auteur de :
« Je crois savoir que (dans les pays arabes) vos livres se lisent un peu - comme les livres du marquis de Sade - sous le manteau ; ça doit vous faire très plaisir… » 137 (Cf. Culture, Féminismes. Antiféminisme, Hommes. Journalistes)
Violences (Sade. Heine Maurice) : Maurice Heine [1884-1940], concernant les violences commises par Sade sur Rose Keller [dite « L’affaire d’Arcueil »], bien présentée par Gilbert Lely, auteur de :
« Qui devons-nous croire en effet, de Rose, ouvrière en chômage - présentée par Sade comme une « prostituée » -, soutenant n’avoir jamais accepté que l’offre d’un travail honnête ou du marquis, libertin d’habitude, prétendant n’avoir pu se méprendre sur la complaisante facilitée d’une aventurière ? »
Une ouvrière au chômage ne peut être honnête et devient une aventurière et un marquis, « libertin d’habitude » a acquis la science d’en juger. 138 C’est de cette ‘culture’ que nous venons et qui est encore si persistante. (Cf. Hommes. « Libertins », Patriarcat)
Violences (Sade. Freud Sigmund) : 1930. Sigmund Freud [1856-1939], dans Le malaise dans la culture, auteur de :
« C’est dans le sadisme, dans la mesure où elle [la « libido »] infléchit dans son sens (sic) le but érotique (sic) mais satisfait pleinement, ce faisant, la vie sexuelle (sic), que nous parvenons à pénétrer plus clairement son essence (sic) et sa relation à l’Éros. Mais, même là où elle survient sans intention sexuelle [!], fût-ce dans la plus aveugle rage de destruction, on ne peut méconnaître le fait que sa satisfaction est connectée à une jouissance narcissique extraordinairement élevée, en ce qu’elle montre au moi ses anciens désirs de toute-puissance. […] » 139 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. Freud Sigmund)
Violences (Sade. Jeangène Vilmer Jean-Baptiste) : 2010. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, dans le Dictionnaire de la violence, publié aux Presses universitaires de France (PUF), présenté comme « philosophe, juriste et politiste français », auteur, concernant Sade, de :
- « Un examen attentif des différentes affaires qui ont conduit à son enfermement, et dont certaines sont bien connues (les débauches outrées de 1763), l’affaire Rose Keller de 1768 et l’affaire de Marseille de 1772) établit que les faits sont très minces : blasphème, violences, sodomie). Rien que de très banal, finalement et personne n’en est mort. » Et de :
- « C’est parce que, dans sa vie, rien ne justifie la violence dont il est victime que Sade, dans son œuvre, pourra à son tour être violent, pour rien. » 140
* Ajout. 2 octobre 2021. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer fut notamment de 2016 à 2022 directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire. Ministère des armées. [Wikipédia] (Cf. Politique. Guerre)
Violences (Sade. Klossowski Pierre) : 1947. 1967. Pierre Klossowski [1905-2001], auteur en 1947 de Sade mon prochain, réédité en 1967 précédé de Sade, ou Le philosophe scélérat.
Violences (Sade. Lebel Jean-Jacques) : 17 avril (2022). Jean-Jacques Lebel, « artiste plasticien », auteur de :
« ‘Les surréalistes ont vu chez Sade’ « le philosophe, le penseur de la totalité de l’existence, y compris de l’inconscient, du non-dit, de l’indicible. C’est pour cela, que ça nous met en abime. » 141
Violences (Sade. Lely Gilbert) : 1967. Gilbert Lely [1904-1985], dans ‘son’ Sade, auteur de :
« Tout ce que signe Sade est amour. » 142 (Cf. Penser. Postulat)
Violences (Sade. Le Monde) : (5 décembre) 2014. Jean Birnbaum, responsable du Monde des Livres, sous l’intitulé : Sade ou l’érotisme de la pensée, auteur de :
« Le marquis de Sade n'était pas qu'un simple écrivain de la débauche mais un philosophe de la vérité : le ‘Divin Marquis’ donnait du corps aux idées et ‘allumait’ la philosophie. » 143 Écouter la suite : tout serait à citer en matière de [tentatives de] réhabilitation. (Cf. Hommes. Journalistes, Pornographie. Niel Xavier. Tortures, « Sciences » sociales. Philosophie)
Violences (Sade. Lévy Bernard-Henri) : 1977. Bernard-Henry Lévy, dans un texte intitulé Socialisme et barbarie, écrit :
« Que revendique Sade - qu’il nomme en conclusion « le divin marquis » et qu’il analyse comme « le complice » de Saint-Just [1767-1794] - : quelque chose comme la liberté pure, la liberté d’un enfermé, le rêve d’un prisonnier. » 144
Violences (Sade. Miller Alice. Critique de) : 1984. Alice Miller [1923-2010], dans C’est pour ton bien, auteure de :
« Chaque être doit trouver sa forme d’agressivité s’il ne veut pas se changer en docile marionnette entre les mains des autres. Seuls les êtres qui ne se laissent pas réduire au statut d’instrument d’une volonté étrangère peuvent imposer leurs besoins personnels et défendre leurs droits légitimes. » 145 (Cf. Êtres humains, Enfants. Miller Alice)
Violences (Sade. Nadeau Maurice) : (décembre) 1949. (mars) 1953. (mai) 1957. Maurice Nadeau [1911-2013], notamment directeur des Lettres nouvelles, évoque concernant les Lettres de Sade, dans un texte publié par Combat en décembre 1949, republié en 2002, « ses idées audacieusement modernes », « la fougue de ses instincts exacerbés par la claustration », « sa magnifique santé intellectuelle qu’entament à peine quelques excusables bizarreries de comportements », « la singularité de sa nature », [ses] « souffrances endurées pour ce qu’il juge être des peccadilles », de « banales affaires de mœurs », son « ardent tempérament »…
- Je lis aussi :
« Il n’est pas une de ses lettres qui ne soit un chef d’œuvre d’impétuosité, de verve, de force ou d’élégance, qui ne porte les marques confondues d’un écrivain de race et d’un type supérieur d’humanité. » Universel négationnisme…
Le même Maurice Nadeau dans un article intitulé Honneur à Machiavel, poursuit dans le n°1 des Lettres Nouvelles en mars 1953, en évoquant « les aventures de sa vie dissolue », [celle de Sade] en la qualifiant d’être « imaginatif et visionnaire », le juger, comme Machiavel, digne de « notre admiration » pour avoir affirmé « la vérité sur l’homme et la société » […], méritant d’être honorés pour leur lucidité, leur courage et l’exemple qu’ils donnent, paradoxalement sans doute, d’une humanité supérieure. »
Enfin, dans le Mercure de France, en mai 1957, Sade est traité par lui d’ « individu singulier » : un très léger début de prise de conscience, d’inquiétude ? 146 (Cf. Culture)
Par ordre chronologique. Violences. Sade. Prix :
Violences (Sade. Prix) (1) : 2004. Ruwen Ogien [1949-2017], pour Penser la pornographie, a reçu le prix Sade, « prix littéraire en hommage au marquis de Sade ». (Cf. Penser. Liberté, Pornographie, Économie. Don)
Violences (Sade. Prix) (2) : 2012. Christine Angot, auteure notamment de L’inceste, a obtenu - et accepté - le prix Sade. Celui-ci récompense « un auteur singulier et honnête homme, selon la définition de son siècle. Un authentique libéral qui sera parvenu, par-delà les vicissitudes de la Révolution et l'emprise de l'ordre moral, à défaire les carcans de la littérature comme ceux de la politique. »
- Il existe le prix Sade du premier roman, celui de l’Essai, celui du Livre d’art, celui du Jury, celui du Document. Emmanuel Pierrat (auteur notamment de : La justice pour les nuls) en est président. Juré-es : Catherine Millet, Marie L, Frédéric Beigbeder, Ruwen Ogien [1949-2017], Catherine Robbe-Grillet, Laurence Viallet, Catherine Corringer, Marcella Iacub, Jean Streff et Pierre Leroy. (Cf. Violences. Violences. Incestueuses)
Violences (Sade. Prix) (3) : (9 décembre) 2020. Je découvre, attirée par le titre Chienne, auréolé du prix Sade 2020, parmi les livres recommandés par France Culture, en appui de la série LSD intitulée. Viol : une histoire de domination sa présentation :
« Cette autofiction raconte une famille dans laquelle un père sadique et tout-puissant fait régner la terreur. Le projet est simple : décrire avec précision l’effroyable barbarie d’un homme qui roue sa fille de coups, qui la tient en laisse, qui la force à marcher à quatre pattes, à manger sous la table, sans que la mère [ne] s’interpose jamais. Personne ne s’étonnera si l’enfant, devenue grande, finit par mordre. » Descriptions toute sadiques de la violence du père, condamnation de la mère, annonce de la reproduction de la violence par la fille, qui elle, en réaction, devenue « chienne » : « mort ». (Cf. Femmes. Animalisation des femmes)
-------------
Violences (Sade. Robbe-Grillet Alain) : 1977. À la question posée : « Le principe du sadisme est de prendre du plaisir à faire souffrir ? on a vraiment du plaisir ainsi ? », Alain Robbe-Grillet [1922-2008] répond :
« Si l’on étudie la pratique des tortures mineures, par exemple le fouet à doses bénignes, on constate en effet que cela se fait couramment dans l’intimité pour le plus grand plaisir des deux partenaires. » 147 (Cf. Pornographie. Robbe-Grillet Alain, Tortures)
Violences (Sade. Sacher-Masoch Leopold von) : XIXème siècle. Léopold von Sacher Masoch [1836-1893] fut « profondément marqué par la violence des insurrections polonaises que son père (Préfet de police) dut réprimer en 1846 et 1848 […]. »
Toujours y penser lorsque l’on évoque le [sado]masochisme. 148
Par ordre chronologique. Violences. Sade. Philippe Sollers :
Violences (Sade. Sollers Philippe) (1) : (18 décembre) 2023 [Ière diffusion. 20 décembre 1990] Philippe Sollers [1936-2023], sur France Culture, interrogé sur le thème : Le paradis du langage, auteur de :
« Quand Sade nous dit, par exemple, quand Sade nous dit, dans un moment d’orgie - dans Juliette ou les prospérités du vice - curieux paradis que ce paradis du vice à côté duquel le paradis de la vertu peut faire triste figure - Là, renversement de perspectives - la vertu serait un enfer et le vice serait un paradis. Pourquoi pas ? Il faut analyser le vice, pas n’importe comment, le vice surmonté, pensé, devenu principe de pensée et d’écriture aussi, chez Sade qui n’a pas arrêter d’écrire. »
Encore un effort…
Violences (Sade. Sollers Philippe) (2) : (27 août) 2024. À la réécoute de la même émission, j’entends Philippe Sollers [1936-2023], juger Sade ainsi :
« C’est une expérience du langage poussée à bout. » (Cf. Langage)
-------------
Violences (Sade. Starobinski Jean) : (28 septembre) 1985. Jean Starobinski [1920-2019], auteur de :
« J’avoue ne pas partager l’engouement de beaucoup de mes contemporains pour Sade. Et peut-être y a-t-il de ma part quelque puritanisme ou quelque moralisme, bien Suisse Romand, à me tenir à distance de Sade. Je sais bien que Jouve [Pierre-Jean. 1887-1976] lui-même, aussi intéressé fut-il par tous les aspects de la sexualité, parlait de lui comme un être possédé par une névrose dure comme le fer.
Mais surtout, dans ce que je pourrais appeler ma philosophie de la relation, il y a un postulat essentiel qui est le respect de l’autre comme sujet. Or, Sade, c’est précisément la démonstration de ce qui advient lorsque l’autre est considéré comme un objet. […] » 149 (Cf. Penser. Postulat, « Sciences » sociales. Philosophie)
Violences (Sade. Surréalistes) : (17 avril) 2022. Tobia Bezolla, « historien de l’art », auteur de :
« Les surréalistes, pour eux, Sade, c’était comme l’idéal de la libération complète, de la révolution totale. » 150 (Cf. Politique. Révolutions)
Violences (Sade. Tulard Jean) : 2003. Jean Tulard, dans son Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs, auteur de :
- Concernant Jean Negulesco [1900-1993] : « Le même Negulesco sait être sadique dans Johnny Belinda (histoire du viol d’une sourde-muette) […]. »
- Concernant Paul Nicholas : « Formé par la télévision, Nicholas a compris le parti à tirer de l’univers carcéral féminin dans une perspective sado-masochiste. » 151 (Cf. Femmes. « Féminin », Violences. Viols. Tulard Jean)
Violences (Sade. Vaneigem Raoul) : 1967. Raoul Vaneigem, dans son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, auteur de :
« Je veux au passage saluer Sade. Il est par son apparition privilégiée à un tournant de l’histoire autant que par son étonnante lucidité [à ses désirs ?], le dernier des grands seigneurs révoltés. […] Marquis et sans culotte [?], D.A.F de Sade unit la parfaite logique hédoniste du grand seigneur méchant homme [Méchant ? C’est trop ou pas assez] et la volonté révolutionnaire de jouir sans limites d’une subjectivité enfin dégagée du cadre hiérarchique [pas celle de la domination masculine]. L’effort désespéré qu’il tente pour abolir le pole positif et le pôle négatif [les femmes ?] de l’aliénation le range d’emblée parmi les théoriciens les plus importants de l’homme total. [Ciel, Fuyons !] Il est bien temps que les révolutionnaires lisent Sade avec autant de soin qu’ils en mettent à lire Marx. [À dieu ne plaise…] » 152 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie. Vaneigem Raoul)
Violences (Sade. Winock Michel) : 2003. Je lis dans un livre publié par Michel Winock, Jeanne et les siens, alors qu’il se remémore sa vie d’enfant, sa mère, sa famille ouvrière habitant à Arcueil, autour des années 1940, il y évoque « la mémoire du regretté marquis de Sade qui y faisait subir en son temps d’autres supplices » 153 … [que ceux - considérés comme équivalents infligés aux étudiant-es, à la Maison des examens, elle aussi sise à Arcueil].
- Quand cesseront enfin ces réactions irréfléchies qui sont autant de légitimation de la violence, ici nommés pourtant par son auteur, sans ambiguïtés : « supplices », sans pour autant que ce terme ne délégitime le qualificatif de « regretté »
Par qui et pourquoi Sade devrait-il être regretté ? …
Pourquoi tant de d’éloges ?
Pour se justifier de qui, de quoi ?
Pour faire allégeance à qui ? à quoi ? (Cf. Langage, Patriarcat)
-------------
IV. Violences à l’encontre des enfants :
Par ordre alphabétique. Violences à l’encontre des enfants :
Violences à l’encontre des enfants (Anderson Hans-Christian Anderson) : (septembre) 2021. Je lis dans l’article d’Agathe Mélinand, Anderson, La rumeur de l’enfance, paru dans Le Monde Diplomatique [p.27] :
« Quand on le met en apprentissage, il est peut-être violé par les apprentis. C’est lui qui l’écrit. » Pourquoi ne pas le croire, pourquoi cette suspicion de mensonge ? Pourquoi aurait-il inventé un viol ? Comment peut-on inventer un viol ? Quelle est la légitimité de ce « peut-être » ?
Comme les mentalités, non interrogées, évoluent peu vite…
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. « Ballets roses » :
Violences à l’encontre des enfants (« Ballets roses ») (1) : (4 juillet) 1960. Pour Michel Leiris [1901-1990], dans son Journal « l’affaire des ‘Ballets roses’ […] montre que dans la France d’aujourd’hui l’on condamne ceux qui prennent du plaisir avec de petits rats [enfants] parfaitement consentants et qui y trouvent financièrement leur profit […]. » 154 Ici, la domination n’est pas même posée ; elle est niée par le postulat d’enfants a priori « parfaitement consentants » et légitimement intéressés par le « profit » [d’être violés par des hommes comme André Le Troquer] (Cf. Droit, Enfants, Hommes. « Politiques ». Irresponsables, Justice, Patriarcat, Penser. Consentement, Proxénétisme, Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Violences à l’encontre des enfants (« Ballets roses ») (2) : 2021. Lu sur Wikipédia :
« En 1959 éclate l'affaire dite des « ballets roses » André Le Troquer [1884-1963] - alors président du Sénat - mis en cause en compagnie notamment de sa maîtresse Elisabeth Pinajeff, artiste peintre et fausse comtesse roumaine adresse à l'hebdomadaire Aux écoutes du monde une lettre où il oppose aux « allégations publiées un démenti sans réserve, catégorique, absolu ». Poursuivi pour « attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse », il est condamné le 9 juin 1960 à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende (3. 000 francs) en relation avec l'affaire, alors que ses comparses sont punis bien plus lourdement (jusqu'à cinq ans de prison ferme). Le tribunal a tenu compte du « long passé de services rendus » par Le Troquer et n'a pas voulu « accabler un vieil homme. ». La condamnation est confirmée en appel le 3 mars 1961. » (Poursuivre)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Béjart Maurice) : 1977. Maurice Béjart [1927-2007], en réaction à une question concernant la dureté et la sévérité des professeur-es de danse, répond :
« Oui, les professeurs de danse étaient très sévères à cette époque-là [celle de son enfance]. Ils le sont encore, d’ailleurs par rapport aux autres. Moi, à l’époque où j’ai commencé la danse, mon professeur me battait. Et (je vais vous surprendre), je trouve que ce n’était pas si mal que ça ! Par exemple, un jour, à la barre, je ne prêtais pas vraiment attention à ce que je faisais. Mon professeur est venu par derrière. Je travaillais le jambes nues : il m’a envoyé un coup de badine sec. J’ai eu pendant un mois une raie noire sur la jambe et je me suis vraiment souvenu du pas que je ne comprenais pas. » 155
Violences à l’encontre des enfants (Bernanos Georges) : 1936. Georges Bernanos [1888-1948], dans le Journal d’un curé de campagne évoque [des] « marmots souillés, mais non corrompus ». 156
Je n’arrive pas à expliciter mon malaise… Ou, à l’écrire ?
* Ajout. 21 mai 2017. Quelques lignes plus loin, Georges Bernanos oppose des « maniaques inoffensifs » et « des fous dangereux » : ces oppositions binaires dont on sait aujourd’hui à quel point elles sont fausses et ont été si utiles pour légitimer les violences imposées aux enfants, nous permettent-elles de mieux appréhender le chemin parcouru, près de 80 ans après ?
Mais surtout de ne pas oublier toutes les violences justifiées, tous les adultes cautionnés dans leur bon droit et leur bonne conscience à détruire des enfants… Pour leur bien…
Violences à l’encontre des enfants (Bruckner Pascal, Finkielkraut Alain) : 1982. Lu, en note, dans Au coin de la rue, l’aventure, le livre de Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut ceci :
« L’ordre collectif ancienne manière ne renaît que pour faire la chasse aux amours pédérastiques. Lisez Quand Mourut Jonathan, très simple histoire d’une passion innocente et condamnée entre un jeune peintre et un enfant. C’est parce qu’il est un auteur absolument scandaleux que Tony Duvert [1985-2008] pu écrire un roman d’amour absolument classique. Il est, en tant que pédophile, l’héritier des grands mythes amoureux. Regrettez-vous ces temps barbares et lointains où la foi faisait violence à l’amour ? Désirez-vous connaître l’intensité des passions impossibles ? Une seule solution : éprenez-vous d’un(e) enfant. » 157 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Bruckner Pascal et Finkielkraut Alain, Penser. Mythe, Violences. Église catholique. Incestueuses. Mythe)
Violences à l’encontre des enfants (Buchenwald. 1945) : (printemps) 1945. Robert Debré [1882-1978], désigné [?] comme médecin, dans Témoignage. L’honneur de vivre, décrit ses ‘visites’ dans les camps de Buchenwald, Bergen-Belsen et Mauthausen. Il écrit notamment, sans s’interroger plus avant :
« À Buchenwald, nous fûmes reçus, si je puis dire, par une fanfare composée de mignons qui faisaient les délices des gardiens : ces garçonnets en uniforme se mettent en rang et veulent nous honorer en jouant un morceau de leur répertoire. » 158
Violences à l’encontre des enfants (Céline Louis-Ferdinand) : 1932. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, auteur de :
« (installé comme médecin) Comme malades, c’étaient plutôt des gens de la zone que j’avais, de cette espèce de village qui n’arrive jamais à se dégager tout à fait de la boue, coincé dans les ordures et bordés de sentiers où les petites filles trop éveillées et morveuses, le long des palissades fuient l’école pour attraper d’un satyre à l’autre vingt sous, des frites et la blennorragie. » 159 (Cf. Enfants, Filles, Hommes. Satyre)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles]. Édouard Durand :
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles] (1) : (20 novembre) 2021. Édouard Durand, co-président de la commission indépendantes sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants [CIIVISE], auteur de :
« Les enfants sont des gens sérieux. » 160 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (2) : (27 octobre) 2021. Premier avis de la CIIVISE [Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles] :
- « Prévoir la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant ».
- Suspendre les poursuites pénales pour non-représentation d’enfant contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses ».
- Prévoir dans la loi le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences incestueuses contre son enfant. »
Sans préjuger de la critique de fond, pourquoi cette ‘précaution de langage’ : « Prévoir » ? (Cf. Enfants. Durand Édouard, Violences. Incestueuses)
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (3) : (27 octobre) 2021. Premier avis de la CIIVISE [Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles] : Termes relevés dans ledit avis, selon moi, à proscrire :
« Cette réalité interroge l’autorité judiciaire et toute la société […], « faire reculer l’impunité des agresseurs », « injonction paradoxale », « protéger la mère, c’est déjà protéger l’enfant », « difficultés de la société et des professionnels à prendre au sérieux la parole des enfants et des femmes », « violences que l’on pourrait qualifier ‘de l’intime’ qu’elles soient conjugales ou sexuelles », « validation scientifique », « parent protecteur », « transgression gravissime de l’autorité parentale »… (Cf. Enfants, Durand Édouard, Justice. Impunité, Violences. Incestueuses)
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (4) : (19 novembre) 2021. Sur C à vous, Édouard Durand, président de la CIIASE [Commission indépendante sur l’inceste et les agressions sexuelles faites aux enfants] s’est réjoui en faisant état de victimes qui s’affirmaient comme « puissantes ».
Les victimes ne sont pas « puissantes » face à la justice. (Cf. Droit, Justice, Langage, Violences. Incestueuses)
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (5) : (31 mars) 2022. Le titre des Conclusions intermédiaires de la CIIVISE [Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles] (81p.) : Protéger les enfants, me gêne, puis brutalement me saute aux yeux. Il ne s’agit pas de ‘protéger les enfants’ - de qui, de quoi diable d’ailleurs ! - mais de dénoncer les agresseurs et ceux et celles qui en sont les alibis, - au premier chef, la justice -, de leur rendre justice, si cela est possible, de participer à la reconstruction d’un monde sans violences. (Cf. Enfants. Durand Édouard, Langage. Protéger, Violences. Incestueuses)
* Ajout. 5 juin 2022. Les policiers aussi, disent-ils, [nous] ‘protègent’. (Cf. Langage. Mots. Critique de mots : « Protéger », Politique. État. Répression)
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles] (6) : (10 mai) 2022. Édouard Durand, co-président de la commission indépendantes sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants [CIIVISE], auteur de :
« La protection des enfants n’attend pas. » Mais s‘agit-il « protéger » les enfants ? Non.
Et que pèse cette recommandation avec la bien ténue « lutte contre l’impunité de l’agresseur » ? au lieu et place de la lutte contre les agresseurs indissociable de la critique de la société patriarcale, du droit et de la justice qui les cautionnent et les justifient ? 161 (Cf. Justice. Impunité, Langage. Mots. Critiques de mots : « Protéger », Violences. Violences à l’encontre des enfants. Durand Édouard)
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (7) : (8 février) 2024. Je lis, sur Mediapart, la réponse d’Édouard Durand à cette question :
- « Comment analysez-vous votre éviction de la Ciivise ? »
- « C’est difficile pour moi de répondre à cette question, car je ne dispose pas des informations qui me permettent d’expliquer la décision qui a été prise. » [...]
« Si l’on regarde en arrière, on peut évidemment réprouver le choix de mettre fin à la Ciivise ».
Comment ne pas s’étonner de la faiblesse de la réaction d’Édouard Durand à son limogeage, qui confine ici à une quasi-caution ? Quel modèle pour les enfants, les adultes, qui ont le courage de dénoncer les violences dont ils sont victimes, alors que le gouvernement - sans autre fondement que de mettre fin à une initiative importante, positive, progressiste - l’a proprement, en le licenciant grossièrement, a fait cesser une expérience politique, dont il était certes l'incarnation, mais aussi le garant ?
Certes, il affirme - et c’est même le titre de l’interview - :
« L’arrêt de la Ciivise est vécu comme une violence, une trahison, un abandon », mais, par cette formulation, ne se défausse-t-il pas de sa responsabilité personnelle et, qui plus est, politique ?
Comment, dès lors, critiquer politiquement avec force ce par quoi le gouvernement a remplacé la CIIVISE, dont il ne pouvait méconnaitre qu’il s’agissait de la remise en cause radicale de ce qui avait été commencé ?
Violences à l’encontre des enfants [CIIVISE]. Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (8) : (7 mars) 2024. Sur France Culture, interrogé avec Judith Godrèche, dans une émission Le temps du débat, significativement nommée : « Quel relai pour les paroles libérées ? » sur la signification d’une « alliance avec les victimes », Édouard Durand affirme :
« D’abord, c’est protéger un enfant », puis : « L’alliance, c’est être du côté de la loi » pour préciser ensuite : « la réparation, c’est la justice et c’est le soin ». Et il conclut enfin encore plus clairement :
« Si nous ne pouvons pas respecter la loi, nous ne pouvons pas vivre en société ».
Qu’a donc « la loi » a à présenter à son actif en matière de lutte contre les violences à l’encontre des enfants, pour mériter le droit d’être respectée ? C’est indéfendable, inacceptable.
N.B. Poursuivre par l’analyse des 82 « Préconisations » de la CIIVISE. (Cf. Droit. Justice, Politique. Loi)
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Circoncision
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Circoncision. Franz Kafka :
Violences à l’encontre des enfants (Circoncision) (1) : (24 novembre) 1911. Franz Kafka [1883-1924] décrit précisément dans le Quatrième cahier de son Journal la « circoncision de son neveu » par un homme « qui a déjà 2.800 circoncisons à son actif ». 162 (Cf. Sexes. Hommes)
Violences à l’encontre des enfants (Circoncision) (2) : (25 novembre) 1911. Franz Kafka [1883-1924] décrit précisément dans le Quatrième cahier de son Journal, la « circoncision en Russie ». 163 (Cf. Sexes. Hommes)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Circoncision) (3) : (21 décembre) 1931. Michel Leiris [1901-1990], dans L’Afrique fantôme, auteur de :
« Les enfants d’un quartier de Kandi [Bénin] viennent d’être circoncis. Les uns, à peu près guéris, se promènent ; leur sexe couvert de mouches relevé par un petit trapèze de paille passant sous la racine. Un autre, tout petit, saigne encore et sanglote éperdument sur les genoux de sa mère, qui le berce et lui donne le sein pour le faire taire. Un autre, un peu plus grand, reste assis à terre, les jambes écartées, les yeux pleins de larmes, l’air hébété. Le bout de sa verge est recouvert d’un mélange de sang, de mouches et de poussière. » 164 (Cf. Sexes. Hommes)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Collège Stanislas) : (9 septembre) 2024. Je lis sur Franceinfo : « Jugé pour violence, l'ancien directeur de l'internat de l'établissement parisien Stanislas comparaît devant le tribunal correctionnel de Valenciennes (Nord) aujourd'hui, rapporte France 3. En février, le parquet avait listé les faits reprochés : ‘coups de cravache, coups de pied, claques derrière la tête, placages au sol, insultes, ainsi qu'une emprise psychologique’. » (Cf. Violences. Internat)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Comtesse de Ségur :
Violences à l’encontre des enfants (Comtesse de Ségur) (1) : 1861. Dans Pauvre Blaise de la comtesse de Ségur [1799-1874], je lis :
- « Le comte de Trénilly, concernant Blaise : « Je lui ferai donner le fouet par son père. » (p.68)
- Le comte de Trénilly au père de Blaise : « Anfry, si Blaise est coupable […] j’exige, sous peine de quitter mon service, que vous le fouetterez vigoureusement. » (p.71)
- Blaise à son père : « Merci, papa, de m’avoir bien défendu ; sans vous il m’aurait battu avec sa canne. »
- M. Anfry à Blaise : « S’il l’avait touché, j’aurais à l’heure même quitté son service [...]. » (p.85)
- Le comte de Trénilly à la fermière : « Je vous renvoie à Noël. Et quant à ces mauvais garnements, je leur apprendre à me respecter.
Et dégageant sa canne, il leur en donna quelques que coups : ‘Chacun son tour ; voici pour fourche, voilà pour le râteau !’
Les pauvres enfants se sauvèrent en criant ; la mère les suivit en murmurant et se félicitant d’avoir à quitter sous peu un si mauvais maître. » (p.116)
- Le comte de Trénilly à Blaise : « Blaise, ce que tu fais est très mal ; si tu recommences, je te ferai fouetter par mes gens. »
- Blaise : « Je n’ai rien fait de ce que dit M. Jules, Monsieur le comte ; je ne crois mériter aucune punition. Et quant à me faire fouetter par vos gens, ils n’ont pas le droit de me frapper et je ne me laisserai pas faire. » (p.137) 165
Violences à l’encontre des enfants (Comtesse de Ségur) (2) : 2022. Je lis dans le Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, concernant la comtesse de Ségur [1799-1874] :
« Pour dénoncer la brutalité de cet engrenage [présenté comme « le cycle de la violence » ], Ségur a trouvé un registre narratif : elle met en scène des personnages burlesques de femmes violentes, comme Mmes Fichini, Mac’Miche, Papofsky, Bonbeck, qui lui permettent de représenter l’extrême souffrance de l’enfant battu en neutralisant - par l’effet comique - l’impact du traumatisme sur le jeune lecteur [et de la jeune lectrice]. » 166
* Ajout. 9 septembre 2024. Analyse partielle : de nombreux hommes sont violents. De fait la violence et sa menace à l’encontre des enfants est partout, incessante.
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Charles Dickens :
Violences à l’encontre des enfants (Dickens Charles) (1) : 1850. Charles Dickens [1812-1870], dans David Copperfield, auteur de :
« Le plaisir qu’il [M. Creakle] éprouvait à détacher un coup de canne aux élèves ressemblait à celui que donne la satisfaction d’un appétit impérieux. Je suis convaincu qu’il était incapable de résister à un petit garçon potelé ; c’était une sorte de fascination qui ne lui laissait pas de repos jusqu’à ce qu’il l’eût marqué, tailladé toute la journée.
…] Et nous, misérables petits adorateurs d’une idole sans remords, avec quelle servilité nous nous abaissions devant lui ! Quel début dans la vie, quand j’y pense avec le recul, que de ramper à plat ventre devant un prétentieux de son acabit ! » (Lire la suite) 167 (Cf. Enfants. Éducation, Politique. Obéir)
Violences à l’encontre des enfants (Dickens Charles) (2) : 1861. Charles Dickens [1812-1870], dans Les grandes espérances, auteur de :
« Depuis cette époque, qui est assez reculée maintenant, je me suis souvent dit que peu de gens savent combien les êtres jeunes peuvent devenir secrets sous l’effet de la terreur. Peu importe que la terreur soit parfaitement déraisonnable, pourvu qu’elle existe. » 168 (Cf. Enfants. Injustice)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Doillon Jacques) : (9 octobre) 2024. Je lis, dans Le Canard enchaîné (p.6), dans la critique du livre de Mara Goyet, Jeu cruel [Robert Laffont. 2024] concernant Jacques Doillon et son film, La vie de famille [1985], dans lequel celle-ci, enfant, a joué, :
« ‘Mon premier travail avec un comédien, c’est de démolir ce qu’il a construit’, confie-t-il. Ce qui compte, c’est le résultat. La violence envers l’enfant, les très nombreuses crises de larmes qui en découlaient - ‘jamais feintes’ a-t-il admis - la nuit dans laquelle elle est plongée (rien ne lui est jamais expliqué), la réécriture permanente du scénario, en fonction de sa révolte, des phrases qu’elle prononce réellement dans la vraie vie, entre deux prises, tout cela relève du pilage, de la manipulation, et d’une forme d’abus (sic). […]
À l’époque, Jacques Doillon abordait cette question de la violence ‘artistique’ sur un ton des plus badins : ’On préfère toujours abîmer les enfants des autres.’ »
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Fiodor Dostoïevski :
Violences à l’encontre des enfants (Dostoïevski Fiodor) (1) : 1875. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans L’adolescent, auteur de :
« Pas une seule fois, il ne lui donna les verges (il avait bien trop peur, depuis l’autre fois). L’enfant était déjà dans l’épouvante. Il n’avait pas besoin de verges. » 169
Violences à l’encontre des enfants (Dostoïevski Fiodor) (2) : (juillet-août) 1877. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Journal d’un écrivain, dans le cadre du procès des parents Djounkovski, auteur de :
« On les [enfants] frappait avec des verges’ parait-il : mais qui ne frappe pas les enfants de verges ? Neuf-dixième de la Russie le font. » Et Dostoïevski en conclut :
« Impossible de faire relever cela de la loi pénale. » 170 (Cf. Droit, Justice, Politique. Lois)
Violences à l’encontre des enfants (Dostoïevski Fiodor) (3) : 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« Si tu vas à Tchermachnia, j’irais te retrouver, je t’apporterai un petit cadeau. Je t’indiquerai une fillette ; il y a longtemps que je l’ai repérée là-bas. Elle va encore nu-pieds. Mais ne crains pas les petites va-nu-pieds, ne les méprises pas. Ce sont des perles. » 171 (Cf. Enfants. Dostoïevski Fiodor, Femmes. Cadeau, Patriarcat, Proxénétisme)
Violences à l’encontre des enfants (Dostoïevski Fiodor) (4) : 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« […] Je l’affirme encore une fois : nombre des parents prennent plaisir à torturer les enfants et rien que les enfants. […] Envers les autres représentants de l’humanité, ces tortionnaires se conduisent en douceur. […] Ce qui tente précisément les bourreaux, c’est l’angélique confiance de l’enfant qui est sans défense, qui ne sait où aller, à qui s’adresser. Voilà ce qui allume le vilain sang du tortionnaire. Au fond de chaque homme se dissimile certainement une bête fauve, la bête de la colère, la bête de la volupté sadique que surexcitent les crimes de la victime, la bête des passions déchainées. […]
Imagines-tu ce petit être incapable encore même de comprendre ce qui arrive […]. » 172 (Cf. Politique. Animalisation du monde, Violences. Sade)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Dourov Pavel) : (4 septembre) 2024. Je lis dans Le Canard enchaîné (p.3) l’article : Les ennuis de son camarade de Telegram mettent Macron sur la touche que Pavel Durov, patron de Telegram est poursuivi par la justice française pour une douzaine d’infractions, dont « traite d’êtres humains, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans ». Il est ensuite précisé : « une affaire (sic) de viols de mineurs en ‘live streaming’ (en direct). « Une trentaine de de cas. » (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Pornographie)
Violences à l’encontre des enfants. Christian Dubreuil :
Violences à l’encontre des enfants (CIASE. Dubreuil Christian) (1) : (19 novembre) 2019. Témoignage de Christian Dubreuil à la CIASE [Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’église catholique], concernant les violences sexuelles, les crimes sexuels sur des enfants :
« C’est le crime par lequel l’auteur a presque toutes les chances que sa victime ne parle jamais ou en tout cas jamais dans la période pendant laquelle la société considère que les faits ne sont pas prescrits. Alors là aussi j’ai une formule - j’aime bien les formules - : ‘les muets parlent aux sourds’. Le muet c’est moi ; les sourds c’est vous et la société. Ceux qui ne peuvent pas parler rencontrent ceux qui ne veulent pas entendre. La victime ne peut pas parler de ces choses-là, du moins pendant longtemps, et la société ne veut pas entendre. Je pense que c’est lié au fait que l’indicible ne peut pas être dit et l’impensé ne peut pas être pensé. » (Cf. Droit. CIASE, Patriarcat. Église catholique, Penser, Politique)
Violences à l’encontre des enfants (CIASE. Dubreuil Christian) (2) : (19 novembre) 2019. Témoignage de Christian Dubreuil à la CIASE [Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’église catholique] concernant les violences sexuelles, les crimes sexuels sur des enfants :
« Je veux vous dire en préambule que j’ai confiance dans l’indépendance, la probité et la compétence du président Sauvé et des membres de la commission. Mais je formule les plus expresses réserves sur vos commanditaires. La CEF [Conférence des évêques de France] ne me paraît pas en situation d’enquêter sur les abus sexuels qu’elle a couvert pendant des dizaines d’années. Pour ma part, j’ai toujours réclamé publiquement depuis 2010 la création d’une commission enquête parlementaire et je le demande encore à l’Assemblée nationale car j’estime que c’est aux représentants de la Nation de traiter des comportements criminels dans la société. Je n’ai aucune confiance dans la capacité de l’Église catholique française de mener un travail de vérité sur 70 ans de pédocriminalité de masse en son sein. La déclaration des trois évêques que vous avez auditionnés me conforte totalement dans cette conviction. » (Cf. Droit. CIASE. Justice, Patriarcat. Église catholique, Politique. État, Histoire. Archives)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Éducation nationale) : (8 décembre) 2023. Écouter LSD, l’émission de France Culture : Harcèlement scolaire, le silences institutions.
Il existe des témoignages qui valent tant d’analyses, et qui, à eux seuls, seraient suffisants pour fonder des politiques.
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Église catholique :
Violences à l’encontre des enfants (Église catholique) (1) : (30 janvier) 1879. Gustave Flaubert [1821-1880], dans une lettre à Émile Zola [1840-1902], évoque « l’affaire du curé du Vésinet ». Dans une note de La Pléiade [2007], je lis :
« Le curé du Vésinet, le père Maret, venait d’être arrêté pour ‘attentats réitérés sur des enfants’, ‘à la sacristie, pendant le catéchisme’. L’évêque de Versailles avait refusé de recevoir la mère de la jeune fille par qui l’affaire avait éclaté. [Le Temps, 25 janvier 1879]. » 173
Violences à l’encontre des enfants (Église catholique) (2) : 2010. Christophe Roisnel, 43 ans, prêtre de la Fraternité Saint-Pie-Dix (catholiques intégristes), directeur d’une école (de la maternelle à la sixième) est poursuivi pour : les « viols et viols et actes de barbarie » de trois enseignantes. En 2010, après dénonciation par deux d’entre elles, « après une procédure canonique qui a conclu à ‘des actes sexuels sans fornication’ » - il utilisait « brosses à dent, ciseaux, et aiguilles à tricoter » - sa hiérarchie lui confie en 2013 « la direction d’une école de garçons où l’encadrement est assuré par des hommes. Six mois plus tard, il est écarté à cause d’un comportement équivoque avec des petits garçons. » 174 (Cf. Langage. Adjectif. Équivoque, Patriarcat. Église catholique, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Violences à l’encontre des enfants)
------------
Violences à l’encontre des enfants (« Fantasmes ») : 1919. Dans un texte de 19 pages de Freud [1856-1939], intitulé : Un enfant est battu, j’ai relevé 115 fois le mot : « fantasme ».
Le texte à l’avenant… (Cf. Langage. Mots, « Sciences » sociales. Psychanalyse. Freud Sigmund, Violences. Violences à l’encontre des enfants. Négation de l’inceste. Violences à l’encontre des femmes. « Fantasmes ». Violences. Violences à l’encontre des enfants. Violences. Incestueuses)
Violences à l’encontre des enfants. Fessée :
Violences à l’encontre des enfants (Fessée) (1) : (23 mai) 1869. George Sand [1804-1875], dans une lettre à sa belle-fille Lina Dudevant-Sand [1842-1901], auteure de :
« Moi je crois beaucoup que la manière de les prendre [les enfants] y est pour beaucoup. L’angélique madame Fleury croit à la fessée et elle en essaie. Il parait que cela amène des scènes inouïes. L’enfant se bat avec fureur avec elle. Beau résultat. » 175 (Cf. Enfants. Éducation)
Violences à l’encontre des enfants (Fessée) (2) : 1959. Lu dans un livre consacré aux « missions catholiques en milieu ouvrier » (dont les prêtres étaient communément nommés : les « prêtres ouvriers ») :
« Au pseudo-croyant, comme au pseudo convaincu de la mission, il faut administrer des preuves, mais un peu comme on administre une fessée à un gosse : il faut que ça lui entre dans la peau. » 176 (Cf. Corps. Peau, Famille. Mariage. Catholique)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Flaubert Gustave) : (5 août) 1860. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Ernest Feydeau [1821-1873] :
« Je commençais à trouver le temps long, et je me demandais si tu n’étais pas resté collé au fond de l’anus d’un môme oriental. » Puis il évoque le regret des « … sans poil ». 177 (Cf. Politique. Colonialisme)
Violences à l’encontre des enfants (France Culture) : (7 mai) 2024. Entendu dans l’émission Les enfants peuvent-ils parler ? de France Culture évoquer : « des effractions dans l’enfance par des hommes plus âgés. » (Cf. Enfance)
Violences à l’encontre des enfants (Galey Matthieu) : (3 octobre) 1970. Lu dans le Journal de Matthieu Galey [1934-1986] :
« Une semaine à Sidi-Bou-Saïd, de soleil, de bonheur. Les lauriers roses, les bougainvilliers, la mer, une ville, blanc et bleu ciel, les petits Arabes gidiens […] » 178
Que de violences cachées, légitimées … Ignoble. (Cf. Politique. Colonialisme)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. André Gide :
Violences à l’encontre des enfants (Gide André) (1) : 1923. À la relecture de mes notes du Journal d’André Gide, je retrouve, au cours notamment de l’année 1923, des références à ses relations avec des enfants. Mon malaise, mon dégoût, ma colère l’emportent sur mon désir de vérité, de dénonciation. En voici les dates cependant : 21, 29 juillet, 23 août 1923. (Cf. Enfants. Gide André)
Violences à l’encontre des enfants (Gide André) (2) : (1er novembre) 1939. Paul Claudel [1868-1955], dans son Journal, auteur de :
« J’achète le Journal d’André Gide [1869-1951]. […] Ce n’est pas qu’André Gide songe à dissimuler ses fautes, ses déficiences, ses vices ; la pédérastie, par exemple. Mais, petit à petit, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de fautes et de vices, c’est uniquement l’opinion qui les qualifie ainsi et qui est scandaleusement dans son tort. La pédérastie, par exemple ? quoi de plus noble ? quoi de plus recommandable ? ‘Arrange-toi toujours, a dit Kant, pour que la maxime de ton acte puisse être érigée en formule universelle’. Gide se proclame comme spécialement doué pour la formation de la jeunesse. » 179
Violences à l’encontre des enfants (Gide André) (3) : (26 juillet) 1941. Lu dans le Journal d’André Gide [1869-1951] :
« Je sors ravi de ce cours de danse de Catherine [sa fille. 1923-2013] auquel je viens d’assister. […]
Je serais maître de ballet, j’irais racoler sur la plage quelques-uns de ces petits Italiens (Français peut-être), au corps bronzé, que je contemplais hier sur la plage, dont j’admirais la nage élégante et rythmée. Entraînés à la danse, ils paraîtraient si provocants que, par souci des bonnes mœurs, on n’oserait plus les ‘produire’. » 180
Violences à l’encontre des enfants (Gide André) (4) : (3 août) 1942. André Gide [1869-1951], dans son Journal - il a 73 ans - se remémore « deux nuits de plaisir » vécues à Tunis en juin [1941] avec un jeune homme de 15 ans et qui « n’en parait pas davantage ». Je n’ai pas l’envie, le courage d’en reproduire le passage. Juste retranscrire ce qu’André Gide écrit : « Tout son être chantait merci. » 181
Dégoût, Honte… (Cf. Êtres humains. « Déchets », Enfants. Gide André, Politique. Colonialisme)
Violences à l’encontre des enfants (Gide André) (5) : (14 mars) 1948. Paul Claudel [1868-1955], écrit dans son Journal :
« Une bande sur l’immonde livre [?] d’André Gide [1869-1951] où il raconte ses prouesses pédérastiques porte la mention :
Prix Nobel 1947 » 182
Violences à l’encontre des enfants (Gide André) (6) : 2017. Éric Marty, éditeur du Journal d’André Gide [1869-1951], dans La Pléiade, auteur de :
« Aujourd’hui, Gide serait en prison. » 183
Une pensée critique claire, qui, libérée du refoulement, de l’hypothèque du non-dit, du conformisme littéraire si mal à l’aise concernant la dénonciation de ses vaches sacrées, peut alors s’autoriser une analyse ample, complexe, subtile. (Cf. Culture, Politique. Colonialisme)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Girard André) : 1894-1899. André Girard [1860-1942], dans - ce qui sera présenté comme son - Dictionnaire de l’anarchie [2021], dénonce ces « prêtres infâmes qui, tout en prêchant publiquement le mépris de la chair et de ses jouissances, l’abstinence, la chasteté et autres vertus chrétiennes, entraînent avec des exhortations d’amour en Jésus-Christ, de jeunes innocences à l’immonde souillure. » 184
Violences à l’encontre des enfants (Gramsci Antonio) : (5 mars) 1928. Antonio Gramsci [1891-1937], dans une lettre de prison à son épouse, après avoir évoqué deux procès à l’encontre d’un père et d’une mère en Italie au début du XXème siècle, « d’une épouvantable cruauté » poursuit, concernant les violences à l’encontre des enfants :
« Il y a là un type de crime qui, dans le temps, était considéré, dans les statistiques annuelles de criminalité comme une singulière exception. Le sénateur Garofalo considérait la moyenne de cinquante condamnations par an pour de tels délits comme la simple indication d’une tendance criminelle ; les parents coupables réussissaient le plus souvent à échapper à toute sanction, car l’habitude est de porter peu attention à l’hygiène et à la santé des bébés et il y a là un fatalisme religieux fort répandu qui porte à considérer comme une particulière faveur du ciel l’ascension de nouveaux petits anges à la Cour de Dieu. Cette croyance n’est que trop répandue ; et il n’y a rien d’étonnant à la retrouver encore ne serait-ce que sous des formes atténuées et adoucies dans les villes les plus avancées et les plus modernes. » 185
Analyse valable bien au-delà de l’Italie… (Cf. Droit, Enfants, Famille, Justice, Penser. Croyance, Violences Incestueuses. Gramsci Antonio)
Violences à l’encontre des enfants (Hugo Victor) : (6 septembre) 1897. L’Abbé Mugnier [1853-1944] écrit dans son Journal :
« Hier, Huysmans [Joris-Karl. 1848-1907] me contait que Victor Hugo [1802-1885] était jusqu’à la fin un colosse ‘libidineux’. Il montait sur les omnibus pour y ramasser des petites filles avec lesquelles il se satisfaisait. » 186
Violences à l’encontre des enfants (« Interdit de l’inceste ») : Le soit-disant « interdit de l’inceste » a contribué à sa perpétuation. Il a interdit de penser les violences incestueuses, de les voir, de les dire, de les dénoncer. (Analyse faible)
Violences à l’encontre des enfants (Lang Jack) : (30 mai) 2011. Luc Ferry sur Canal plus déclare, sans le nommer :
« Vous avez […] un ancien ministre que s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. »
- Dans Libération du 22 juillet 2011, j’apprends, toujours sans le nommer, qu’une enquête, concernant « les accusations de Luc Ferry », a été ouverte en France, le 1er juin 2011.
Où en est cette enquête ? Et s’agit-il bien de Jack Lang ?
N.B. « Poisser » : « Terme, considéré comme vulgaire, signifiant : attraper »
Violences à l’encontre des enfants (Langage) : (vers le 5 janvier) 1758. Ceux que Voltaire [1694-1778] qualifie dans une lettre adressée à Denis Diderot [1713-1784] de « prêtres sodomites » 187, nous les nommerions aujourd’hui « prêtres violeurs ; agresseurs d’enfants ». (Cf. Enfants, Langage, Sexes […], Violences à l’encontre des enfants. Prêtres)
Violences à l’encontre des enfants (Léautaud Paul) : (24 décembre) 1926. Paul Léautaud [1872-1956], dans son Journal littéraire, concernant André Gide [1869-1951] affirme que celui-ci a « toujours dédaigné les ‘honneurs vulgaires’, a toujours visé plus haut. » Mais il poursuit, plus précisément :
« Il semble bien qu’on ait voulu à un moment le décorer et qu’il a refusé discrètement, sans que personne ne le sache. Après cela, Gide est libre de coucher avec des petits garçons si cela lui plait, il est libre de le raconter si cela lui plait également. De là prétendre que c’est ainsi qu’on doit être ? … [je doute qu’André Gide ait écrit cela] non, non, non […] » 188 (Cf. Proxénétisme. Léautaud Paul)
Violences à l’encontre des enfants (Le Scouarnec Joël) : (4 mars) 2025. Lu sur Franceinfo : « L'accusé [Le violeur criminel de plus de trois-cents enfants] s'est montré loquace et a tenté d'expliquer son basculement dans la pédocriminalité. ‘Je me suis laissé envahir par cette perversion’, a déclaré Joël Le Scouarnec. ‘J'étais un chirurgien ayant un comportement normal. Et à côté, j'effectuais des actes pédophiles’, a-t-il soutenu. […]
L'accusé est revenu sur les violences sexuelles commises sur l'une de ses nièces, pour lesquelles il a été condamné en 2020. ‘C'était une gamine dissipée, elle était turbulente. Elle se faisait souvent gronder par ses parents et venait se réfugier vers moi. C'est là que j'ai commencé à avoir des gestes malencontreux’, a-t-il développé. Aujourd'hui, il assure ne plus avoir ‘aucune attirance d'ordre sexuel vis-à-vis des enfants’. ».
Tant que des termes, des expressions et de Franceinfo et de Joël Le Scouarnec, telles qu’ici lisibles, continueront à être employées, les violences se perpétueront. (Cf. Langage)
Violences à l’encontre des enfants (Levasseur Thérèse) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] évoque dans Les Confessions l’enfance de Thérèse Levasseur [1721-1801] :
« Thérèse était en proye à sa famille [la proie de] […] Il était singulier que la cadette des enfants de madame le Vasseur [Levasseur], la seule qui n’eut point été dotée était la seule qui nourrissait son père et sa mère, et qu’après avoir été longtemps battue par ses frères, par ses sœurs, même par ses nièces, cette pauvre fille était maintenant pillée sans qu’elle pût mieux se défendre de leurs vols que de leurs coups. » 189
On peut, dès lors sans grande crainte de se tromper, qu’elle fut battue aussi par ses parents. (Livre 7) (Cf. Enfants. Rousseau Jean-Jacques, Femmes. Mères. Levasseur Thérèse)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Loi :
Violences à l’encontre des enfants (Loi) (1) : (20 avril) 2016. Des député-es, lit-on ce jour, veulent interdire toute forme de violence faites aux enfants, mais « sans imposer de sanctions envers les contrevenants ».
« Il ne s’agit pas de mettre les parents en prison » mais de « poser une interdiction symbolique, éthique. »
Suivi, dans la dépêche de l’AFP, de :
« Quant à la ministre des familles et de l’enfance [Laurence Rossignol], elle a interdit de légiférer sur ce sujet sensible, préférant faire ‘la promotion d’une éducation sans violence’. » 190 (Cf. Politique. État. Lois)
Violences à l’encontre des enfants (Loi) (2) : (10 juillet) 2019. Après le deuxième alinéa de l'article 371-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
* Ajout. 19 mars 2022. Jean Noël Jeanneney, dans l’émission Concordance des temps de France Culture, Du fouet, de la gifle et de la fessée, l’analyse ainsi :
« L’État se mêle de l’intimité des foyers. » (Cf. Droit, Famille, Politique. État. Lois, Historiographie. Patriarcale. Jeanneney Jean-Noël)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Lou Andreas Salomé) : 1937. À deux reprises, Lou Andreas Salomé [1861-1937], dans Ma vie, livre qu’elle rédigea au terme de la sienne (entre 1931 et 1937, après donc ses échanges avec Freud), évoque les violences, enfant, à son encontre :
- « […] J’étais souvent une ‘vilaine’ petite fille et j’eus pour cette raison souvent à tâter d’une terrible baguette de bouleau, ce dont je ne manquais jamais de me plaindre avec ostentation au Bon Dieu. Il s’avérait qu’il était tout à fait de mon avis et il était même si courroucé que parfois, dans mes très rares moments de générosité [est-ce la bonne traduction du terme ?], je le priais instamment de laisser mes parents se servir de cette baguette. »
- « Encore toute petite, j’avais été momentanément dans l’incapacité de marcher à cause d’un mal passager appelé ‘maladie de croissance’ ; […] j’étais fière comme une reine d’être portée par mon père, à tel point que cela se termina mal : quand je cessais d’avoir mal, je me gardais bien de le signaler, et mon tendre père, le cœur lourd, mais inflexible, fit usage d’une bonne baguette sur cette même partie de mon corps qui s’était blottie dans ses bras. » 191 (Cf. Êtres humains, Enfants. Miller Alice)
Violences à l’encontre des enfants (Màrai Sàndor) : 1934. Sàndor Màrai [1900-1999], dans Les confessions d’un bourgeois, auteur de :
« (Hongrie, fin XIXème, début du XXème siècle) À cette époque, le châtiment corporel, méthode pédagogique universellement admise, faisait partie de l’emploi du temps de la journée, au même titre que les prières ou les devoirs supplémentaires. Le plus souvent, il s’agissait de gifles que rien ne motivait. Parents et éducateurs sacrifiaient ainsi à une sorte de rite obligatoire. » 192
Violences à l’encontre des enfants (M. le maudit) : 1931. Le film M. le maudit de Fritz Lang [1890-1976], se termine par cette dernière scène : Trois mères, en deuil, effondrées, s’adressent au tribunal où est jugé l’assassin des fillettes [Peter Lorre], arraché du tribunal de la pègre pour y être jugé par la loi :
« Il faudra d’avantage protéger nos enfants. »
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Gabriel Matzneff :
Violences à l’encontre des enfants (Matzneff Gabriel) : 1975. Lu dans Le Canard enchaîné :
« En 1975, à la télévision, l’écrivain Gabriel Matzneff, qui professe son goût pour les ‘jeunes personnes’ lance tranquillement : ‘Il y a beaucoup d’autres façons de pourrir un enfant que de coucher avec.’ » 193
N.B. Il m’arrive de le rencontrer près de chez moi : à chaque fois, je ressens un immense dégoût physique contre sa personne et une colère rentrée - que je ne peux lui exprimer - en pensant à toutes les vies qu’il a saccagées. En toute impunité, en toute injustice. Un beau salaud. (Cf. Justice. Impunité)
Violences à l’encontre des enfants (Matzneff Gabriel) (2) : (3 décembre) 2023. Francesca Gee dans Off Investigation, [You Tube] auteure de :
« Matzneff était protégé par des politiques, des éditeurs, des journalistes. ». Parmi les hommes cités : Georges Pompidou, François Mitterrand, Bernard Henri Lévy, Philippe Sollers, Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent, Emmanuel Pierrat, Christophe Gérard. Mais elle analyse bien qu’il s’agit d’un « réseau », terme que Gabriel Matzneff utilisait lui-même.
« Beaucoup restent encore à identifier » précise-t-elle justement, après avoir dit que les journaux dans lesquels Gabriel Matzneff donnaient les noms des personnes qui l’accompagnaient dans ses voyages, notamment pour acheter « des enfants pas cher » ont été retirés de la vente. Cet interview - remarquable - est, me semble-t-il le premier qui resitue pleinement l’homme dans son environnement politique.
- Cf. aussi son analyse parue dans Marianne le 24 octobre 2023 : « Le film ‘Le consentement’ banalise les images du viol. » (Cf. Culture, Hommes. Violents, Patriarcat, Politique, Violences. « Consentement »)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Mensonges) : (4 juin) 1998. Françoise Giroud [1916-2003], dans La rumeur du monde, raconte un déjeuner à la Maison des avocats, en présence de la nouvellement nommée Bâtonnière de Paris « afin de faire avancer les droits des enfants ». Et elle poursuit : … « encore considérés par nombre de magistrats comme automatiquement menteurs quand ils disent avoir été victimes de sévices, et singulièrement de pédophilie. » Et elle en conclut sans excès d’inquiétudes ni d’exigences :
« Donc, mieux écouter et protéger les enfants. Qui pourrait s’en désintéresser ? » 194
Quand la justice présentera-t-elle enfin ses excuses ? (Cf. Droit, Enfants, Famille, Hommes, Justice, Patriarcat)
Violences à l’encontre des enfants (Mœurs) : 1978. Lu : « J… 30 ans. […] « victime des faits de mœurs de la part de son père. » 195 (Cf. Langage. Mots. Critique de : « Faits », Politique. Loi. Mœurs)
Violences à l’encontre des enfants (Mirbeau Octave) : 1890. Octave Mirbeau [1848-1917] publie Sébastien Roque.
Violences à l’encontre des enfants (Montherlant Henri de) : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, rencontrant à Laghouat (Algérie) en 1942 (?), Claude-Maurice Robert [1895-1963], auteur de :
« […] Je ne fus qu’à demi étonné d’apprendre que Montherlant [Henri de. 1895-1972] n’éprouvait de bonheur que dans le commerce des petits Arabes, chasseurs d’hôtels, mitrons, marmitons ou employés de l’office qu’il appelait les officiers. Pour les dénicher, il écumait les tramways et les cinémas de quartier de Tunis à Alger et de Tlemcen à Colomb-Béchar, mais son vrai fournisseur était lui, Claude-Maurice Robert, qui me déballa un énorme amas de correspondance, dans laquelle, sous le nom de M. Millon ou de M. des Touches et avec la liberté de propos qu’on imagine, Montherlant demandait des adresse set des protections. Avec délectation, Claude-Maurice Robert me démolit mon idole de fond et comble […]. » 196 (Cf. Culture, Hommes. Grossiers, Politique. Colonialisme, Proxénétisme)
Violences à l’encontre des enfants. « Pédophile » :
Violences à l’encontre des enfants (« Pédophile ») (1) : Un « pédophile » signifie une personne qui aime les enfants. Remplacer par criminel. La permanence de l’emploi de ce terme : une caution politique d’un déni. (Cf. Famille, Langage, Politique)
Violences à l’encontre des enfants (« Pédophile ») (2) : (avril) 1898. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« Colombophile, il ne manque pas un tir aux pigeons. » 197
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. « Pédophile » :
Violences à l’encontre des enfants (« Pédophile ») (1) : (17 février) 2021. Dans l’émission d’Antoine Garapon Esprit de Justice, sur France Culture, intitulée : Dans la tête d’un pédophile, Florence Thibaut, psychiatre, auteure de :
« Il faut s'occuper des agresseurs et tenir les deux bouts : accompagner les victimes, leur donner les soins dont elles ont besoin, mais aussi les rassurer en s'occupant des agresseurs de manière à ce qu'ils ne récidivent pas. Ce qui est important dans la tête d'une victime, c'est l'idée que ça ne recommencera pas et qu'il n'y aura pas d'autres victimes… »
Comment mieux banaliser les crimes, mépriser les victimes, déresponsabiliser les criminels et les extraire de toute justice ? 198 (Cf. Justice, « Sciences » sociales. Psychiatrie)
Violences à l’encontre des enfants (« Pédophile ») (2) : (14 mars) 2021. Entendu sur France Culture l’expression de « pédophile abstinent ».
Vous avez parlé de « criminels », c’est hors sujet : ce sont ici des hommes qui « aiment » les enfants et qui décident de s’abstenir - comme pour l’alcool, le tabac - de se priver de leur plaisir de les « aimer ». La permanence de la violence… (Cf. Relations entre êtres humains. Aimer)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Pivot Bernard) : (mars) 1990. Bernard Pivot, responsable de l’émission Apostrophe emploie l’expression concernant Gabriel Matzneff de « collectionneur de minettes ». (Cf. Culture, Femmes. Jeunes filles, Langage, Patriarcat, Violences à l’encontre des enfants. Matzneff Gabriel)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Prêtres :
Violences à l’encontre des enfants (Prêtres) (1) : 2004. Pour mieux comprendre comment ces violences ont été cachées, occultées, sous-estimées, individualisées, naturalisées, renommées pendant si longtemps, lire ce dialogue entre Michel Tauriac [1927-2013] et Philippe de Gaulle [1921-2024], dans De Gaulle, mon père [1897-1970] :
« Certains biographes ont laissé entendre que votre père aurait probablement eu , à un moment, l’envie de se diriger vers le sacerdoce et que cette vocation religieuse avait été brisée par l’inconduite d’un prêtre…
- Il n’a jamais eu la moindre vocation religieuse. […] Qu’un prêtre ait dû quitter les jésuites lorsqu’il était chez eux, c’est possible. Ce genre d’accident peut arriver depuis que l’Église existe. Mais je ne crois pas que cela ait pu modifier en quoi que ce soit ses convictions de chrétien ou sa propre conduite. […] » 199 (Cf. Dialogues, Violences. Église catholique. Évêques, Violences à l’encontre des enfants. Église catholique)
Violences à l’encontre des enfants (Prêtres) (2) : (juillet) 2018. Encore 300 prêtres et plus de 1.000 enfants victimes en Pennsylvanie [États-Unis].
Un raz de marée mondial, et pourtant la face immergée de l’iceberg.
Je pense notamment parmi ces criminels oubliés, sauf par leurs victimes, aux prêtres des pays colonisateurs, dits « missionnaires », dans les pays ex-colonisés. (Cf. Violences. Église catholique. Évêques, Politique. Colonialisme, Violences. Victimes)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Prytanée) : 2001. Jean-Claude Brialy [1933-2007], dont le père était militaire, fut pensionnaire au Prytanée à la Flèche en 1946. Il avait alors 13 ans et dans Le ruisseau des singes, il raconte :
« L’école était dirigée par un colonel et chaque compagnie par un capitaine et un lieutenant. Il y avait des sous-officiers, adjudants ou adjudants chefs et des sergents qui faisaient régner l’ordre et la discipline, sans aucune différence entre les enfants et les soldats. Lors de la deuxième année [en 1947], les conditions de scolarité s’étaient durcies. Les punitions et les brimades pleuvaient sur nous et les bizutages par les plus grands étaient fréquents. Nous eûmes droits aux humiliations les plus variées, de la bite au cirage aux coups de ceinturons en passant par l’enfermement au cadenas dans des armoires en fer. » Et aujourd’hui ? 200 (Cf. Politique. Guerre. Tortures, Violences. « Bizutages ». Violences à l’encontre des femmes. « Bizutages »)
N.B. « Le Prytanée national militaire est l’un des six lycées de la Défense français ». [Wikipédia]
Violences à l’encontre des enfants (Radio Libertaire) : (7 avril) 2025. Entendu sur Radio Libertaire [Organe de la Fédération anarchiste] la chanson, chanté par un autre, de Léo Ferré [1916-1993], Ah ! petite, dont voici de larges extraits :
« Tu as des yeux d'enfant malade / Et moi j'ai des yeux de marlou / Quand tu es sortie de l'école / Tu m'as lancé tes p'tits yeux doux. Et regardé pas n'importe où
Tu as le col d'un enfant cygne / Et moi j'ai des mains de velours / Et quand tu marchais dans la cour / Tu t'apprenais à me faire signe / Comm' si tu avais eu vingt ans
Tu as le buste des outrages / Et moi je me prends à rêver / Pour ne pas fendre ton corsage / Qui ne recouvre qu'une idée / Une idée qui va son chemin
Ah ! Petite Ah ! Petite / Tu peux reprendre ton cerceau / Et t'en aller tout doucement / Loin de moi et de mes tourments / Tu reviendras me voir bientôt / Tu reviendras me voir bientôt
Le jour où ça ne m'ira plus / Quand sous ta robe il n'y aura plus / Le Code Pénal » (Cf. Politique. Anarchisme, Patriarcat, Sexes. Hommes)
Violences à l’encontre des enfants (Réunionnais en France) : Un garçon Réunionnais - violé par l’homme qui, avec son épouse, l’avait « adopté » - concernant son « silence », auteur de :
« J’aurais reçu des coups de pieds au cul des gendarmes si j’avais voulu porter plainte. » 201 (Cf. Enfants. Crime d’État, Famille, Justice, Politique. État. Répression, Violences. Viols)
Violences à l’encontre des enfants (Rhénanie. Nord-Westphalie. 2020) : (29 juin) 2020. Lu sur Franceinfo : « Les autorités allemandes ont annoncé enquêter sur 30.000 personnes suspectées d'activités pédophiles sur internet. Je ne m'attendais pas, même de loin, à l'ampleur des [violences sur des] enfants sur le net » s'est alarmé le ministre de la justice de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, où le scandale a éclaté à l'automne dernier.
Tant que l’on parlera de « scandale », d’ « activités pédophiles » et, ici, strictement limitées ... (Cf. Langage. Mots. Critique de : « Scandale »)
Violences à l’encontre des enfants (Foyer (sic) de Riaumont) : (20 novembre) 2024. Je lis dans l’article du Canard enchaîné de Sorj Chalandon (p.7) présentant le film d’Ixchel Delaporte et Rémi Bénichou, Les enfants martyrs de Riaumont, concernant le père Revet [1917-1986] :
« ‘J’avais mal partout. À l’endroit où…Vous avez compris ?’murmure Jean ; ‘Il m’embrassait sur la bouche et mes caressait les parties’, avoue (non) Djamal’ ». ‘Il m’avait demandé de la fouetter, et puis il m’a violé’ confie Brunon, le visage défait. »
Après la mort du père Drevet, « les filles en sont victimes à leur tour. ‘Tout ce que le prêtre me demandait de faire, je le faisais, raconte Isabelle qui avait huit ans. » […]
En 2005, Romain, 14 ans, harcelé par les prêtres parce qu’il se lamentait, s’est pendu sur le terrain de sport, après avoir supplié qu’on le ‘sorte de là’. » (Cf. Hommes, Famille, Politique. Religion, Sexes […])
Violences à l’encontre des enfants (Roland Madame) : Jeanne-Marie Roland [1754-1793], dans ses Mémoires particuliers, se souvient de cette « scène » de sa vie, advenue à la veille de sa première communion :
« Une circonstance, trop importante par son influence sur mon moral pour que je doive le passer sous silence, vint se mêler à mes inquiétudes et m’inspirer une grande résolution (celle de l’écrire ?).
Je suis un peu embarrassée de ce que j’ai à raconter ici, car je veux que mon récit soit chaste, et pourtant ce que je dois dire ne l’est pas trop.
Elle raconte alors qu’elle se rendait régulièrement dans l’atelier de son père [« maître graveur »] et évoque l’un de ses élèves, « un garçon de 15 à 16 ans », le plus jeune et pour lequel sa mère avait « pour lui, plus de bontés ».
« Il en résultait de là que je le regardais comme moins étranger que les autres, et que j’avais avec lui de cette sorte d’aisance et de familiarité très convenables à l’innocence et pourtant très dangereuse pour elle. » […]
Un soir que j’y allais pour chercher quelque chose, et que le jeune homme paraissait travailler seul à la lampe, je m’approche pour recevoir ce que je demandais : il prend ma main comme en jouant, et la tirant sous l’établi près duquel il était, il me fait toucher quelque chose de très extraordinaire. Je fais un cri en m’efforçant de la retirer. Il se met à rire sans la relâcher, en criant tout bas : ‘Mais, paix donc ! De quoi avez-vous peur ? Quelle folie ! Est-ce que vous ne me connaissez pas ? Je ne suis point un méchant ; vous allez faire venir madame votre mère qui me grondera pour votre frayeur, et je ne vous aurais appris que ce qu’elle connaît bien’.
Agitée, mais interdite, je demandais ma main et voulais m’en aller ; il laisse retirer ma main en la retenant toujours avec la sienne et, faisant un demi-tour sur son siège, met à ma vue l’objet de ses frayeurs.’ Je tourne la tête. ‘En vérité, monsieur, cela est horrible !’ Et je me débattais pour fuir. - Eh bien mademoiselle, apaisez-vous. Je suis fâché de vous avoir déplu. Pardonnez-moi. Ne dites rien ; je n’avais pas l’intention de vous mettre en colère. Y a-t-il donc du mal à laisser voir ce que les dessins montrent tous les jours ? Mais soyez libre et faites-moi punir - Eh, mon dieu ! je ne dirais rien ; laissez-moi donc aller’. Sa main relâche la mienne et je m’échappe. Je fuis dans mon cabinet toute émue ; à peine avais-je eu le temps d’y entrer que j’entends la voix de ma mère qui m’appelle. […]
Mes jambes tremblaient sous moi.
[…] J’eus beaucoup de peine à débrouiller dans ma tête ce que cette scène y avait laissé ; chaque fois que je voulais y songer, je ne sais quel trouble importun me rendait la médiation fatigante. Au bout du compte, quel mal m’avait-il fait ? Aucun. Irais-je parler de cela ? Le seul embarras de savoir comment m’y prendre m’en aurait gardée ? Devais-je lui en vouloir ? Cela paraissait douteux. Et puis la comparaison avec les dessins me semblait fautive, cela m’étonnait ; la curiosité venait s’en mêler, et ses petites inquiétudes dissipaient ma mauvaise humeur. Je fus plusieurs jours sans retourner dans l’atelier. […] » Lire la suite. (Cf. Enfants. Filles, Femmes. Remarquables. Roland Jeanne-Marie, Sexes. Hommes)
Violences à l’encontre des enfants (Roy Claude) : 1983. Claude Roy [1915-1977], dans Permis de séjour. 1977-1982, se souvient de :
- « Marcel Ponce […] Il n’était pourtant pas, dans la bande des élèves de première, puis de philo, de la race des brimeurs, ni de celle des fils à papa. Il avait la réputation du meilleur latiniste des terminales, du vrai fort en thème. Il passait les ‘récrés’ et les études un livre perpétuel à la main. Mais la terreur que nous inspiraient ceux qui nous tordaient le bras pour nous arracher le chocolat du goûter, le prestige de ceux qui allaient déjà au café, couraient les bals du samedi soir et conquéraient les filles (ou la faisaient croire) rejaillissaient sur lui. Même si parmi les ‘grands’, il était autrefois le plus doux et le moins arrogant, il faisait malgré lui partie de la caste des ‘maîtres’ et nous inspirait, comme des camarades, le respect effrayé qu’imposent les seigneurs à la piétaille. »
- « Raymond Rapelin : […] Ce qui surgit […], c’est une horreur intacte et une haine aussi aiguë qu’au premier jour. Rapelin, le grand Rapelin, faisait régner sur les petits, dont j’étais, une terreur sans trêve, Il surgissait en blouse grise dans la cour, armé de grandes mains prêtes à tordre les bras, de grands pieds impatients de cogner dans les tibias, toujours prompt à prélever sur les ‘petits’ sa rançon de réglisse zan et de bouchés au chocolat, à humilier les doux, à faire s’agenouiller les faibles à force de tortures. Rapelin, Raymond, qui passait le temps des classes à se masturber au dernier rang, c’est la première image du Mal que j’ai dévisagée. […] » 202 (Cf. Enfants. Internat)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. George Sand :
Violences à l’encontre des enfants (Sand George) (1) : 1854. George Sand [1804-1876], dans Histoire de ma vie, évoquant les violences exercées sur elle par sa bonne, Rose, auteure de :
« […] Elle commença à me brutaliser. […] La tempête de sa voix et l’abondance des épithètes injurieuses […] ébranlaient mon système nerveux. […] J’étais battue, assez doucement d’abord, et comme par mesure d’intimidation, peu à peu plus sérieusement, par système de répression, et enfin, tout à fait par besoin d’autorité et par habitude de violence. Si je pleurais j’étais battue plus fort ; si j’avais eu le malheur de crier, je crois qu’elle m’aurait tuée, car lorsqu’elle était dans le paroxysme de la colère, elle ne se contrôlait plus. Chaque jour l’impunité la rendait plus rude et plus cruelle. […]
Pourquoi aimais-je cette fille au point de me laisser opprimer et briser à chaque instant ? C’est bien simple ; c’est qu’elle aimait ma mère. […]
Je m’habituais donc à l’humiliation de mon esclavage et j’y trouvais l’aimant d’une sorte de stoïcisme naturel dont j’avais besoin pour pouvoir vivre avec une sensibilité de cœur trop surexcitée. J’ai appris de moi-même à me roidir contre le malheur. […]
Je trouvais ma vengeance dans mon héroïsme et dans le pardon que j’accordais à ma bonne. Je me guindais même un peu pour me rehausser vis-à-vis de moi-même dans cette lutte de la force morale contre la force brutale. […]
Je ne reviendrai plus sur cet insipide sujet ; qu’il me suffise de dire que pendant trois ou quatre ans je ne passai guère de jours sans recevoir à l’improviste quelque horion qui ne me faisait pas toujours grand mal, mais qui chaque fois me causait un saisissement cruel et me replongeait, moi nature confiante et tendre, dans un roidissement de tout mon être moral. » 203 (Cf. Enfants. Éducation. Sand George, Relations entre êtres humains. Vengeance, Justice. Impunité)
Violences à l’encontre des enfants (Sand George) (2) : (13 septembre) 1868. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Sylvanie Arnould-Plessy [1819-1897], évoque « les bons ignorantins qui violent les petits garçons par centaines. » Et, en note, je lis :
« Quelques affaires récentes d’attentats à la pudeur commis par des frères des écoles chrétiennes avaient sensibilisé l’opinion. » 204 (Cf. Droit. Langage)
Violences à l’encontre des enfants (Sand George) (3) : (23 juillet) 1872. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Adrien Hébrard [1833-1914], auteure de :
« Vous croyez aux statistiques, cher monsieur ? Y avez-vous trouvé le chiffre des scandales volontairement étouffés, des crimes passés sous silence ? Non, ceux -là ne comptent pas, et ils sont innombrables dans le clergé. Si les statistiques en mettent davantage sur le compte des instituteurs laïques, c’est qu’on les poursuit ceux-là, et que pendant tout l’empire, on n’a poursuivi chez les autres que ceux qu’on ne pouvait pas faire disparaître. Et le clergé fait si facilement disparaître ses membres d’une localité pour les mettre dans une autre ! Non, non je n’ai rien exagéré et je ne me paye pas de chiffres officiels, je crois ce que je vois et je vous trouve heureux de ne pas voir. »
- Le contexte : George Sand avait écrit :
« … Je vois comme tout le monde peut le voir, les funestes et les honteuses conséquences du célibat des prêtres. Qu’ils se marient, qu’ils ne confessent plus ! » Et pour reprendre la note de Georges Lubin [1904-2000], Hébrard, directeur d’un journal libéral protestant La lutte qui ne voulait pas attaquer sur un pareil terrain les catholiques, lui avait écrit :
« N’y a-t-il pas une exagération de pensées et de termes dans le passage concernant des attentats sur les enfants par des religieux ? » 205 (Cf. Violences à l’encontre des enfants. CIIASE)
-------------
Violences à l’encontre des enfants (Trump Donald) : (20 juin) 2018. Suite à la politique de fermeture des frontières américaines décidée par Donald Trump ayant pour conséquences de séparer environ 2000 enfants, y compris des enfants de moins de 5 ans, de leurs parents, 206, l’article de Libération intitulé Enfants Migrants. Trump face à la honte présente une image des contradictions - et le terme est faible - des décisions incohérentes et terrifiantes de Donald Trump. (Cf. Enfants. Trump Donald, Hommes. « Politiques ». Trump Donald, Famille, Politique. Frontières. Médias)
Violences à l’encontre des enfants (Vallès Jules) : 1879. Dédicace de Jules Vallès [1832-1885], dans Jacques Vingtras (publié sous le pseudonyme de Jean La Rue), :
« À tous ceux qui crèvent d’ennui au collège, ou qu’on fit pleurer dans la famille, qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents. » (Cf. Êtres humains, Enfants)
Toute sa vie, Jules Vallès dénonça les violences innombrables, incessantes, dont il fut la victime ; toute son oeuvre en est marquée, pétrie.
Violences à l’encontre des enfants (Viot Abbé Michel) : (5 juin) 2022. L’abbé Michel Viot, sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite), lequel avait publié avec Yohan Piquart un livre intitulé : Le rapport Sauvé : une manipulation ? évoquant ceux qu’il nomme « les abuseurs », emploie, pour nommer les violences à l’encontre des enfants « viols » nommément cités inclus, l’expression : « avoir une attitude incorrecte avec des jeunes enfants ».
Violences à l’encontre des enfants (Zola Émile) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« (Concernant Lequeu, l’instituteur, qui était « dur avec les femmes ») Depuis quelques mois, sa situation se gâtait dans la commune. Il avait toujours été rude est grossier à l’égard des enfants, qu’il renvoyait d’une claque au fumier paternel. Mais ses emportements s’aggravaient, il s’était fait une vilaine histoire avec une petite fille, en lui fendant l’oreille d’un coup de règle. Des parents avaient écrit pour qu’on le remplaçât. » 207
-------------
V. Violences à l’encontre des enfants. Infanticides :
Par ordre alphabétique. Violences à l’encontre des enfants. Infanticides :
Infanticides (Beccaria Cesare) : 1744. Cesare Beccaria [1738-1774], dans Des délits et des peines, auteur de :
« L’infanticide est le résultat inéluctable de l’alternative où est placée une femme qui a succombé par la faiblesse ou qui a été victime de la violence.
Entre la honte et la mort d’un être incapable d’en ressentir les atteintes, comment ne choisirait-elle pas ce dernier parti plutôt que d’être exposée, avec son malheureux enfant, à une misère certaine ?
La meilleure manière de prévenir ce délit serait de protéger par des lois efficaces la faiblesse contre la tyrannie, qui accuse bien haut les vices qu’on ne peut pas couvrir du manteau de la vertu. » […] 208
Écrit donc il y a près de quatre siècles. Que n’a-t-il été entendu !
- Rarement - sinon jamais - cité dans les éloges de Beccaria. (Cf. Enfants, Hommes, Patriarcat, Politique. Lois. Vertu, Violences. Violences à l’encontre des enfants. Violences à l’encontre des femmes)
Infanticides (Chine. Shanghai) : Années [19]50. Lu dans le livre de Chow Ching Lie, Le palanquin des larmes. Dans la chine de Mao, l’échappée d’une femme :
« Avant la prise de pouvoir communiste, la municipalité de Shanghai avait un service de voirie spécial constitué de voitures chargées du ramassage régulier de cadavres abandonnés. En ce qui concerne les cadavres d’enfants, les statistiques des années trente à quarante en mentionnaient de cinq à six mille par ans. Une organisation protestante, la Société de Bienfaisance de Shanghai s’était spécialisée dans la recherche de bébés non désirés qu’on trouvait enveloppés dans des chiffons ou de vieux journaux. On parvenait à en réanimer quelques-uns. D’autre part, l’orphelinat de la Société de Bienfaisance comportait une sorte de ‘boite à bébés’ [En France, elles étaient nommées « tours »] qui permettait à ceux [et celles] qui ne voulaient pas de leur progéniture d’éviter de les tuer en les déposant dans la boîte. Cela fait, on tirait une clochette et quelqu’un venait recueillir l’enfant sans demander d’explication. »
L’article 13 de la loi de mai 1950 promulguée par Mao Tse Toung [1893-1976] posait :
« Il est strictement interdit de noyer les nouveaux nés ou de commettre d’autres crimes similaires. » (Cf. Corps. Cadavres, Droit, Femmes. Charité, Relations entre êtres humains. Bienfaisance, Famille, Patriarcat) 209
Infanticides (Frédéric II) : (11 octobre) 1777. Frédéric II [1712-1786] écrit à Voltaire [1694-1778] pour lui faire part de ses idées concernant la justice pénale ; il affirme notamment qu’il « valait mieux empêcher et prévenir les crimes que de les punir. »
Il poursuit, après avoir précisé qu’en 1777, il n’y a eu « que quatorze, tout au plus, quinze arrêts de morts » [5.220.000 habitants en Prusse, la France en comptant alors 20 millions] et que « personne ne peut être arrêté sans ma signature, ni personne justifié, à moins que je n’ai ratifié la sentence :
« Parmi ces délinquants, la plus part sont de[s] filles qui ont tué leurs enfants, peu de meurtres, encore moins de vol de grands chemins. Mais parmi ces créatures qui en usent si cruellement envers leur postérité, ce ne sont que celles dont on a pu avérer le meurtre qui sont exécutées. J’ai fait ce que j’ai pu pour empêcher ces malheureuses de se défaire de leur fruit […] Il y des maisons dans chaque province, où elles peuvent accoucher, et où l’on se charge d’élever leurs enfants. […]
Je suis même maintenant occupé de l’idée d’abolir la honte jadis attachée à ceux qui épousaient des créatures qui étaient mères sans être mariées ; je ne sais si peut-être cela ne me réussira pas. […] » 210 (Cf. Droit, Justice, Enfants. Fruits, Femmes. Mères, Patriarcat. Hommes. Pères, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Infanticides (Histoire) : (5 octobre) 1979. Une intervenante (non nommée) lors du colloque organisé par Choisir : Choisir de donner la vie, auteure de :
« Quand on fait de l’infanticide une pratique des femmes pauvres, seules et misérables, et en tout cas les historiens hommes font ce travail-là et je crois qu’on peut citer Monsieur Flandrin [Jean-Louis. 1931-2001] parmi ceux-là, on crée parallèlement l’image de la femme mariée, honnête et bonne, et essentiellement bonne mère, c’est à dire, celle qui ne tue pas son enfant. » 211 Pas faux, mais rapide ? (Cf. Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Infanticides (Kafka Franz) : (2 juillet) 1913. Franz Kafka [1883-1924], dans le Huitième cahier de son Journal, auteur de :
« Sangloté à chaudes larmes en lisant le compte rendu du procès d’une certaine Marie Abraham, 23 ans, qui poussée par la misère et la faim, a étranglé sa fille Barbara, âge de presque neuf mois, avec une cravate d’homme qui lui servait de jarretière. Histoire très schématique. »
N.B. « Dans la rubrique judiciaire du Prager Tagblatt du 2 juillet 1913. La femme infanticide avait été acquittée et les jurés avaient collecté 60 couronnes pour lui venir en aide. » 212
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Infanticides. Mères :
Infanticides (Mères) (1) : 2014. Comment une société, une justice…peuvent-elles oser condamner une femme, souvent une toute jeune fille, alors qu’elle a porté l’enfant d’un autre pendant neuf mois, si souvent seule à elle-même, et à laquelle n’a été présentée d’autre alternative que celle d’être réduite à tuer son propre enfant, à sa naissance ?
* Ajout. 15 octobre 2014. Une jeune lycéenne de 18 ans, ayant accouché seule dans l’appartement où elle vivait avec sa famille, a « jeté » le bébé « né viable » par la fenêtre :
« Elle dit qu'elle a eu un trou noir. Elle se souvient d'avoir tenu l'enfant mais ne sait plus ce qui s'est passé après. » Elle a été mise en examen pour « homicide sur mineur de moins de 15 ans, placée sous mandat de dépôt et écrouée ». 213 Dernière touche de l’ignominie, on lit, dans cet article, ce constat qui valait condamnation, que « dans l'après-midi [après l’accouchement] » elle est ensuite allée « faire du shopping dans un centre commercial avec sa mère et sa sœur. »
Il n’est question dans cette dépêche ni de son père, ni du père du bébé, pas plus que de la responsabilité de quiconque. Coupable, absolument seule coupable, en prison, toujours seule, quelques jours après avoir accouché. À 18 ans. (Cf. Femmes. Accouchements. Mères. Seules, Famille. Mariage, Justice)
Infanticides (Mères. Esclavage) (2) : 1840-1850. Lu dans Les Lettres sur l’esclavage ‘écrites entre 1840 et 1850, de l’Abbé Casimir Dugoujon [?-?] :
« En passant par le Pointe-à-Pitre, j’ai rencontré dans la rue une sorte de rassemblement ; l’arrestation d’une négresse qui venait de noyer ses deux petits enfants à elle y avait donné lieu. Le capitaine du bateau qui m’a transporté à la Basse Terre m’a beaucoup parlé de ce tragique évènement. Il m’a dit que la mère a noyé ses deux petites créatures dans un endroit où il n’y avait presque autre chose que de la vase ; qu’elle les a retenues sous ses genoux jusqu’à ce qu’elles soient asphyxiées, et qu’elle-même se serait noyée si on n’était pas arrivé assez à temps pour l’en empêcher. Quel motif, demandez-vous, a pu porter une mère à une action si atroce ? On ne m’a rien dit de précis sur ce point, et les interrogatoires qu’elle a subis n’ont rien produit de clair. Quant à moi, je pense que ce double infanticide est le fruit de l’amour maternel mal entendu. La négresse du P. Dutertre refusa de devenir épouse de crainte de devenir mère, disant : ‘Je me contente d’être misérable dans ma personne, sans mettre au monde des enfants qui seraient peut-être plus malheureux que moi et dont les peines me seraient plus sensibles que les miennes propres.’
Celle-ci, ayant eu le malheur de devenir mère, a cru que le plus grand service qu’elle pouvait rendre à ses enfants serait de leur arracher la vie que son sein maudit leur avait donnée. » […] (Pour la suite, lire la note 1.) 214 (Cf. Patriarcat. Vécu du. Papadiamantis Alexandre)
-------------
Infanticides (Michelet Jules) : 1863. 2014. Jules Michelet [1798-1874], dans La sorcière, nommait l’infanticide : « le crime monastique ». 215
* Ajout. 4 juin 2014. Lu dans Le Monde :
« Près de 800 squelettes de bébés découverts dans un ancien couvent en Irlande ».
Et, dans Le Figaro (même date) :
« Les restes de 800 enfants localisés dans une fosse commune en Irlande. Ledit couvent était ‘géré’ par les Sœurs catholiques du Bon Secours qui ‘accueillait’ des ‘filles mères et leurs bébés nés hors mariage’. » (Cf. Femmes. Avortements, Bons Pasteurs, Famille)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des enfants. Infanticides. Pères :
Infanticides (Pères) (1) : Depuis des siècles, il est postulé que le père de l’enfant n’est pas concerné par l’infanticide de la mère. Le terme n’est d’ailleurs que rarement employé lorsque les pères assassinent leurs enfants ; il est vrai que ‘leur’ femme est souvent alors, elle aussi, assassinée. Et lorsqu’il tue femme et enfants, le terme d’infanticide est rarement employé. (Cf. Famille, Langage, Patriarcat. Pères)
Infanticides (Pères) (2) : (18 décembre) 2014. Une mère a été condamnée à 15 ans de prison pour infanticide. Elle est accusée d’avoir tué un enfant de 2 mois et d’avoir frappé son autre enfant, un an plus tard, victime de plusieurs fractures. À la fin de la dépêche de l‘AFP, il est écrit :
« Le père, un militaire d'un régiment de Dieuze (Moselle), avait, pour sa part, fini par accuser sa compagne lorsqu'il avait été entendu par les enquêteurs, en affirmant qu'elle aurait été ‘capable’ de se livrer à des violences sur leurs enfants. » 216 (Cf. Patriarcat. Pères)
Infanticides (Pères) (3) : (20 décembre) 2014. En Australie, une mère, accusée d’avoir tué sept de ses huit enfants, âgés de 18 mois à 15 ans, ainsi qu’une de ses nièces, a été arrêtée. Voici, pour toute analyse, la fin de l’article du Figaro :
« Le compagnon de la femme, qui ne serait pas le père des enfants, vit au même domicile, selon Sky News Australia dont la présentatrice a fondu en larmes à l'annonce de ce fait divers. » 217 (Cf. Patriarcat. Pères)
-------------
Infanticides (Procès. Tunisie) : 1914. Annie Goldmann, dans Les filles de Mardochée. Histoire d’une émancipation, évoquant la vie de trois générations de femmes juives Tunisiennes, évoque sa grand-mère mère, Juliette, née en 1880, première avocate Tunisienne, qui, autour de 1914 (mais sans date précise), « avait fait gagner (acquitter) une femme qui avait tué son bébé parce qu’elle n’avait pas de mari ». 218 (Cf. Femmes. Grands-mères, Justice. Procès, Justice. Patriarcale, Histoire)
Infanticides (Revendications) : Ne plus jamais condamner, envoyer en prison une jeune femme qui, accouchant seule, tue à la naissance l’enfant qu’elle a mise au monde. Je n’ai pas actuellement en tête les arguments qui fondraient, qui légitimeraient cette revendication, mais je la ressens sinon comme juste, du moins comme relevant de la simple humanité, pour ne pas employer le terme plus faible et politiquement plus critiquable [?] de compassion. Qui, en effet en imaginant - faute de pouvoir entendre, de pouvoir écouter ces femmes - les conditions dans lesquelles celle-ci ont été enceintes, puis ont accouché, peut prétendre à autre chose que de tenter d’abord de les comprendre ? Si tel était le cas, il faudrait alors poser toutes les responsabilités qui seules expliquent cette naissance, et ce, à tous les niveaux où elles doivent l’être. Mais, à y réfléchir plus avant, la nécessité de la condamnation de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes ne s’explique-t-elle justement pas par ces refus de poser les questions politiques et morales concernant ces ‘crimes’ ? Il faut les condamner par effet, par nécessité de cache, et ce d’autant plus il s’agit bien d’un ‘crime’ dans l’immense majorité des cas, commis par les seules femmes. (27 octobre 2014) (Cf. Droit, Femmes. Enceintes, Patriarcat)
* Ajout. 10 mars 2016. Peut-on employer le même terme : « infanticide » pour une mère qui, le plus souvent seule, y compris à en subir les immenses conséquences sa vie durant, dans le bouleversement que représente un accouchement, tue, à la naissance, un nouveau-né - qui faisait partie d’elle-même, qui était elle-même quelques instants auparavant - et le meurtre, l’assassinat d’un enfant ? Non. (Poursuivre)
Par ordre chronologique. Infanticides. Léon Tolstoï :
Infanticides (Tolstoï Léon) (1) : (11mars) 1879. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans ses Carnets :
« Sur la route, trois errantes. Du district de Mikhaïlovskoïè. L’une a eu onze enfants, il en est resté un seul. Le dernier, elle l’a étouffé en dormant, avant le Trinité. Le beau-père et le mari ne l’ont pas injuriée, ils disent : ‘Il est mort de lui-même’. ‘Je vais prier pour mes péchés. Et peut-être que le père Jonas [Archimandrite du monastère des Cavernes à Kiev] dira que je ne l’ai pas étouffé en dormant, qu’il est mort de lui-même.’ » (Cf. Enfants. Tolstoï Léon, Femmes. Mères. Patriarcat. Pères)
Infanticides (Tolstoï Léon) (2) : 1889. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La sonate à Kreutzer, auteur de :
« Ce sont les filles de mauvaise vie et les femmes de soldat qui jettent leurs enfants dans un étang ou dans un puit […]. » 219 (Cf. Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
-------------
Par ordre chronologique. Infanticides. Émile Zola :
Infanticides (Zola Émile) (1) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’assommoir, auteur de :
« Une histoire d’infanticide les révolta également ; mais le chapelier [Lantier], très moral, excusa la femme en mettant tous les torts du côté de son séducteur ; car, enfin, si une crapule d’homme n’avait pas fait un gosse à cette malheureuse, elle n’aurait pas pu en jeter un dans les lieux d’aisance. » 220 (Cf. Femmes. Enceintes, Hommes. Irresponsables. Séducteurs, Justice. Patriarcale)
Infanticides (Zola Émile) (2) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« En effet, ces messieurs passaient de la politique à la morale. Ils écoutaient Duveyrier donner des détails sur une affaire dans laquelle on avait remarqué son attitude. On allait même le nommer Président de chambre et officier de la légion d’honneur. Il s’agissait d’un infanticide remontant déjà à plus d’un an. La mère dénaturée, une véritable sauvagesse, come il disait, se trouvait être précisément la piqueuse de bottines, son ancienne locataire, cette grande fille pâle et désolée, dont le ventre énorme indignait M. Gourd [le concierge]. Et stupide avec ça ! car sans s’aviser que ce ventre la dénoncerait, elle s’était mise à couper son enfant en deux, pour le garder ensuite dans une boîte à chapeau. Naturellement, elle avait raconté aux jurés tout un roman ridicule, l’abandon d’un séducteur, la misère, la faim, une crise folle de désespoir devant le petit qu’elle ne pouvait nourrir ; en un mot, ce qu’elles disaient toutes. Mais il fallait un exemple. Duveyrier se félicitait d’avoir résumé les débats avec cette clarté saisissante, qui parfois déterminait le verdict du jury.
- Et vous l’avez condamnée ? demanda le docteur.
À cinq ans, répondit le conseiller […]. Il est temps d’opposer une digne à la débauche qui menace de submerger Paris. » 221 (Cf. Corps. Ventre. Femmes, Hommes, Justice. Jury. Procès. Patriarcale, Penser. Morale, Violences à l’encontre des femmes)
-------------
VI. Violences à l’encontre des enfants. Violences. Incestueuses :
Violences. Incestueuses (dans l’attente d’une formulation appropriée) :
Violences. Incestueuses (1) : « Inceste » : terme évacuant toute idée même de violences, de viols. C’est là son avantage essentiel.
- Évoquer « un père incestueux » ? Non : « un père ayant violé sa fille ».
Peut être vanté sur France Culture sans provoquer de réaction du Parquet.
- Entendu (19 août) 2012 :
« Une relation incestueuse qui se transforme en viol. »
- Entendu (25 janvier) 2023 :
« Elle était issue d’une mère qui venait d’un inceste. »
Violences. Incestueuses (2) : Pour parler de « crimes » d’inceste, supprimer les termes d’infractions, de relations sexuelles, de rapports incestueux, de faits, d’évènement, d’affaires. Comme de violences… (Poursuivre) (Cf. Langage. Mots)
Violences. Incestueuses (3) : « La réalité », est-ce le mal-dénommé « inceste » ou le, dès lors, mal dénommé « interdit de l’inceste » qui ont tant et si mal interrogé les ethnologues ? (Cf. « Sciences » sociales. Ethnologie)
Par ordre alphabétique. Violences incestueuses :
Violence. Incestueuses (Beck Robert) : 1969. Robert Beck (alias Iceberg Slim) [1918-1992], dans Pimp. Mémoires d’un maquereau, auteur de :« [...] Jusqu’à 12 ans, je n’ai que des bons souvenirs […]. Mon père avait toujours été gentil et généreux. […] Mais après la mort de Maman, il a très vite changé. Il a descendu mon lit au rez-de-chaussée. Il me disait qu’il voulait que je dorme avec lui, qu’il se sentait tout seul dans son lit après toutes ces années passées avec Maman. Au début, il ne s’est rien passé de spécial. Et puis, un mois plus tard, j’ai fait un cauchemar. J’ai rêvé qu’un animal féroce me suçait les seins. C’était horrible Je me suis réveillée en sursaut. C’était Papa. J’ai hurlé. Il m’a envoyé une gifle. Son visage était convulsé dans une expression de haine. On aurait dit un fou, un fou que je ne reconnaissais plus. Je me suis évanouie. Quand j’ai repris connaissance, Papa pleurait et me suppliait de lui pardonner. Au bout de quelque temps, je me suis résignée, je restais immobile, insensible, pendant qu’il se servait de moi. Je le haïssais de tout mon cœur. À l’école, j’avais l’impression absurde que les autres élèves voyaient ma honte, qu’ils voyaient à quel point j’étais répugnante. Quand j’ai eu quinze ans, je ressemblais à un squelette. À l’époque il me faisait faire tout ce qu’il voulait. Je suis vraiment contente qu’il soit mort et en enfer. Mon père, ce salaud, me tuait à petit feu. [Elle s’évanouit et se retrouve, enceinte, à l’hôpital. Puis, elle quitte son père] […] » Puis… 222 (Cf. Proxénétisme)
Violence. Incestueuses (Dolto Françoise) : 1979. Échanges entre Françoise Dolto [1908-1988] et la revue Choisir :
« Choisir : Mais enfin, il y a bien des cas de viol ?
Françoise Dolto : « Il n’y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes. »
- Choisir : Quand une fille vient vous voir et qu’elle vous raconte que, dans son enfance, son père a coïté avec elle, que lui répondez-vous ?
Françoise Dolto : « Elle ne l’a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l’aimait et qu’il se consolait avec elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l’amour avec lui. » […]
- Choisir : D’après vous, il n’y a pas de père vicieux et pervers ?
Françoise Dolto : « Il suffit que sa fille refuse de coucher avec lui, en disant que ça ne se fait pas, pour qu’il la laisse tranquille. »
- Choisir : Il peut insister ?
Françoise Dolto : « Pas du tout, parce qu’il sait que l’enfant sait que c’est défendu. Et puis le père incestueux a tout de même peur que sa fille en parle. En général, la fille ne dit rien, enfin pas tout de suite. » 223 (Êtres humains. Pervers, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
Violences. Incestueuses (Ferré Léo) : 1967. Entendu ce jour sur Radio Libertaire 224 une chanson ignoble de Léo Ferré [1916-1993] intitulé Petite et dont le premier couplet était :
« Tu as des yeux d'enfant malade / Et moi j'ai des yeux de marlou / Quand tu es sortie de l'école / Tu m'as lancé tes petits yeux doux / Et regardé pas n'importe où / Et regardé pas n'importe où » et le dernier était :
« Ah ! Petite, Ah ! Petite / Tu peux reprendre ton cerceau / Et t'en aller tout doucement / Loin de moi et de mes tourments / Tu reviendras me voir bientôt / Tu reviendras me voir bientôt / Le jour où ça ne m'ira plus / Quand sous ta robe il n'y aura plus / Le Code pénal ».
Et cette « Petite » fut suivie d’une autre chanson dont le refrain, répété, était :
« On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre… et les cuisses de la fermière » : étant rajouté in fine - au nom de l’égalité, sans doute …- « et les cuisses du fermier, alors !» dit par ailleurs sur une haute fausse voix d’un supposé homosexuel.
- Les anars, les libertaires tapent avec aisance et souvent si justement sur tout le monde (ou presque) ; peu, sinon jamais, sur la si grossière et si conservatrice, réactionnaire, phallocratie régnant en leur sein, assumée avec si peu d’inquiétudes. Aujourd’hui, pour moi, odieuse.
- Quant à briser leur admiration (si peu critique) pour une malheureuse chanson… (Cf. Culture, Langage, Patriarcat)
Violences. Incestueuses (Gramsci Antonio) : 1934. Antonio Gramsci [1891-1937] cite une enquête parlementaire faite en 1911 concernant le Sud de l’Italie (Les Abruzzes et la Basilicate) selon laquelle « on trouve l’inceste dans 30 % des familles » et il poursuit :
« Il ne semble pas que cette situation ait changé jusqu’à ces dernières années. » 225 (Cf. Enfants, Famille, Justice)
Violences. Incestueuses. Langage :
Violence. Incestueuses (Langage) (1) : Un-e enfant-e n’est pas « né d’un inceste » : il / elle est l’enfant d’une mère violée par son père (ou grand père, ou…) (Cf. Langage)
Violence. Incestueuses (Langage) (2) : (30 novembre) 2014. Lu dans une Faculté :
« Les incesteurs incestent [...] ». (Cf. Langage. Verbe)
Violences. Incestueuses (Langage) (3) : (26 juin) 2015. Lu dans Le Figaro :
« Elle aimait son papa, mais pas au point qu’il l’inceste. L’inceste avec papa, c’est pas vrai. » 226
De la signification politique, notamment, de l’emploi d’un verbe intransitif. Et ce, aggravé par la réalité du terme d’ « inceste » qui, en lui-même n’est porteur d’aucun jugement de valeur, n’est signifiant d’aucune violence, d’aucun rapport de domination. (Cf. Langage)
Violences. Incestueuses (Langage) (4) : (2 octobre) 2023. Entendu sur France Culture :
« Son grand-père l’avait incestée [ou incestuée ?] ».
J’inceste, tu incestes, il ou elle inceste… (Cf. Langage. Verbe)
-------------
Violences. Incestueuses (« Lolita ») : 1955. Lolita, dans le livre du même nom [Vladimir Nabokov. 1897-1977], auteure de :
« Le mot juste est inceste. » 227
* Ajout. 19 février 2018. Lors de l’émission de France Culture intitulée, Écrire l’amour, La rencontre, deux personnes, à la suite l’une de l’autre, affirment, sur un même ton laissant peu de doutes à la véracité de leur jugement, que Lolita est « le plus grand roman d’amour du XXème siècle », et ce, sans grand rapport avec le sujet supposé de l’émission. 228 (Cf. Langage. Mots)
* Ajout. 11 décembre 2023. J’apprends que le jet privé d’Harvey Weinstein était nommé : Lolita express. (Cf. Patriarcat. Weinstein Harvey)
Violences. Incestueuses. Mythe :
Violences incestueuses (Mythe) (1) : L’interdit de l’inceste : un mythe, donc faux. Cette assertion légitimée, avec tant de légèreté et tant d’assurance, par tant d’ethnologues, de psychanalystes, a eu pour effet, sinon pour fonction, d’en cacher la réalité, d’en détourner l’attention, d’invalider la parole des victimes, de perpétuer le pouvoir des agresseurs. (Cf. Penser. Mythe, Patriarcat, « Sciences » sociales. Ethnologie. Psychanalyse)
Violences. Incestueuses (Mythe) (2) : La pseudo règle-universelle-de-l’inceste présuppose que l’interdit soit respecté. Par ailleurs si le père ne devait pas épouser sa fille, rien n’interdise qu’il ne la violât ; et ce d’autant plus aisément que le système familial - patriarcal - est fondé sur l’appropriation des femmes et ne confère pas de statut à l’enfance. (Cf. Êtres humains, Enfants, Femmes, Famille, Patriarcat, « Sciences » sociales. Ethnologie. Lévi-Strauss Claude. Psychanalyse)
-------------
Violence. Incestueuses (Négation. Bettelheim Bruno) : 1981. Bruno Bettelheim [1903-1990], dans L’amour ne suffit pas, auteur de :
« Priscilla […] osa ajouter des plaisanteries de type anal et sexuel à son verbiage. […] Elle parlait, par exemple, très souvent, d’hommes qui attaquent les femmes par derrière.
Ces propos furent entendus dans le dortoir par Lucille (une fillette de 7 ans). Quand celle-ci entendit ces ‘obscénités’ exprimées sans que personne n’intervint pour punir, cela l’encouragea à exprimer, elle aussi, ses propres craintes. […]
L’éducatrice rassura tout d’abord Lucille, affirmant qu’elle était à l’Institution en toute sécurité et qu’il ne lui arriverait aucun mal. Puis elle expliqua à Priscilla que sa description d’une attaque violente et douloureuse par derrière n’était pas une image réelle et qu’elle était en train d’interpréter faussement les sentiments éprouvés pendant les rapports sexuels dont elle avait été vraisemblablement le témoin. » (Lire la suite, en comparaison avec « les chiens qui dans la rue, se livrent à des jeux sexuels. »)
Il évoquera ensuite, « les obsessions anales de l’enfant », puis « un fantasme sadique ». (Cf. Violences. Sade) 229
Par ordre chronologique. Violences. Incestueuses. Négation. Sigmund Freud :
Violence. Incestueuses (Négation. Freud Sigmund) (1) : 1943. Sigmund Freud [1856-1939], dans Ma vie et la psychanalyse, auteur de :
« Avant d’aborder l’exposé de la sexualité infantile, il me faut faire mention d’une erreur dans laquelle je tombai pendant quelques temps et qui aurait pu bientôt être fatale à tout mon labeur. Sous la pression de mon procédé technique d’alors, la plupart de mes patients reproduisaient des scènes de leur enfance, scènes dont la substance était la séduction par un adulte. Chez les patientes, le rôle de séducteur était presque toujours dévolu au père. J’ajoutais foi à ces informations (sic) et ainsi je cru avoir découvert, dans ces séductions précoces de l’enfance, les sources de la névrose ultérieure. Quelques cas, où de telles relations au père, à l’oncle ou au frère aîné, s’étaient maintenues jusqu’à un âge dont les souvenirs sont certains, me fortifiaient dans ma foi (sic). A quiconque secouera la tête avec méfiance devant un telle crédulité je ne puis donner tout à fait tort, mais je veux mettre en avant que, c’était alors le temps où je faisais exprès violence à ma critique (sic) afin de demeurer impartial et réceptif (sic) face à de nombreuses nouveautés que m’apportait chaque jour. Quand je dus cependant reconnaître que ces scènes de séduction n’avaient pas eu lieu, qu’elles n’étaient que des fantasmes imaginés par mes patients, imposés à eux peut être par moi-même, je fus pendant quelque temps désemparé. […] Lorsque je me fus repris, je tirai de mon expérience les conclusions justes ; les symptômes névrotiques ne se reliaient pas directement à des évènements réels, mais à des fantasmes de désir : pour la névrose la réalité psychique avait plus d’importance que la matérielle. […]
Cette erreur dissipée, le chemin était libre pour étudier la sexualité infantile. »
Et c’est dans cette incroyable confusion intellectuelle et absence de toute rigueur que Sigmund Freud - et ses poursuivant-es - récusa ce que ses analysées lui avaient transmis, à savoir les violences sexuelles dont elles avaient été victimes. 230
N.B. Lire Marie Balmary, L’homme aux statues : Freud et la faute cachée du père [Grasset. 1994]. (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse, Violences à l’encontre des enfants. Fantasmes)
Violences. Incestueuses (Négation. Freud Sigmund) (2) : 2012. Jeffrey Masson, auteur de :
« […] « Pendant des années, Freud [1856-1939] a pensé que ses patientes avaient été victimes d'abus sexuels pendant leur enfance. Devenues femmes, elles enduraient les séquelles de ce traumatisme. Il a appelé ‘théorie de la séduction’ l'hypothèse suivant laquelle ces souffrances (il utilisait le terme ‘hystérie’) étaient la conséquence de traumatismes sexuels précoces. Nous savons depuis les années 1980 que ce n'est pas seulement une hypothèse, mais une triste réalité qui affecte la vie de très nombreux enfants.
Puis, quelque part entre 1897 et 1903 (date de la première rétractation publique de l'hypothèse de la séduction), Freud a changé d'avis. Ces abus, affirmait-il, n'ont pas eu lieu et ne sont que le fruit de l'imagination, des ‘pulsions’, de fantasmes d'abus traduisant un désir inconscient. Ainsi, l'adulte était innocent. Ou du moins c'est ce qu'il se disait. Cette nouvelle doctrine a autant plu aux confrères de Freud que la précédente leur avait déplu.
Ce revirement a permis à Freud de sortir de son isolement professionnel et de connaître la gloire. Des années plus tard, Freud a déclaré que la psychanalyse troublait le sommeil du monde. Possible.
Pourtant, en niant la réalité des traumatismes sexuels, Freud a permis au monde de garder les yeux clos sur ce point...
Pourquoi s'est-il rétracté ? Les psychanalystes, en accord avec de nombreux critiques de la psychanalyse, avancent que c'est parce qu'il a compris que ses patientes n'avaient en fait jamais subi d'abus sexuels.
Mon livre raconte une tout autre histoire : contrairement à ce qu'il affirmait publiquement, Freud a longtemps continué à croire en la réalité des abus sexuels. J'ai eu la chance qu'Anna Freud, sa fille, me laisse lire des lettres de Freud à Fliess [Wilhelm. 1858-1928] jusque-là tenues secrètes, qui démontrent sans équivoque ce que Freud pensait. Pourquoi est-il passé de ‘je crois les enfants’ à ‘je crois que les enfants inventent des histoires’ ? Nous n'aurons sans doute jamais de réponse définitive.
Pour ma part, je crois que Freud s'est trouvé dans une position trop inconfortable vis-à-vis de ses collègues, et de toute la société Viennoise d'ailleurs. Il aurait fallu un courage formidable pour demeurer du côté des victimes innocentes face à leurs agresseurs, un courage que personne n'avait jamais eu à cette époque. […] » 231 (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse)
-------------
Violences. Incestueuses (Pères) : Combien de viols incestueux, tapis dans l’ombre, sous couvert d’ « attachement excessif au père » ? (Cf. Langage, Relations entre êtres humains. Attachement, Patriarcat. Pères)
Violences. Incestueuses (Saint Phalle Niki de) : 1994. Niki de Saint Phalle [1930-2002], dans un livre intitulé Mon secret [Éditions de la Différence], auteure de :
« Ce même été, mon père, il avait 35 ans, glissa sa main dans ma culotte comme ces hommes infâmes dans les cinémas qui guettent les petites filles. J’avais 11 ans […] » Après avoir évoqué les viols qui suivirent, elle écrit :
« Mon père avait sur moi le terrible pouvoir de l’adulte sur l’enfant. J’avais beau me débattre, il était plus fort que moi. Mon amour pour lui se tourna en mépris. Il avait brisé en moi la confiance en l’être humain. Que cherchait-il ? Là aussi, ce n’est pas simple. Le plaisir, il pouvait le trouver ailleurs. Non ! C’est l’interdit et c’est la tentation d’un pouvoir absolu sur un autre être qui exerçait une fascination vertigineuse sur lui. Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c’est affirmer qu’on existe envers et contre tout. […] » 232 Tout lire. (Cf. Culture. Patriarcale, Êtres humains, Femmes. Artistes. Saint Phalle Niki de, Patriarcat. Pères)
Violences. Incestueuses (Talmont Virginie) : 2004. Virginie Talmont, dans Inceste. Récit, auteure de :
« […] Quelle souffrance… Qui comprendra que c’est au policier, au juge, à celui qui écoute, de lever le boucler et de dire : ‘Oui, petit, je t’ai entendu, ta parole a du prix à mes yeux. Je te crois. Je vais t’aider. On va te sortir de l’horreur ’. »
Mais tout le livre est à lire, de la première à la dernière page, en se laissant le temps de réfléchir, sinon à chacune d’entre elles, du moins à celles qui vous font ouvrir plus grand, les yeux, l’intelligence. 233 (Cf. Penser)
Violences. Incestueuses (Voltaire) : (vers le 31 août) 1750. Ne pas oublier parmi les amantes de Voltaire, Marie-Louise Denis [1712-1790], sa nièce, concernant laquelle il avait écrit au duc de Richelieu [1696-1788] :
« Je la regarde comme ma fille. » 234
-------------
VII. Violences à l’encontre des femmes :
Violences à l’encontre des femmes :
Violences à l’encontre des femmes (1) : Cette formulation qui, un temps, s’avéra une grande avancée, s’est révélée, insuffisante, inappropriée ; en effet, elle n’évoque que des victimes (nommées) ; dès lors, faute de nommer les auteurs, elle peut justifier que ces violences soient une succession d’effets sans cause. On comprend mieux dès lors que, sous ce couvert, dans cette confusion, tant d’analyses, tant de [projets de] lois les ont confortées. 235
Par ailleurs, en aucun cas, il n’est possible de considérer que des lois présentées comme devant lutter contre les violences faites aux femmes puissent être synonymes de lois concernant « la violence de genre ».
La loi espagnole de 2004 «relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre», si souvent vantée notamment par les féministes françaises (mais l’ont-elles vraiment, précisément, rigoureusement lue ?) est une loi extrêmement dangereuse [au spectre d'autant plus large que le terme de «genre» ne veut rien dire et ne peut donc être défini] laquelle, entre autres innombrables critiques, enferme toutes les femmes dans un statut juridique spécifique, hors champs de la loi commune, du droit commun…
Violences à l’encontre des femmes (2) : On a dit : « Mort aux juifs » et hommes, femmes et enfants juifs furent tués. On ne dit pas « Mort aux femmes », mais les femmes sont néanmoins tuées. Partout.
Violences à l’encontre des femmes (3) : L’assassinat est la preuve ultime, la seule irréfutable, du pouvoir du meurtrier sur sa victime.
Violences à l’encontre des femmes (4) : Vivre avec un homme violent, c’est vivre sous la menace ; ce n’est pas vivre.
Vivre avec lui sans la craindre et/ou en espérant qu’il s’amende - ce qui revient au même - c’est accroitre le danger, et donc la probabilité d’être tuée.
Violences à l’encontre des femmes (5) : (18 septembre) 2019. Vu, rue Saint Jacques / carrefour rue du Sommerard, sur un grand panneau, collé sur le mur, écrit à la main, ce slogan :
« Honorons les mortes, Protégeons les vivantes. »
« Honorer, Protéger » : Où est l’indignation, l’analyse, le projet ? Qui sont les responsables ?
* Ajout. 23 octobre 2019. Même endroit :
« Macron parle. Les féminicides continuent ».
Effacé le lendemain par la Mairie de Paris.
* Ajout. 23 octobre 2019. Vu au carrefour rue des Anglais / rue Donat :
« On ne veut plus compter les mortes »
* Ajout. 20 mars 2020. Vu rue de Cluny :
« Tu n’as de droit sur aucune femme » Deux jours après, le 6 dernières lettres du slogan étaient soigneusement rendues illisibles.
- Le 6 mai 2020. « sur aucune femme » a été repeint et est dorénavant à nouveau lisible.
* Ajout. 18 juin 2020.
« Vivement le matriarcat »
« Le monde meurt, les femmes aussi »
* Ajout. 22 juin 2020.
« Coupe. Coupe, les coucounettes des violeurs »
* Ajout. 26 juin 2021.
« 90 % des victimes de viols connaissent leurs agresseurs ». Rendu quasi illisible.
Violences à l’encontre des femmes (6) : La dénonciation des auteurs ne doit pas contribuer à passer sous silence les résistances de leurs victimes.
Violences à l’encontre des femmes (7) : Pourquoi ne s’est-elle pas défendue ? dit le premier. Elle n’avait qu’à se défendre, dit le second. Si elle s’était défendue, j’aurais compris, dit le troisième.
Violences à l’encontre des femmes (8) : Pourquoi l’a-t-il tuée ? Il a défendu les frontières de son ‘moi’.
Violences à l’encontre des femmes (9) : Rien n’exclut - bien au contraire - que les politiques médiatiques, policières, judicaires présentées comme relevant de décisions de luttes contre les violences à l’encontre des femmes ne se focalisent contre certains d’entre eux, dans la perpétuation des logiques ancestrales de répression étatique focalisées sur les hommes des classes jugées dangereuses. La focalisation médiatique récente sur certains hommes de pouvoir ne doit pas détourner l’attention.
Violences à l’encontre des femmes (10) : Tant réduisent les dénonciations féministes actuelles à « la-libération-de-la-parole-des femmes-depuis-me-too » pour ne pas avoir à affirmer qu’il s’agit d’un nième incessant processus de la libération des femmes du patriarcat, et que cette « libération » de la parole, laissée à elle-même interdit toute pensée féministe anti-patriarcale.
Violences à l’encontre des femmes (11) : 2022. Je lis « Il reconnait le caractère vital de l’esclavage pour la colonie, mais il entend réprimer les violences faites aux esclaves […]. »
Il est aujourd’hui aisé de voir que vouloir réprimer, dans le cadre du maintien de l’esclavagisme, les violences faites aux esclaves est non seulement impossible et absurde, mais en sus contribue à la perpétuation des dites violences : il en est de même concernant les-dites « violences faites aux femmes » : il faut juste remplacer « esclavage » par « patriarcat ».
Violences à l’encontre des femmes (12) : Condamner, lutter contre ces violences sans les lier à leurs causes, c’est en perpétuer la permanence.
Violences à l’encontre des femmes (13) : Il était furieux, en colère, mécontent de tout, impuissant.
- À qui pouvait-il s’en prendre ?
- À lui ? Il y avait longtemps, qu’il en avait perdu l’habitude, si tant est qu’il ne l’ait jamais eue.
- Au gouvernement ? C’était bien abstrait. Et il ne savait pas comment faire.
- À la police ? C’était bien risqué.
- Au monde entier ? C’était bien loin.
- À dieu ? il n’y avait jamais cru.
- À sa femme ? il n’en avait justement pas.
- À toutes les femmes ? La voilà la solution, la plus simple, la plus banale, la plus aisée : il avait abondance… Mais le risque d’être pris, dénoncé, s’aggravait. Alors à qui s’en prendre ?
- Aux féministes ?
Violences à l’encontre des femmes (14) : (6 mars) 1896. En lisant Léon Tolstoï [1828-1910] qui écrit dans son Journal :
« Plus la société est malade, plus il y a d’institutions pour le traitement des symptômes et moins on se soucie de changer toute la vie », je m’interroge sur la pertinence de la croyance en l’efficacité politique des dénonciations de tels ou tel homme violent [seraient-ils des millions ?]. 236
Violences à l’encontre des femmes (15) : (5 janvier) 2024. J’entends sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite), le chirurgien Pierre Foldès, de l’Institut Women safe & children -
« réseau d’associations françaises reconnu dans la prise en charge et l’accompagnement pluridisciplinaire et gratuit des femmes et des mineurs victimes de violences. » - définir ainsi « une violence faite aux femmes » :
« On m’a fait quelque chose que je n’ai pas voulu. »
Dès lors, tout peut être ainsi partie. Et, le danger est extrême.
Violences à l’encontre des femmes (16) : Il cherchait, sans le savoir, sa « moitié perdue » ; une fois trouvée, il l’absorba, et dès lors, devenue inutile, il la tua.
Violences à l’encontre des femmes (17) : Si les femmes se battaient si souvent entre elles, c’est qu’elles ne pouvaient pas battre les hommes.
Violences à l’encontre des femmes (18) : Les femmes battues, les femmes violées étaient responsables des doutes, des rires qu’elles suscitaient.
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes :
Violences à l’encontre des femmes (Abitbol Sarah) : (20 janvier) 2020. Sarah Abitbol, patineuse artistique, dans Un si long silence [Plon. 2020], s’adressant à l’entraineur Gilles Beyer (nommé ‘Monsieur O’) qui, à 15 ans, l’avait violée, écrit :
« Si vous avez tenu si longtemps, Monsieur O., c’est parce que tout autour de vous, l’a permis. Des politiques ont fermé les yeux, des dirigeants vous ont maintenu en place, des entraîneurs se sont tus pour ne pas risquer d’être virés ou pour protéger leurs propres turpitudes. Des femmes de coachs ont mis un mouchoir sur les crimes de leurs conjoints, des parents ont été aveuglés par leur volonté de voir leurs enfants réussir, des élèves eux-mêmes ont peur d’être discriminés s’ils parlaient. Chacun, à son niveau, a nourri et continue de nourrir le crime. » 237
Cette analyse - car c’en est une - révèle simplement, clairement, les logiques qui justifient les permanences des structures institutionnelles qui expliquent les violences à l'encontre des femmes : elle permet alors la nécessaire inversion du regard porté des victimes en ce qui les transforment en victimes.
Cette analyse va bien au-delà de celles limitées aux processus d’ « emprise » qui, sans nier leur importance, se limitent à décrire les mécanismes de prises de pouvoirs sur des individu-es au profit de celles centrées sur les causes inhérentes aux structures familiales, politiques, institutionnelles, toutes patriarcales. (Cf. Hommes. « Politiques ». Lamour Jean-François), Violences. Patriarcales)
* Ajout. 19 janvier 2023. À l’occasion de son décès, le presse rappelle qu’il n’avait reconnu que « des gestes inappropriés », que, mis en examen pour « agressions sexuelles » et « harcèlement sexuel » - pas pour « viol » - « placé sous contrôle judiciaire » en janvier 2021, il n’y avait jamais eu de procès.
- Je lis aussi dans l’Équipe [20 janvier 2023] :
« Déjà suspecté de comportements déplacés lorsqu'il s'occupait de Laetitia Hubert, qu'il a entraînée pendant près de dix ans et mena notamment au titre mondial junior en 1992, le technicien avait déjà fait l'objet d'une enquête administrative au début des années 2000 pour des gestes tendancieux. » (Cf. Justice, Patriarcat, Politique, Médias)
Violences à l’encontre des femmes (Adityanath Yogi) : (4 avril) 2017. Emmanuel Macron fit une croisière en bateau le 12 mars 2018 à Bénarès avec le Yogi Adityanath, moine-ministre Hindou de l’Uttar Pradesh. Un reportage de Libération, le concernant, affirme :
« On voit sur la vidéo d'un meeting ses disciples appeler les Hindous à ‘déterrer les cadavres des femmes musulmanes pour les violer’. » 238
N.B. Cette injonction est considérée par Libération comme relevant de la « provocat[ion] » … (Cf. Corps. Cadavres, Hommes. « Politique ». Macron Emmanuel)
Violences à l’encontre des femmes (Aragon Louis) : 1948. Louis Aragon [1897-1982], dans Les voyageurs de l’impériale, auteur de :
« […] Elle aura tout sali, tout détruit. Elle n’avait qu’à disparaître, qu’à s’arranger de faire ce qu’elle voulait sans que ça se sache. Tout est toujours un peu pire que l’on attend. On devrait tuer les femmes après s’en être servi. Ce qu’elle devienne ensuite, je m’en fiche, mais… Il y a une chose tracassante des femmes : elles comparent, elles comparent sans arrêt… » 239
Violences à l’encontre des femmes (Bachelot Roselyne) : 1999. Roselyne Bachelot, dans un chapitre intitulé : La violence des hommes. Un tabou, auteure de :
« Il est très difficile pour les hommes comme pour les femmes de se saisir de ce débat (sic). Certaines féministes sont comme le lapin devant le boa devant cette problématique (sic). » 240 (Cf. Femmes « Politiques ». Bachelot Roselyne, Féminismes. Antiféminisme, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Violences à l’encontre des femmes (Badinter Robert) : (25 août) 2024. Robert Badinter [1928-2002], sur France Culture [1ère diffusion. février 2002] évoquant un condamné à mort, auteur de :
« Il avait tué sa maîtresse par désespoir d’amour. » (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes, Patriarcat. Permanence)
Violences à l’encontre des femmes (Bakounine Mikhaïl Michel) : Mikhaïl-Michel Bakounine [1814-1876], dans Vers le socialisme libertaire, auteur de :
« Dans le mariage libre, l’homme et la femme doivent également jouir d’une liberté absolue. Ni la violence de la passion, ni les droits accordés librement dans le passé ne pourront servir d’excuse pour aucun attentat de la part de l’un contre la liberté de l’autre, et chaque attentat pareil sera considérée comme un crime. » 241 (Cf. Politique. Anarchisme. Bakounine Mikhaïl-Michel)
Violences à l’encontre des femmes (Balibar Jeanne) : (15 octobre) 2021. Jeanne Balibar, auteure de :
« La culture patriarcale a proposé aux hommes un modèle de prédation en leur mettant dans la tête que c’était séduisant d’être l’homme qui prend les femmes. Il faut travailler là-dessus, même si ça va être difficile de se débarrasser du marquis de Sade. Et de toute une culture érotique. » Et de :
« Ce mot ‘omerta’ n’est pas trop fort. Il ne vaut pas seulement pour les harcèlements sexuels ou moraux mais pour toutes les maltraitances liées aux hiérarchies de pouvoir s’exerçant sur un plateau. Nous sommes de temps à autre témoins de comportements qui terrorisent tout le monde. Très peu d’entre nous sont en position de les dénoncer, car nous craignons de ne plus travailler. Par ailleurs, ces révélations sur les réseaux sociaux, en occupant l’espace médiatique, ne doivent pas servir d’alibi au ministère de la Culture pour ne pas étudier de près la place des femmes dans nos métiers. » 242 (Cf. Culture. Patriarcale, Langage. Mots, Politique. Hiérarchie. État, Patriarcat, Pornographie, Violences. Sade)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Honoré de Balzac :
Violences à l’encontre des femmes (Balzac Honoré de) (1) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La peau de chagrin, auteur de :
« - N’achevez pas, m’écriais-je, je vous aime encore assez pour vous tuer… » 243 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes, Relations entre êtres humains. Aimer)
Violences à l’encontre des femmes (Balzac Honoré de) (2) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, rapporte cette discussion sur une conception de l’amitié (entre hommes) « qui ne recule pas devant la complicité » :
« Nous ne reculons devant rien, répondit Michel Chrestien. Si tu avais le malheur de tuer ta maîtresse, je t’aiderais à cacher ton crime et pourrais t’estimer encore. […] L’amitié pardonne l’erreur, le mouvement irréfléchi de la passion. […] » 244 (Cf. Hommes. Relations entre hommes. Solidarité entre hommes, Relations entre êtres humains. Amitié)
Violences à l’encontre des femmes (Balzac Honoré de) (3) : 1842. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, faisant parler Julie de son mari « violent », auteur de :
« [...] À ce prix, j’ai la paix. […] Mais si je mène ainsi mon mari, ce n’est pas sans redouter les effets de son caractère. Je suis comme un conducteur d’ours qui tremble qu’un jour la muselière ne se brise. […] » 245 (Cf. Femmes. Peur, Hommes. Violents)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Baudelaire Charles) : 1866. Charles Baudelaire [1821-1867], dans la série de ses poèmes intitulés Les épaves, voici les trois dernières strophes de celui intitulé À celle qui est trop gaie :
« Ainsi quand je voudrais, une nuit / Quand l’heure des voluptés sonne, / Vers les trésors de ta personne, Comme un lâche, ramper sans bruit // Pour châtier ta chair joyeuse, / Pour meurtrir ton sein pardonné, / Et faire à ton flan étonné, / une blessure large et creuse, // Et, vertigineuse douceur ! A travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, / T’infuser mon venin, ma sœur ! » (Cf. Corps. « Chair »)
Violences à l’encontre des femmes (Beck Robert) : 1969. Robert Beck (alias Iceberg Slim) [1918-1992], dans Pimp. Mémoires d’un maquereau, auteur de :
« Dans l’état où elle était [sa mère], elle pouvait s’estimer heureuse qu’il ne l’ait pas tuée, et moi avec, avant de nous enterrer tous les deux dans le jardin. » 246
Violences à l’encontre des femmes (Benedetti Arnaud) : (23 mai) 2022. Arnaud Benedetti, sur Franceinfo « professeur associé à l’Université Paris-Sorbonne », « rédacteur de chef de la revue politique et parlementaire », évoque « les violences féminines ».
Il fallait comprendre qu’il pensait évoquer des violences exercées par les - par des - hommes à l’encontre des femmes. Ce langage donne une certaine idée de la conscience politique, intellectuelle, que des hommes « intellectuels », des hommes « politiques » ont, encore en France, en 2022, des dites violences. (Cf. Hommes. « Intellectuels », Patriarcat)
Violences à l’encontre des femmes (Berberova Nina) : 1969. Nina Berberova [1909-1993], dans C’est moi qui souligne, auteure de :
« Il y eut encore une brève rencontre dont mon amour-propre eut un moment à souffrir : il me tordit les bras de jalousie en me demandant avec qui j’étais sortie la veille et m’envoya son poing lourd à la figure en proférant des menaces : ‘Gare à toi ! Je t’écrabouille si tu en regardes un autre’. Je n’appréciais guère ces manières, mais j’en ai retenu que la femme était physiquement plus faible que l’homme. » 247 (Cf. Êtres humains. Amour-propre, Femmes. « Faibles »)
Violences à l’encontre des femmes (Berger Aurore) : (4 octobre) 2022. Aurore Berger, députée macronienne, à l’assemblée nationale, auteure de :
« la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire ».
Les seuls jugements qui me viennent à l’esprit sont grossiers. Je m’en abstiens donc. (Cf. Droit, Justice)
Violences à l’encontre des femmes (« Bêtise » une) : (3 novembre) 2024. Lu sur Franceinfo : « Le corps d'une femme de 54 ans a été retrouvé ce matin dans la Seine à hauteur de Louveciennes (Yvelines), a appris France Bleu Paris, auprès du parquet de Versailles. Son ex-conjoint est le principal suspect. Ce dernier a appelé dans la soirée l'un de ses amis, reconnaissant avoir ‘fait une bêtise’. » (Cf. Enfants. Bêtises)
Violences à l’encontre des femmes (« Bizutages ») : 1960. En France, au terme de la journée de bizutage de l’école vétérinaire de Maison Alfort, lors d’un défilé dans la ville, « dans une atmosphère de franche rigolade, un étudiant de quatrième année harangua ainsi la foule : ‘70 nouveaux vont être lâchés dans la ville. Maris, serez vos femmes. Femmes, serez vos filles. Filles, serez les fesses’. » 248 (Cf. Patriarcat. Proverbes, Violences. « Bizutages »)
Violences à l’encontre des femmes (Bonafous Louis) : (avril) 1847. « Louis Bonafous, frère des écoles chrétiennes, en religion frère Léotade [1812-1850] accusé d’avoir tué une jeune ouvrière après une tentative de viol, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité en avril 1848 et mourut au bagne de Toulon le 26 janvier 1850. Affaire qui avait fait grand bruit à l’époque et agité les passions. Léotade protesta toujours de son innocence, jusqu’à son lit de mort. Voir le long article du Grand Larousse universel, t. X. p.379. »
Cette note de George Lubin [1904-2000] s’inscrit en commentaire d’une critique, le 15 juin 1871, des réactions de l’église catholique par George Sand [1804-1871] :
« Les dévots ont fait de Léotade, il y a 20 ans, un martyre et un saint, par esprit de corps. » 249
- Dans le Grand Larousse Universel, je lis notamment :
« Sa mort [celle de Cécile Combettes, âgée de moins de 15 ans] était due à des coups nombreux appliqués sur sa tête, pendant la vie, en sorte que le meurtre n’avait été commis que pour assurer l’impunité du premier crime, pour étouffer la voix d’un témoin accusateur. Toutefois le viol n’avait pas été consommé, malgré n’énergiques efforts ; le coupable n’avait pu que déchirer les organes de Cécile qui étaient dans un état affreux. »
- La culpabilité de Louis Bonafous et les - grossiers - mensonges de sa communauté religieuse pour le couvrir apparaissent dans ce récit très clairement. (Cf. Corps, Femmes. Jeunes filles. Comment meurent les femmes, Justice. Impunité, Patriarcat. Église catholique)
Violences à l’encontre des femmes (Borne Elisabeth) : (15 juin) 2002. Élisabeth Borne, première ministre en campagne, interpellée dans le Calvados, dans la rue, par une femme qui la critiquait sur la présence au gouvernement de ministres accusés de viols, violences, après une succession d’esquives, de mauvaise foi, de mensonges, de dénis, a osé dire :
« Tout est fait pour accueillir au mieux les femmes pour qu’elles puissent déposer plainte et que la justice puisse établir les faits. »
Mais la réalité, c’est qu’aussi infâmante, honteuse, cette déclaration puisse être, c’est de se rendre compte que la première ministre ne pouvait rien dire d’autre.
Violences à l’encontre des femmes (Brésil. XIXème siècle) : 1850. Madame Toussaint-Samson [1826-1911], dans Une Parisienne au Brésil, rapporte sa rencontre à Rio, vers 1850, avec un Français de 35 ans, pianiste, fort « pâle », bien que non malade. Il lui est dit qu’il avait tué à bout portant, son épouse, française elle aussi, chanteuse au Théâtre de Rio, laquelle courtisée par un jeune docteur de la ville, Français lui aussi, devint sa maîtresse.
La fin de l’histoire (vraie), telle que vécue par l’auteure du livre :
« Il fut se constituer prisonnier. Après avoir subi un jugement, absous de par la loi, il était demeuré dans le pays, où il rencontrait à chaque pas celui qui l’avait déshonoré. Il avait eu le triste courage de tuer la femme et n’avait pas celui de tuer l’homme. Tout souillé de son crime, portant depuis, comme un stigmate éternel, cette pâleur cadavérique, il continuait cependant à venir jouer chaque soir des quadrilles et des polkas pour faire danser la jeunesse brésilienne, son crime l’ayant en quelque sort, mis à la mode. […] ».
Et elle poursuit :
« Ce récit me glaça ; mes yeux ne pouvaient se détacher de cet homme qu’on plaignait généralement, tandis que moi, je ne trouvais pour lui, en le regardant, que cette seule parole : « Lâche ! » […] 250 (Cf. Femmes. Écrivaines. Adèle Toussaint-Samson, Droit, Justice, Patriarcat, Histoire)
Violences à l’encontre des femmes (Buckingham Duc de) : 1675-1677. Je lis dans les Mémoires du cardinal de Retz [1613-1679], rapportant ce que madame de Chevreuse [1600-1679] lui avait dit, « elle, qui avait été la seule et véritable confidente de la jeunesse » [de la reine Anne d’Autriche, 1601-1666, mère de Louis XIV, régente] :
« Le seul homme qu’elle [Anne d’Autriche] avait aimé avec passion avait été le duc de Buckingham [1592-1628] ; qu’elle lui avait donné rendez-vous, [en 1625 ?] une nuit, dans le petit jardin du Louvre ; que Madame de Chevreuse [1600-1679] qui était seule avec elle, s’était un peu éloignée, elle entendit du bruit comme de deux personnes qui se luttaient : que s’étant approché de la Reine, elle la trouva fort émue, et Monsieur de Buckingham à genoux devant elle ; que la Reine, qui s’était contentée ce soir, de lui dire, en remontant dans son appartement, que tous les hommes étaient brutaux et insolents, lui avait commandé, le lendemain au matin, de demander à Monsieur de Buckingham s’il était bien assuré qu’elle en fut pas en danger d’être grosse ; que, depuis cette aventure, elle, Mme de Chevreuse, n’avait eu aucune lumière, d’aucune galanterie de la Reine […] ».
Plus loin, le cardinal de Retz rapporte, toujours selon Mme de Chevreuse, que :
« Buckingham lui avait dit autrefois qu’il avait aimé trois reines, qu’il avait été obligé de gourmer toutes trois. » 251
N.B. « Gourmer » : « Battre à coups de poings, faire souffrir, maltraiter, battre. »
On peut ajouter ici : violer.
Violences à l’encontre des femmes (Burke Edmund) : 1797. Cette analyse d’Edmund Burke [1729-1797], dans sa Première lettre sur la paix régicide - en réalité une leçon politique adressée aux hommes politiques Anglais concernant leur politique vis-à-vis du Directoire [1795-1799] - peut être valablement pensée comme pouvant concerner les violences des hommes à l’encontre des femmes :
« […] Il arrive souvent dans de grands malheurs que les facultés intellectuelles sont tellement paralysées par la présence d’un péril imminent, qu’on ne peut plus ni préparer des ressources, ni apprécier le danger, ni même l’apercevoir.
L’œil de l’âme est ébloui, confondu.
Une défiance abjecte de nous-mêmes, une admiration extravagante des moyens de notre ennemi, ne nous permettent plus de voir d’autre espoir que dans un compromis avec son orgueil, dans un pacte avec ses commandements.
Dans le désordre qui règne alors dans l’État, on veut entendre que les conseils dictés par cette ridicule frayeur. On se plonge dans un abîme obscur pour éviter l’objet de sa crainte.
La nature du courage est de pouvoir fixer le péril en face ; mais l’homme qu’affaisse une consternation irréfléchie se crée des fantômes et des ténèbres ; le cri de l’instinct provoque son courage ; il repousse un courage qui lui semble provoquer les dangers et les produire.
Alors la crainte n’a plus d’asile qu dans la crainte, la temporisation seule paraît un moyen de salut. » 252 (Cf. Histoire)
Violences à l’encontre des femmes (Chaîne Histoire) : (15 janvier) 2022. Entendu sur la Chaîne Histoire, dans Voyez comme on danse [2013], concernant une chorégraphie :
« Le professeur s’est amouraché de la danseuse au point qu’il la tue. »
Violences à l’encontre des femmes (Chateaubriand François-René de) : 1850. François-René de Chateaubriand [1768-1848], dans les Mémoires d’Outre-tombe, auteur de :
« Malheureusement, la tendresse que l’on montre à une fille que l’on a déshonorée lui sert peu. » 253
Violences à l’encontre des femmes (Chazal Claire) : (9 décembre) 2021. Claire Chazal, journaliste, dans Paris Match concernant Patrick Poivre d’Arvor, accusés de viols et agressions sexuelles par des dizaines de femmes, son ancien compagnon et le père de leur enfant - elle à qui, sans doute, la première, tout a été caché - le décrit ainsi :
« Un séducteur qui aime conquérir et, même, disons-le, multiplier les conquêtes. Il n'est en rien dans la violence, ni dans la force. Ce qu'il aime avant tout, c'est séduire, convaincre. Il a l'orgueil qui fait que, être aimé, c'est ce qu'il souhaite avant tout. » (Cf. Femmes. Épouse de, Hommes. Journalistes. Poivre d’Arvor Patrick, Famille. Couple)
* Ajout. 29 septembre 2022. Cf. Hélène Devynck, Impunité [Seuil. 2022].
Violences à l’encontre des femmes (C. News) : (9 septembre) 2022. Entendu sur C. News, à l’occasion de la mort d’Elisabeth II [1926-8 septembre 2022], une référence à Henri VIII [1491-1547], ainsi présenté :
« Il avait un rapport douloureux avec ses épouses » Suivi de - gros - rires. (Cf. Femmes. Assassinées)
Violences à l’encontre des femmes. Gérard Collomb :
Violences à l’encontre des femmes (Collomb Gérard) (1) : (23 août) 2018. Gérard Collomb [1947-2023], ministre de l’intérieur, auteur, concernant un homme qui avait, le matin même, assassiné trois femmes, dont sa mère et sa sœur :
« Il avait un problème psychiatrique important. » 254 (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse. Psychiatrie, Violences. Déni, Patriarcales)
Violences à l’encontre des femmes (Collomb Gérard) (2) : (6 septembre) 2018. Gérard Collomb [1947-2023], ministre de l’intérieur - devant un tableau affichant une croissance de +23 % [sur les 7 premiers mois de 2018 par rapport à la même période en 2017] des « violences à l’encontre des femmes » - qui, dit-il, « explosent » - les présente comme étant des « violences non crapuleuses. » 255
Ce sont des dizaines d’années d’apports féministes à la pensée qui manquent à cet homme (comme à tant d’autres hommes « politiques ») d’un autre siècle [le XIXème] ; mais qui, au mépris de la vie des femmes, se perpétue au XXIème siècle. (Cf. Droit, Justice, Hommes. « Politiques », Féminismes, Penser)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Colonialisme) : 2019. Marie-Hélène Fraïssé, auteure, journaliste, grand reporter, sur France Culture, auteure de :
« […] (Concernant les « rapts d’indigènes ») Dans tous les récits de voyages, jusqu’à pratiquement le XIXème siècle inclus, les voyageurs se croient autorisés à emmener des gens comme des pièces à convictions de leur voyage… On navigue le long du rivage, on voit une femme avec son enfant, eh bien, on l’embarque … Et puis, il y a eu le grand non-dit de toute l’histoire de l’exploration, c’est que… On arrive, au début en tout cas, en bateau, des hommes débarquent, des hommes qui sont sans femme depuis des semaines, etc… Il y a eu des viols partout, des métissages innombrables sur toutes les côtes d’Amérique, d’Asie, d’Afrique… » 256 (Cf. Patriarcat. Colonialisme, Politique. Colonialisme)
Violences à l’encontre des femmes (Constant Benjamin) : (27 septembre) 1793. Benjamin Constant [1767-1830], dans une lettre à Isabelle de Charrière [1740-1805], après avoir évoqué « deux petites filles, Ninette et Many, si fraîches et si gaies et si disposées à être heureuses », auteur de :
« Je me suis demandé si, pour les préserver de mes malheurs, pour les empêcher d’être usées comme moi par l’anxiété et l’inquiétude, et l’incertitude qui remplace toujours la certitude du mal, je ne devais pas, au lieu de m’égarer en vœux inutiles et vagues, souhaiter qu’elles mourussent bientôt. J’ai été sur le point de former ces vœux, l’idée de leur mère m’a arrêté. Je n’en forme donc point, mais je suis convaincu que lorsqu’on voit une jeune personne, gaie et contente, et vive et saine, et pleine d’espérances, et insouciante et ignorante de l’avenir, si d’un mot on pouvait la faire cesser d’être, ce serait une bonne action. » 257
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. « Consentement ». Critique :
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (1) : 1985. Nicole-Claude Mathieu [1937-2014], dans Quand céder n’est pas consentir, auteure de :
« Si l’on tient absolument à parler de ‘violences’ et de ‘consentement’, il faudra étendre - en ce qui concerne l’opprimé(e) - le champ sémantique du mot violence et restreindre celui de consentement au point que seul le mot violence doit être finalement retenu si l’on veut bien se souvenir du sens des réalités : ‘domination’ et ‘oppression’. L’oppresseur est dans sa conscience un dominant, il respire sur ses hauteurs ; l’opprimé (l’oppressé) étouffe dans l’abaissement, et la bassesse, de l’oppression. […] S’il faut parler de consentement à la domination, c’est celui … des dominants. » 258
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (2) : (25 mai) 2003. Samira Bellil [1972-2004], auteure de Dans l’enfer des tournantes, est interviewée par Sporenda et, concernant la réception de son livre, celle-ci dit :
« J’arrivais avec des mots-choc qui bousculaient tout le monde, mais je pense qu’à un moment donné, il fallait bousculer tout le monde et utiliser des mots crus comme les miens. Cela dit, à chaque débat, j’ai observé que les gens étaient imprégnés de ce qui se dit médiatiquement sur les viols collectifs, sur le consentement des filles etc. Ce que j’ai vu, c’est que les gens écoutaient les loups et n’avaient pas du tout une approche critique leur permettant de se poser des questions sur ce qu’ils entendaient autour d’eux. En m’écoutant, ces gens découvraient l’horreur ; certains entendaient un récit de ces violences pour la première fois. Parce que, quand on parle de viols collectifs, on occulte complètement la violence ; on insiste beaucoup sur le consentement de la jeune fille mais on passe sur la violence qu’il y a avant, après et autour. Ce que j’ai ressenti, c’est qu’en prenant la parole, en disant ces choses et en me mettant à nu, ça a ouvert des débats où les gens commençaient à se mettre à nu, à affronter leurs souffrances et à se poser des questions. […] ». 259
Une analyse critique pionnière. (Cf. Femmes. Remarquables. Bellil Samira, Pornographie. Bellil Samira)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (3) : (28 septembre) 2024. [modifié le 12 novembre 2024] L’ajout au code pénal du terme de « consentement » dans la définition du viol est encore défendue par des féministes, comme par le gouvernement : le nouveau ministre de la justice, Didier Migaud - 27 septembre 2024 est « pour » ; Emmanuel Macron aurait déjà donné son accord le 13 mars 2024 [retrouver la source] ; Isabelle Rome, ancienne ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et, depuis le 25 avril 2024, « ambassadrice pour les droits de l’homme (sic) pour la France [?] » propose le 28 septembre 2024 le vote dans le code pénal d’une réforme de la définition du viol d'un « premier alinéa qui dit que tout acte de pénétration sexuelle non librement consenti constitue un viol ». Et qu'en cas de violence, contrainte, menace ou surprise, « il y a, dans ces cas-là, présomption de non-consentement ».
Si, dans certains, rares, procès, la demande de consentement peut s’avérer être favorable aux femmes victimes de viol, cet argument ne saurait justifier l’emploi de ce terme, inscrit au cœur de la pensée libérale, et donc des féministes libérales : chacun-e est « libre de consentir », faisant abstraction de tous les rapports de pouvoir qui structurent ladite liberté. Y ajouter des adjectifs [« libre et éclairé »] n’y change rien, sans doute, de rendre l’analyse encore plus complexe.
L’ajout du terme « consentement » ou de « non consentement » dans le code pénal est, quelles que soient les rédactions proposées, un terrible danger.
Il signifie que l’on peut « consentir au viol », ce qui est monstrueux.
Si le viol est un crime : comment peut-on « consentir » à un crime ?
Le crime est dès lors nécessairement remis en cause.
La question par ailleurs de savoir qui - de la parole de la personne violée ou du violeur - devrait s’assurer du « consentement », devrait prouver devant les tribunaux le « consentement », n’étant pas et ne pouvant pas être tranchée, ceux-ci se trouvent à égalité. Le terme de « partenaire » dans l’article du 11 novembre 2024 - cité en note - est la preuve de la négation du crime de viol. Je lis, en effet, posée comme question : « Comment s’est-elle assurée du consentement de son ou sa partenaire, et si le contexte ou les circonstances étaient défavorables, quelles mesures raisonnables a-t-elle mis en œuvre pour s’assurer de la validité du consentement. » 260
Enfin, il fait être lucide, ce terme une fois intégré dans le code pénal, les frêles barrières juridiques censées « protéger » - avec les succès que l’on connaît - spécifiquement les enfants, ne peuvent que sauter.
Dernier point : c’est - et ce n’est pas l’une de ses moindres conséquences, pour employer un euphémisme - faire entrer « l’acte sexuel » au singulier, les « relations sexuelles » dans le code pénal. (Poursuivre) (Cf. Droit. Dignité. Langage. Mots. Critiques de mots : « Protéger », Penser. Consentement, Violences. Viols)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (4) : (14 octobre) 2024.
« Madame, consentez-vous à épouser monsieur : Oui / Non »
« Madame, consentez-vous à être violée pas monsieur : oui / Non »
Après, le tribunal appréciera si vous étiez suffisamment claire, consciente, explicite dans votre refus du « consentement » et si l'homme que vous avez accusé de vous avoir violée a bien saisi, compris, été conscient de votre refus du « consentement » à être violée...
Et, à quel moment, dans quelle hiérarchie, dans l’appréciation de la prise en compte de « la violence, contrainte, menace ou surprise » ? (Cf. Penser. Consentement)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (5) : (15 octobre) 2024. Lu, notamment, ces arguments dans la Tribune collective parue dans L’Humanité le 4 octobre 2024 : Justice : contre l’introduction du consentement dans la définition du viol :
- « Le viol n’est pas une relation sexuelle non consentie […] »
- « Au lieu de se concentrer sur la stratégie de l’agresseur, la justice se focalise sur un éventuel consentement de la victime. ».
- « Le viol c’est ce qu’a décidé l’agresseur et non le comportement de la victime. » (Insuffisant)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (6) : (15 octobre) 2024. Lu le titre de l’article paru sur Franceinfo le 27 septembre 2024 :
« ‘Je ne me suis pas posé la question’ : au procès des viols de Mazan, l'indifférence des accusés vis-à-vis du consentement de Gisèle Pelicot ».
Mais bander, faire pénétrer son sexe dans le vagin de Madame Pélicot, inconnue de vous, couchée sur son lit, parce que son mari vous l’a demandé, autorisé, relèverait sans doute de l’évidence…
N.B. Je note que le terme de « consentement » n’est utilisé dans l’article que sous cette formulation du président du tribunal :
« Est-ce qu'un mari peut consentir à la place de sa femme ? ».
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (7) : (21 novembre) 2024. Évoquer le [non] consentement de Gisèle Pélicot suppose que cette femme - comme tant d’autres - était perçue par tous les hommes immondes qui l’ont violée comme un être humain, et à ce seul titre, digne d’être respectée ; or, ils ne l’ont traitée que comme un réservoir de leur sperme, sans doute, pour certains, pour se sentir mieux dans leur sexe, dans leur peau, dans leur identité d’homme. (Cf. Corps. Sperme, Hommes, Sexes […])
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (8) : (21 novembre) 2024. Ajouter le terme de « consentement » à une définition pénale du viol, c’est s’interdire de penser et donc de dénoncer le proxénétisme. Il suffirait à un proxénète de faire signer aux femmes qu’il traite comme un « cheptel » un « contrat » dans lequel elles s’affirmeraient « consentantes », et / ou à un « client » de leur demander leur « consentement » pour que le tour soit joué.
Sans évoquer toutes celles qui « consentiront », comme à l’habitude, à céder, sans même qu’on leur demande leur avis…
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (9) : (21 novembre) 2024. Si ce terme de « consentement » était ajouté au code pénal, ce serait la plus grave régression féministe depuis les années 1970, 1980.
* Ajout. 22 novembre 2024. Non. J’oublie la légitimation du proxénétisme par l’ONU et l’Union européenne. (Cf. Proxénétisme)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (10) : Introduire le terme de « consentement » dans le code pénal, peu importe où, comment, c’est faire entrer un loup dans la bergerie.
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (11) : (21 novembre) 2024. Vouloir faire croire que l’ajout du terme de « consentement » code pénal serait positif pour les victimes, c’est vraiment nous faire prendre des vessies pour des lanternes : c’est en réalité apporter sur un plateau d’argent aux violeurs un terme - qui serait alors sanctifié par le droit - alors qu’il est le fondement de leur argumentaire pour nier leurs crimes depuis des siècles.
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (12) : (25 novembre) 2024. Lu sur Franceinfo : « ‘On doit sortir de cette culture de la domination de l'homme sur la femme’, commente le ministre de la Justice, Didier Migaud, sur le plateau des ‘4 V’ sur France 2. Il évoque notamment le procès des viols de Mazan, et se dit favorable à l'inscription du consentement dans la loi. »
Que le gouvernement - avec le soutien de LFI - se croit contraint d’employer l’expression de « sortir de la culture de la domination de l'homme sur la femme », qui par ailleurs, ne l’engage à rien, pour faire accepter l’insertion du terme de « consentement » lui, très immédiatement concret, en montre l’importance politique.
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (13) : (25 novembre) 2024. Je lis en présentation de l’article du Monde signé François Lavallière et Delphine Mauger Faisons entrer le consentement dans notre droit pénal :
« Au Canada, la loi prévoit qu’une personne est consentante [à quoi ? à des relations sexuelles ou un viol ?] seulement si elle a manifesté son accord par des paroles ou par son comportement. […] »
Pour répondre à ma question, dans le corps du texte, je lis « partenaires intimes », « d’activité sexuelle », qui s’ajoutent au terme terrifiant de « partenaire », déjà lu ailleurs, autant de termes qui, à eux seuls, sont une négation du viol.
Le viol est donc, par l’ajout du terme de « consentement » dans le code pénal, peu importe où comment, qualifié comme ceci ou cela, est subsumé dans les relations sexuelles.
Le viol n’est donc plus un crime.
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (14) : Utiliser Gisèle Pélicot, comme l’a fait le premier ministre, lui aussi, le 25 novembre 2024, à l’appui de l’ajout du terme de « consentement » dans le code pénal révèle son absurdité, son incohérence, sa malhonnêteté : Gisèle Pélicot était dans l’impossibilité - physique, mentale - d’exprimer un quelconque consentement ; elle ne pouvait tout simplement pas même s’exprimer.
Le terme est donc hors-sujet.
* Ajout. 21 décembre 2024. Christelle Taraud « historienne des sexualités », dans L’Humanité, auteure de :
« Au moment des faits, Gisèle Pelicot est non consentante puisqu’elle est fortement sédatée. »
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (15) : (11 décembre) 2024. Je lis dans Le Canard enchaîné, L’affaire Pélicot laisse les politiques sans voix… mais tout ouïe au consentement (p.3) qu’ « en Espagne, en 2019, la loi sur le consentement a provoqué 1233 remises de peine d’agresseurs condamné, et l’indignation génale. Le texte a dû être réécrit. »
Le terme de « consentement » a été maintenu dans la « loi organique » espagnole du 6 décembre 2022 qui s’intitule dorénavant « de garantie intégrale de la liberté sexuelle ». (Poursuivre)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (16) : (16 décembre) 2024. J’entends dans l’émission Les pieds sur terre de France culture intitulée Dernières nouvelles du sexe, qui présente, comme par hasard, comme une aimable et joyeuse partie de plaisir sans l’ombre d’une critique une « partouze ou le sexe à plusieurs [!] » - et qui pourrait tout aussi bien avoir lieu dans un bordel - que l’ « on vous demande à l’entrée de signer une charte sur le consentement. »
C’est cela « un consentement libre et éclairé » « libre et volontaire » ?
Une analyse courante encore une fois confirmée : l’invocation de « la liberté » pour mieux conforter tous les systèmes de domination.
Les proxénètes de tous poils se réjouissent ; l’opération fut rondement, efficacement menée…
L’ajout du terme « consentement » dans le droit pénal, un « droit criminel » faut-il le rappeler ? est une transposition, en toute logique libérale, du droit des contrats [articles 1128 et 11321 du code civil] à la personne humaine.
Une véritable [contre]révolution juridique.
* Ajout. 2 juin 2025. Je lis : « Le consentement se définit comme la rencontre des volontés entre plusieurs parties pour passer un contrat. C’est la rencontre entre une offre et une acceptation (v. art. 1113 et s. du Code civil) qui matérialise le consentement. » (Poursuivre)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (17) : (11 février) 2025. Lu sur Franceinfo : « Un ex-entraineur de patinage artistique a été condamné à sept ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur mineures par la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Il avait entre 25 et 26 ans lors des faits, entre janvier 2007 et décembre 2008, et a nié fermement tout acte sexuel non consenti. »
Ici, c’est bien, dans cette formulation : « acte sexuel non consenti » par le violeur et non pas le viol tel que défini par le code pénal qui est présenté.
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (18) : (14 mars) 2025. Une émission de France Inter de près d’une heure, s’intitule : « Jamais sans mon consentement. » Je lis :
« Le consentement pourrait bientôt être inscrit dans la loi, obligeant les agresseurs présumés à apporter la preuve qu’ils ont bien obtenu un accord avant tout acte sexuel. »
Ce que les défenseuses de la modification de la loi pénale sur le viol, interprètent, veulent croire à, veulent définir comme « un consentement libre, éclairé » etc.., c’est tout simplement redonner la parole - première - à l’agresseur présumé, à l’homme. Et on reviendra - terrifiante régression - à « parole contre parole ».
D’où, sans doute, les nombreux agresseurs, violeurs « blanchis » en Espagne.
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (19) : (12 avril) 2025. J’entends sur TFI l’avocat d’un homme accusé de « viols avec actes de barbarie » parler de « pratiques libertines librement consenties ». (Cf. Hommes. « Libertins », Violences. Sade)
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (20) : (28 mai) 2025. Pourquoi les personnes qui défendent l’ajout du terme « consentement » au code pénal - ce qui, bien au-delà, concerne toutes les violences patriarcales - n’ont-elles pas repris les termes, employés pour les divorces, de « consentement mutuel » ?
Violences à l’encontre des femmes (« Consentement ») (21) : (18 août) 2025. Penser à la signification politique que les termes de « soumission chimique » et de « consentement » ont été quasi concomitamment, lors du procès de Dominique Pélicot, imposés dans le débat public. (Cf. Langage. Mots, Penser)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Coutume) : Ce que l’on nomme : « la coutume » - ou du moins, celle au nom de laquelle tant violences ont été commises - est responsable de plus de morts de femmes que tous les assassins considérés comme tels depuis des siècles. Plus que la loi ?
Violences à l’encontre des femmes (Création d’un « Observatoire ») : Proposer la création d’un observatoire des violences à l’encontre des femmes est un mépris des recherches féministes jusqu’alors effectuées ; une injure faite aux femmes, faite aux associations ; une justification des dites violences auxquelles la réponse donnée est : résignez-vous à ce que l’on vous viole, vous frappe, vous injurie, vous assassine, jusqu’à nouvel ordre.
Vous, continuez à mourir. Nous, on [vous] observe.
Violences à l’encontre des femmes. « Crime d’honneur » :
Violences à l’encontre des femmes (« Crime d’honneur ») (1) : Ne concernerait, à en croire la presse, que les hommes des pays arabes/musulmans. À croire que ‘les autres’ ne commettraient pas de crime et/ou n’auraient pas d’honneur ; à moins qu’ils ne les qualifient autrement : de ‘passionnels’, par exemple ? N’aurait donc rien à voir avec l’un quelconque des crimes dont les femmes sont quotidiennement les victimes en « occident ».
Par ailleurs, cet dénomination - sans relation, à ma connaissance, avec aucun code pénal existant - est, en sus, une caution de facto de tous les codes de statut personnel, de toutes les lois ‘familiales’, toutes les lois patriarcales, toutes les lois religieuses, l’exception confirmant la règle. (Cf. Droit. Patriarcal, Famille. Code de la famille)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. « Crime d’honneur » :
Violences à l’encontre des femmes (« Crime d’honneur ») (2) : 1969. Dominique Fernandez dans Mère Méditerranée, définit justement le « crime d’honneur » comme « la jalousie incestueuse déguisée en défense de la famille. » 261 (Cf. Relations entre êtres humains. Jalousie, Famille, Violences. Incestueuses)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (« Crime passionnel ») : (20 août) 2020. À mon grand étonnement j’entends sur France Culture, concernant la série policière intitulée Le crime d’Orcival, employer l’expression de « crime passionnel », alors que déjà treize épisodes avaient déjà eu lieu afin de démontrer, précisément, rigoureusement, fort intelligemment, que le crime de Berthe avait été commis, minutieusement, froidement, pensé par son époux, dans des contextes on ne peut plus réalistes de vengeances multiples. 262 (Cf. Culture. France Culture, Justice. « Crime passionnel », Langage, Penser, Patriarcat. Permanence)
Violences à l’encontre des femmes (Criminels de paix) : Infiniment plus nombreux que les criminels de guerre.
Violences à l’encontre des femmes (Daoud Chahinez) : (4 mai) 2021. À 31 ans, à Mérignac (Gironde) cette mère de trois jeunes enfants fut assassinée, brulée vie par son mari, par son mari. Elle avait porté plainte le 23 juin 2020. Le 25 juin 2020, Mounir Boutaa est condamné en comparution immédiate pour violences en récidive à une peine de 18 mois de prison dont 9 mois ferme. Le 7 août 2020, il dépose une plainte pour harcèlement téléphonique alors qu'il était incarcéré et avait interdiction de la contacter. Le 2 octobre 2020, il est convoqué pour qu'il s'explique sur ces contacts téléphoniques avec son épouse. La police n'informe le parquet du non-respect de la mesure d'éloignement que le 10 décembre. Le parquet classe la plainte de Chahinez Daoud sans suite sans prévenir le référent chargé des violences conjugales ni le juge d’application des peines. Le mari bénéficie d'un aménagement de peine et est remis en liberté le 9 décembre 2020 avec suivi judiciaire. Son épouse n'en est pas tenue informée. Il ne respecte pas l'interdiction de s'approcher du domicile de sa femme. Le 15 mars 2021, elle porte à nouveau plainte après qu'il l'ait frappée et ait tenté de l'étrangler. Le 26 mars et le 14 avril, il se présente aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation sans être interpelé. Le 4 mai 2021 à 18h15, alors qu'elle sort de son pavillon pour aller chercher ses enfants, Mounir Boutaa, qui s'était caché pour la surprendre, lui tire à deux reprises dans les jambes avant de l'asperger d'un liquide inflammable et de mettre le feu à sa victime et au pavillon.
- J’apprends alors qu’il avait été condamné à 7 reprises pour ‘violences avec usage d'une arme’, ‘vol avec destruction ou dégradation’ et pour violences par conjoint en présence d'un mineur.’
- J’apprends aussi qu’en juillet 2021 que le policier de Mérignac qui avait enregistré la plainte de Chahinez Daoud avait été lui-même condamné pour violence familiale le 10 février 2021 à une peine de 8 mois de prison avec sursis probatoire et non-inscription de cette condamnation au casier judiciaire B2. Etc, etc.
Lu devant le domicile de la victime :
- Chahinez, on ne t’oublie pas.
- Je ne veux plus subir d’être une femme.
- Des réformes avant qu’on soit mortes.
- Stop féminicides. Protégeons les vivantes.
- Et je lis, le 27 septembre, que l’avocat Pierre Fabre, fondateur d’Avocat-stop féminicide, parle de « malheureux cas ».
Au secours, victime assassinée en danger ! (Cf. Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
Violences à l’encontre des femmes (Darmanin Gérald) : (1er septembre) 2023. Une femme policière est assassiné par son ex-conjoint. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, premier responsable de la mise en oeuvre de la lutte contre les violences à l’encontre des femmes, tweete :
« Merci aux gendarmes qui ont mené à bien l’interpellation de l’individu suspecté du féminicide hier en Savoie, en mobilisant des moyens très importants. » [10h45] Je vois le lendemain reproduit ce second tweet, mais sans date, sans source, sans reproduction :
« Grande tristesse à l'annonce de ce qui, selon les premiers éléments, serait un féminicide, une policière hors service tuée sur la voie publique en Savoie. Pensées pour sa famille, ses proches et ses collègues. »
Selon Fabrice Galatioto, secrétaire départemental syndicat unité SGP Police FO :
« Cela faisait cinq ans qu'elle signalait à la justice ce genre de fait, parce qu'elle a été victime de la part de cet individu de violences, de harcèlement, de menaces. » (Cf. Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
Violences à l’encontre des femmes (David-Neel Alexandra) : (12 février) 1912. Alexandra David-Neel [1868-1969], dans une lettre à son mari, évoque les violences à l’encontre des femmes universitaires françaises au tournant du XXème siècle, notamment à la Sorbonne :
« […] Tu ne vis pas dans ces milieux, tu ne peux pas te douter de quoi sont capables certains hommes, leur haine du féminisme gagnant chaque jour du terrain.
Ceux qui, dans ma jeunesse, s’efforçaient, dans les couloirs étroits et les escaliers en tire-bouchons de la vieille Sorbonne, de nous serrer entre les portes et le mur ou de nous faire tomber du haut des marches, qui, gracieusement, enfonçaient dans la tête des jeunes filles assises devant eux leurs épingles de chapeaux et leur donnaient des coups de pieds quand ils se trouvaient les dominer sur un gradin supérieur de l’amphi, ceux-là ont grandi et certains ont persévéré dans le même esprit.
Est-ce que la police n’a pas dû, plusieurs fois, en ces temps-là, charger pour protéger les étudiantes en médecine qu’on avait gentiment commencé à assommer à coups de pieds de bancs ?
Tu as peut-être toi-même entendu parler de ces choses, en ta jeunesse et peut être as-tu trouvé drôle et réjouissant cette façon de traiter des femmes pas riches qui avaient l’impudente audace de vouloir demander leur gagne-pain à autre chose qu’à leur sexe ? […] » 263 (Cf. Culture. Sorbonne, Femmes. Assises. Jeunes filles, Hommes. « Intellectuels », Féminismes. Antiféminisme, Patriarcat, Proxénétisme, Sexes […])
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Florian Delorme :
Violences à l’encontre des femmes (Delorme Florian) (1) : (10 mars) 2021. Florian Delorme, dans l’émission Cultures Monde de France Culture, consacrée à la lutte des femmes contre « les violence sexistes » demande, concernant la politique espagnole en la matière ce qui « a marché » et ce qui « n’a pas marché » ; ce qui fut suivi par la personne interrogée par lui par : « Le nerf de la guerre, c’est le financement des politiques publiques ». Dès lors, évacuant les luttes des femmes, il retombe sur ses pieds [traditionnels] en deux coups de cuillères à pot : l’analyse de l’évolution de la politique espagnole et de la comparaison de ses divers gouvernements.
Le même Florian Delorme évoque « le désir d’émancipation des femmes du Golfe » : « émancipation » de qui ? Pourquoi pas, les concernant, « le désir de liberté ». Et pourquoi pas faire référence au féminisme, au patriarcat ? 264
Violences à l’encontre des femmes (Delorme Florian) (2) : (5 octobre) 2022. L’émission Cultures monde de France Culture, consacrée à #Me Too, 5 ans menée par Florian Delorme, est intitulée : De l’Égypte à la Tunisie : une révolution étouffée. Non seulement l’analyse est fausse - et récusée par les invité-es - mais le procès est clos avant même d’avoir commencé.
Florian Delorme, dont l’inculture juridique et féministe est manifeste, débute alors cette émission par ces deux questions : la première posée concernant la Tunisie : « Est-ce que la situation est peu ou prou la même ? » et concernant l’Égypte : « Est-ce que les choses ont avancé, ou pas tant que ça ? » suivi de : « Le bilan est mitigé ». Ensuite, est suivie, concernant les deux pays, une question sur l’évolution de « la frange la plus radicale des conservateurs islamiques ». Quant à ses propres ‘analyses’, en voici une expression :
« On voit qu’on a beaucoup de mal à avancer sur ce terrain-là. […] Qu’est ce qui bloque ? » Puis il évoque, concernant la nomination en Tunisie d’une femme première ministre, une approche en terme « de verre à moitié plein et à moitié vide. », et j’entends, concernant le Maroc, qu’ « il y a toujours des limites »…
- En une année, ses prismes, présupposés - j’ai du mal à employer le terme d’ « analyses » - ne semblent pas s’être enrichis. Est-ce vraiment trop demander, qu’en la matière notamment, ces hommes soient remplacés par des femmes compétentes ? Et sur France Culture, ils sont nombreux à être concernés. (Cf. Culture. Patriarcale. France culture, Hommes. Journalistes, Patriarcat)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Dépôts de plainte) : (mars) 2021. Nous toutes publie les résultats de l’appel à témoignages lancé en mars 2021 sur « l’accueil des victimes de violences sexuelles et sexistes en commissariat et gendarmerie », auquel 3500 femmes ont répondu.
- Banalisation des faits : 67,8% ;
- Refus de prendre la plainte ou découragement de porter plainte : 56,5 % ;
- Culpabilisation de la victime : 55,2 % ;
- Moqueries, sexisme ou propose discriminants : 29,8 % ;
- Solidarité avec la personne mise en cause pour violences : 26, 2 %
Quelques réactions entendues :
- Madame, on ne reste pas quand ça se passe mal ;
- Vous avez de la chance; c’est à la mode les violences conjugales ;
- Vous risquez de gâcher sa vie et le reste de sa scolarité ;
- Les mots et insultes, ç’est pas grave, tout le monde s’est déjà fait insulter ; il n’y pas mort d’homme…
N.B. Pour rappel, l’article 15-3 du code de procédure pénale précise que : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » C’est tout. À réécrire. (Cf. Droit, Justice)
Violences à l’encontre des femmes (Dickens Charles) : 1861. Charles Dickens [1812-1870], dans Les grandes espérances, auteur de :
« Mon père, Pip, il s’adonnait à la boisson, et quand il était pris de boisson, il cognait sur ma mère, quelque chose d’épouvantable. C’est à peu près le seul cas où il cognait d’ailleurs, sauf quand il cognait sur moi. […] Rapport à ça, maman et moi, on s’est sauvés plusieurs fois de chez mon père ; et alors, ma mère elle se mettait à travailler et elle me disait : Joe, qu’elle me disait, maintenant, grâce à Dieu, tu vas avoir un peu d’instruction, mon petit et elle me mettait en classe. Mais mon père, il avait quelque chose de bon dans le fond du cœur, et alors il [ne] pouvait pas se passer de nous. Alors il arrivait avec une troupe formidable et il faisait tant de potin devant la porte des maisons où qu’on se trouvait que les gens, ils étaient dans l’obligation de ne plus vouloir entendre parler de nous et de nous livrer à lui. Et alors il nous ramenait chez lui et il nous cognait dessus. Et ça, vois-tu, Pip, […] ça a fait obstacle à mon instruction. » 265 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Violences à l’encontre des femmes. Dire… :
Violences à l’encontre des femmes (Dire…) (1) : Dire les violences, ce n’est pas les dénoncer ; dénoncer, ce n’est pas demander justice ; demander justice, ce n’est pas obtenir justice ; obtenir justice, ce n’est pas dénoncer ce qui produit ces violences.
Violences à l’encontre des femmes (Dire…) (2) : On peut longtemps parler « dans le vide », et n’entendre pas même celui du son d’un écho…
Le monde des ‘psys’, du moins celui qui se limite à cette demande de « parole », n’est, sauf exceptions, ni féministe, ni pacifiste ; en retarde-t-il l’avènement ? (Cf. Droit, Justice)
Violences à l’encontre des femmes (Dire…) (3) : Ce ne sont pas tant les violences infligées qui sont les plus difficiles à dire que celles subies et tues. Les premières relèvent en effet de l‘exclusive responsabilité de celui / celle qui les imposent ; dans les secondes, les victimes, volens nolens, en sont nécessairement partie prise, parties prenantes ; en subissant ces violences, elles en deviennent, peu ou prou, malgré elles, à leur encontre et victimes et parties prenantes. (À prolonger)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Dire… :
Violences à l’encontre des femmes (Dire…) (1) : (10 octobre) 2022.
« […] Tout est organisé pour qu’on soit isolées. On n‘est pas censées en parler en public, on n‘est pas censées en parler en soirée, on n‘est pas censées en parler à des inconnu-es, on n‘est pas censées en parler aux gens à qui on en a déjà parlé, parce que ce serait un peu trop dur pour eux ; on est censées en parler un petit peu, mais pas trop, pas faire de blague, pas raconter des détails ; il [ne] faut pas trop pleurer parce que ça déstabilise, il [ne] faut pas trop être joyeuses parce que les gens oublient qu’on est traumatisées. Tout ça fait que, du coup, on n’a plus le droit jamais de prononcer ce mot. » 266 (Cf. Femmes. Silence, Langage. Mots, Violences. Viols)
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Fiodor Dostoïevski :
Violences à l’encontre des femmes (Dostoïevski Fiodor) (1) : 1861. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Souvenirs de la maison des morts, auteur de :
« Tout le monde connaissait son histoire et savait qu’il avait tué sa femme par jalousie - moins d’un an après son mariage et qu’il s’était livré lui-même à la justice, ce qui avait beaucoup adouci sa condamnation. Des crimes semblables sont toujours regardés comme des malheurs, dont il fait avoir pitié. » 267 (Cf. Relations entre êtres humains. Jalousie. Pitié, Justice)
Violences à l’encontre des femmes (Dostoïevski Fiodor) (2) : 1873. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Journal d’un écrivain. Le milieu, auteur de :
« Un moujik roue de coups sa femme, de longues années durant, au point de l’estropier, il la maltraite pire qu’un chien. Désespérée, résolue au suicide, elle recourt à demi folle à son tribunal de village. Là on la renvoie en ronchonnant d’un ton indifférent : ‘Vivez en meilleur accord’. C’est cela la pitié ? » 268 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes, Justice, Histoire)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Drucker Léa) : (23 février) 2019. Léa Drucker recevant le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie des Césars, auteure de :
« Je voudrais dédier cette récompense à toutes les Miriam, toutes ces femmes qui ne sont pas dans une fiction, qui sont dans cette tragique réalité. Je pense à toutes celles qui sont parties, celles qui veulent partir, celles qui ne partiront pas, celles qui auraient dû partir. Je pense à elles, je pense à toutes les personnes qui les accompagnent, leur famille, leur entourage, les associations qui ont trop peu de moyens et qu’il faut aider. Je pense à toutes ces femmes-là.
La violence commence souvent par les mots, tous ces mots qu’on utilise tous les jours, et on croit qu’ils sont ordinaires. On les utilise sous couvert d’humour, parfois par des effets de groupe. On ne se rend pas compte que ces mots-là sont déjà le début d’une menace et le reflet d’une idéologie et d’une pensée dont on n’a pas forcément conscience.
Même les plus ordinaires et les plus banals peuvent constituer le début d'une menace. Ces mots sont le reflet d'une pensée dont on n'a pas tout à fait conscience mais qu’on doit combattre en semble, hommes et femmes. Moi, je suis fière de ce récit de l'envol d'une femme raconté par un homme.
Je voudrais juste saluer toutes les femmes, toutes les féministes qui écrivent, agissent, prennent la parole et défendent au quotidien la cause des femmes, et qui bravent parfois des tempêtes d’insultes et d’agressivité en tout genre.
Je voudrais les remercier parce qu’elles m’ont permis, en s’éveillant, d’être la femme que je suis aujourd’hui. » (Cf. Féminismes. Féministes, Langage. Mots, Politique. Idéologie)
Violences à l’encontre des femmes. Alexandre Dumas, fils :
Violences à l’encontre des femmes (Dumas. Alexandre, fils) (1) : 1872. Alexandre Dumas, fils [1824-1895], dans son texte Tue-là !, auteur [à un homme] de :
« Et maintenant, si malgré tes précautions, tes renseignements, ta connaissance des hommes et des choses, ta vertu, ta patience et ta bonté, si tu as été trompé par des apparences ou des duplicités; si tu as associé à ta vie une créature indigne de toi ; si, après avoir vainement essayé d’en faire l’épouse qu’elle doit être, tu n’as pu la sauver par la maternité cette rédemption terrestre de son sexe ; si, ne voulant plus t’écouter, ni comme père, ni comme ami, ni comme maître, non seulement elle abandonne tes enfants, mais va, avec le premier venu, en appeler à d’autres dans la vie, lesquels continueront sa race maudite en ce monde ; si rien ne peut empêcher de prostituer ton nom avec son corps, si elle te limite dans ton mouvement humain ; si elle t’arrête dans ton action divine ; si la loi qui s’est donné le droit de lier s’est interdit celui de délier et se déclare impuissante, déclare toi, personnellement, au nom de ton Maître, le juge et l’exécuteur de cette créature.
Ce n’est pas la femme, ce n’est même pas une femme ; elle n’est pas dans la conception divine, elle est purement animale : c’est la guenon du pays de Nod, c’est la femelle de Caïn ;
- Tue-là. » 269
- Du même, concernant les Communardes : « Nous ne dirons rien de leurs femelles, par respect pour nos femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. » 270 (Cf. Culture, Êtres humains, Relations entre êtres humains. Haine des femmes, Femmes. Animalisation des femmes. « Femelles », Hommes, Histoire, Sexes. […])
Ni cité, ni évoqué par Wikipédia.
Violences à l’encontre des femmes (Dumas. Alexandre, fils) (2) : Lu ce jugement de la Princesse de Metternich [1836-1921] concernant Alexandre Dumas fils [1824-1895] :
Il « voyait le monde plus laid qu’il ne l’est réellement, il s’acharnait à découvrir sous toute action un mobile bas, les femmes lui semblaient dénuées de toute élévation de sentiments et il avait pour le genre humain en général un profond mépris. […]
Il creusait à plaisir dans le cœur humain et n’en retirait que des déchets. » (Cf. Êtres humains. « Déchets », Relations entre êtres humains. Mépris) 271
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Église catholique) : (7 juin) 2019. Concernant les violences sexuelles commises par des prêtres catholiques, Marie-Claire Réault, interrogée par La Croix, déclare :
« Quand on était jeunes, on nous a tellement cassé les pieds avec les histoires de virginité avant le mariage… Quand je vois ce que se sont permis certains prêtres, je me dis qu’ils étaient quand même gonflés ! » 272 (Cf. Femmes. Vierges, Patriarcat. Église catholique)
Violences à l’encontre des femmes. Enquêtes :
Violences à l’encontre des femmes (Enquêtes) (1) : Toutes fausses, car aucune ne peut être vraie. 273 Le plus grave est que l’on ait pu penser qu’elles pussent ne pas l’être. Plus grave encore : chaque violence passée au tamis d’une quantification - impossible - efface un peu plus encore la mémoire des victimes. C’est à chacune d’entre elles qu’il faut redonner vie. (Cf. Penser. Vérité)
* Ajout. 22 juin 2015. Pour élargir, approfondir le constat, Cf. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Du contrat social, auteur de :
« Les quantités morales manquant de mesures précises, fût-on d’accord sur le signe, comment l’être sur l’estimation ? » 274
Violences à l’encontre des femmes (Enquêtes) (2) : 2007. Lu, dans Le livre noir de la condition des femmes, concernant les violences dites conjugales, sous l’intitulé : Nécessité de cerner l’ampleur du phénomène :
« L’absence de données statistiques homogènes et fiables constitue une entrave à la prise de décision publique en matière d’aide aux victimes et de prévention. » 275
- Et l’absence de connaissance du nombre ‘homogène et fiable’ des victimes des guerres dans le monde a t-elle gêné, retardé, handicapé, interdit les pensées et les mobilisations pacifistes ?
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Équivalence) : (29 septembre) 2016. Entendu sur France Culture, dans une émission consacrée aux ‘sorcières et amazones’ :
« […] Le déferlement de violences peut être aussi le fait des femmes » ;
« [...] Les hommes souffrent d’avantage sinon plus que les femmes » ;
« […] Les femmes sont responsables aussi, beaucoup, de la violence des hommes ».
276 Comparer les dominé[e]s avec les dominant[e]s, c’est nier la domination.
Et tout ça cautionné au nom de la « culture » … (Cf. Culture. France Culture, Patriarcat. Domination masculine)
Violences à l’encontre des femmes (« Erreur ») : (21 juin) 2015. Après dénonciation par la droite, front national inclus, Yacine Chouat, nommé par Jean-Christophe Cambadélis, le 20 juin 2015, secrétaire national adjoint du parti socialiste en charge de l’intégration, démissionne, le 21 juin. Il avait été condamné en 2010, puis en 2011 en appel, pour « violences conjugales aggravées sur conjointe ».
Il déclare « avoir commis une erreur » - et non une faute, une condamnation, une violence qu’il aurait pu regretter - affirme que « la justice est passée » et « avoir payé sa dette ».
Quelle est la nature de cette « dette » ? À qui l’aurait-il payé ? La justice lui aurait-elle signé une reconnaissance de dette ? Une condamnation vaut-elle excuse, engagement ? Où est enfin l’analyse politique ? Et il termine ainsi :
« C'est avec tristesse que je constate que dans la France d'aujourd'hui on n'a pas droit à une deuxième chance quand on est musulman. » Quel amalgame honteux ! 277 (Cf. Justice, Patriarcat, Politique. Racisme)
- Le Parisien évoque pour sa part « une erreur de casting ». 278
Violences à l’encontre des femmes (Expertise) : (6 septembre) 2024. Lu sur Franceinfo : « Le procès de Dominique Pélicot, jugé à Avignon pour avoir drogué sa femme et l'avoir fait violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet, s'est poursuivi aujourd'hui. Un expert psychologue a été auditionné aujourd'hui. Il a notamment abordé l'impact traumatique de la révélation des faits sur la fille de Gisèle Pélicot, la victime : ‘Elle semble posséder une capacité de résilience plutôt bonne et se sent capable d'assumer une confrontation, mais se dit pleine de dégoût et de haine envers son père’, conclut l'expert. »
Quelle aberration quelle absurdité, quelle horreur, quelle honte !
Toutes ces expertises lors de procès doivent être sinon interdites, du moins radicalement critiquées, dénoncés, récusées. (Cf. « Sciences » sociales. Psychiatrie)
Violences à l’encontre des femmes (« Faits divers ») : Si l’on considère que ce que l’on a nommé les « faits divers » sont plus simplement la réalité de la vie, et si l’on prend en compte le mépris dont ils furent pendant si longtemps l’objet - « les chiens écrasés » - alors on comprend mieux l’une des si nombreuses raisons qui expliquent la chape de plomb qui ont recouvert dans la presse et dans la société les violences à l’encontre des femmes et des enfants. (Cf. Politique. Médias)
Violences à l’encontre des femmes (« Fantasmes ») : Peuvent aisément remplacer les ‘pulsions’. Très utiles, surtout pour les avocat-es des assassins. Et ne jamais oublier que ce ne sont qu’une certaine catégorie d’hommes, pas les plus respectables, qui ont persuadé les femmes - dont ils ignoraient tout - qu’elles avaient des « fantasmes », les ont construits et les leur ont fourgués dans la tête, au gré de leurs seuls intérêts. (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides » :
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (1) : Je récuse la validité de l’emploi de ce terme, que je considère comme très dangereux. Pourquoi ? :
- Un préalable : si l’on voulait établir un équivalent à « homicide », et si l’on voulait ‘cibler’ les violences contre les femmes, il fallait employer le terme de « fémicide », qui renvoie à « femme » et non pas à « Féminicide » qui renvoie à « féminin », dont on sait la signification non seulement ambigüe, mais nécessairement patriarcale.
- Première critique : Employer l’expression de « féminicide » revient donc à définir un crime et / ou un délit en seule fonction du sexe de la victime, en l’occurrence des femmes. Imaginerait-on un nouveau concept qui concernerait les seules victimes, spécifiquement hommes ?
- Deuxième critique : Par l’emploi de ce terme de « féminicide », les hommes auteurs disparaissent. On ne peut dès lors que lire l’évidente régression par rapport aux expressions telles que « violences des hommes », « violences masculines », et a fortiori « violences patriarcales ».
- Troisième critique : Le terme de « féminicide » peut et pourra s’appliquer à toutes les femmes victimes de violences, dans le cadre du couple, dans la rue, dans un bordel, au travail.
Si le terme est intégré dans le droit - il est espéré, programmé par certain-es qu’il le soit - tous les hommes, un proxénète, un « client », un mari, un ex, un père, un inconnu, à équivalence, voire à l’identique, pourront être poursuivis sur un même fondement légal, pour « féminicide ».
- Quatrième critique : Tous les rapports de domination, au cœur de toute analyse féministe du patriarcat et sans lesquels aucune ne peut avoir lieu sont ipso facto maintenus dans l’impossible, dans l’impensable.
- Cinquième critique : Toutes les législations, toutes les analyses, en matière civile, de droit du travail, du proxénétisme, du’ trafic d’êtres humains’ seront donc fondamentalement remises en cause ; et de facto, s’effondrent.
- Sixième critique : Le terme de « féminicide » ouvre la voie et est utilisé, légitimé, pour justifier la création de tribunaux spéciaux - déjà existants - chargés de ces violences. Dès lors, les femmes victimes ne sont pas jugées selon les mêmes critères que les hommes victimes, ce qui ouvre la voie à un traitement différencié, à des tribunaux spéciaux, à des critères de jugements spéciaux - voire à les retirer du droit commun.
Les justifier au nom de la compétence des juges parce qu’ils/elles seraient spécialisées est une injure à l’intelligence.
N.B. Nombreuses sont ceux et celles, féministes incluses, qui justifient cette loi en arguant que les femmes sont agressées « parce qu’elles sont femmes ». Mais que peut bien vouloir dire cette tautologie ? Qui ne signifie, bien sûr, rien. (Poursuivre et notamment critiquer le texte de l’OMS sur le fémicide) (Cf. Femmes. « Féminin ». « Politiques ». Schiappa Marlene, Violences. Patriarcales)
* Ajout. 23 septembre 2019. Entendu ce jour, concernant le féminicide, sur France Culture :
« Une nouvelle thématique s’est imposée […] » Imposée par qui ? Pourquoi ? En quoi une thématique serait-elle un pensée ? (Cf. Penser)
* Ajout. 18 novembre 2019. Pour illustration de la confusion dont ce terme est porteur : vu peint en larges lettres noires sur la palissade entourant le chantier du Musée du Moyen-Âge : Marie Antoinette = féminicide. [!]
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (2) : Dès lors que le terme de « féminicide » sera le terme de référence, les débats, notamment juridiques, se focaliseront, en chaque occurrence, sur la validité ou non de l’emploi du terme, et non sur ce qu’il est censé dénoncer. Et c’est ce par quoi, et ce pourquoi, il a été imposé et s’est imposé. (Cf. Droit, Penser. Pensées. Claires)
* Ajout. 5 mai 2020. Pour illustration, une femme, « retrouvée morte » à Lourches, est assassinée par son compagnon (en garde à vue). Le sous-titre de l’article du Figaro est : La piste du féminicide est envisagée.
* Ajout. 16 janvier 2022. Lu ce jour sur France-Info :
« L'homme a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Si le corps de la victime présentait des traces de brûlures, on en ignore encore les causes. Une autopsie poussée sera menée sur le corps de la victime pour déterminer s'il s'agit oui ou non d'un accident, donc prudence. On ne peut pas encore parler, à ce stade, de féminicide. »
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (3) : (29 juin) 2020. Suite : Pour illustration mais ici concernant le nombre, lu sur Franceinfo ce ‘débat’ :
« Un homme de 54 ans a été placé en garde à vue après avoir tué son épouse de plusieurs coups de couteau à leur domicile de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Il a reconnu les faits, selon le parquet de Nanterre. Il s'agit au moins du 34e féminicide de l'année, selon l'AFP », suivi de la discussion suivante :
- Commentaire : Vous annoncez le 34ème féminicide à Rueil Malmaison or, selon #Noustoutes il s'agit du 48ème. Savez-vous pourquoi cette différence ?
Et surtout, en quoi mériterait-elle d’être relevée ? Ou plutôt : on en voit l’inanité.
- Réaction au commentaire : Pour être précis, il s'agit du 47e féminicide de 2020. Selon le décompte associatif repris par #NousToutes. Dans cette note de Blog [Fact checking] de 2019, l'AFP défendait son bilan en expliquant que certains cas évoqués par les associations n'étaient pas encore confirmés par les enquêtes, voire démentis.
- L’AFP serait donc l’instance (parmi nécessairement d’autres) qui décide ce qui relève du « féminicide ».
Pourquoi les féministes n’abandonnent-elles pas ce terme ?
Parce qu’il serait censé les unir ? (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes, « Sciences » sociales. Quantification)
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (4) : (23 juin) 2021. Dans Le Canard enchaîné, Sorj Chalandon dans un article intitulé Femmes abattues, écrit :
« C’est à la recherche de quelques réponses que l’enquête d’Aurélia Braud [Pour le pire. Arte. 23 juin 2021] nous entraine, interrogeant trois féminicides parmi les 109 commis en 2017 [suivent trois noms de femmes], chacune assassinée par un minotaure que se pensait maître de leur vie. » 279
- Ainsi, tel qu’exprimé, chaque femme est assimilée au crime dont elle fut la victime ; ce ne sont pas des « minotaures » [mi-hommes, mi-taureaux] qui les ont tuées, mais des hommes plus simplement ; ils ne se sont pas « pensés » maîtres de leur vie ; ils ont été effectivement les maîtres de leur vie puisqu’ils les ont assassinées. (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes, Politique. Animalisation du monde)
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (5) : (24 juin) 2021. Lu dans Le Figaro :
« Trente ans de prison contre l’accusé d’un féminicide. »
Exit les assassins…
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (6) : (10 janvier) 2022. Emmanuel Macron, à Nice, auteur de :
« Notre pays vit des féminicides… ». (Êtres humains Vies / morts, Langage. Verbe)
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (7) : (29 janvier) 2022. Un policier, déjà auteur de violences, lequel avait déjà suivi un stage de « sensibilisation », tue sa compagne avec son arme de service et disparait : le titre de Ouest-France est :
« Une femme retrouvée morte dans sa baignoire à Paris. Ce que l’on sait de ce féminicide. »
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (8) : (5 octobre) 2022. L’emploi du terme de « féminicides », est-il la dernière digue langagière, conceptuelle, avant l’emploi de l’expression de « violences patriarcales » ?
En tout état de cause, il tend à remplacer ceux de : « violences sexuelles et sexuelles ».
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (9) : (3 janvier) 2024. Lu sur Franceinfo que, selon Nous toutes, le bilan 2023 des « féminicides » est de 134, tandis que celui du gouvernement de 94. Et c’est sur cette différence statistique - ou chaque femme assassinée, telle qu’intégrée dans ce qualificatif, est réduite à être ‘une’ - que l’on va jauger, juger de la politique gouvernementale.
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (10) : (8 avril) 2021. Christelle Taraud, dans la première émission de la série de France Culture : « Féminicides. La guerre mondiale contre les femmes », avant de définir ce terme, parle de : « violence féminicidaire », de « femmes fémicidées », puis, j’entends aussi ceux de « guerre fémicidaire », de « continuum fémicidaire » et enfin de « fémicidaires », signifiant d’après ce que j’en ai déduit : ceux qui commettent ces « féminicides ».
Il y a là, dans cette réitération de ce terme, ainsi décliné, une volonté de l’imposer dans le vocabulaire, dans la pensée, dans la politique féministe, que je récuse. On ne définit pas un système d’oppression de domination - alors qu’il s’agit sans cesse de l’interroger pour tâcher de le mieux saisir, le mieux comprendre - aux innombrables manifestations, en fondant son approche par ses « victimes », terme, qui, circonstance aggravante, se réfère au « féminin » et non aux « femmes ».
L’ajout d’autres termes : « colonie », « misogynie », de « genre », « processus systémique », « capitalisme », de « sur-violence » révèlent l’insuffisance, l’impuissance par l’emploi d’un seul mot, à repenser un système de domination, aux multiples modalités d’expressions.
Les hommes, invisibilisés, ne peuvent faire partie de l’analyse, à moins de considérer comme telle cette analyse-présentation-définition de Christelle Taraud, :
« Le féminicide n’est jamais un acte spontané. Comme les génocides, ils font l'objet d'une très longue préparation. Il faut donc saisir le spectre de violences qui autorise des hommes à tuer. » C’est tout.
* Ajout. 9 avril 2024. Suite de la même série d’émissions sous l’intitulé : « En toute impunité ». J’entends : « le féminicide de sa sœur », « féminicide involontaire », « un cadre de féminicide très classique », à nouveau « le féminicidaire », « passage à l’acte féminicidaire », « féminicidaire par défaut ».
Et enfin, car c’est bien là me semble-t-il l’un des projets de la diffusion de la banalisation de ce terme : « Le terme de féminicide n’est toujours pas dans la loi. »
Si cela devait être le cas, nombre d’article du code pénal : « viol », « assassinat », « crime », « proxénétisme », entre autres… auxquels on peut ajouter nombre de textes de droit européen, international, risquent fort sinon de disparaître, du moins d’être redéfini sur la base de l’insertion du terme de « féminicide » dans le droit. Et, j’entends en sus, au cours de cette émission, ses prétentions impérialistes : sont en effet cités « le droit à l’avortement et à la contraception », les « violences psychologiques », le « harcèlement moral » et « le suicide forcé ».
Concernant à nouveau, les analyses sous-jacentes, concernant « les hommes », dans j’ai entendu aujourd’hui : « C’est un problème d’hommes » ; et concernant le rapport des hommes au droit, à l’État : « J’ai assigné l’État » ; « Il y a des anomalies à pointer » et : « Le droit n’est pas plus neutre que les autre institutions », dont il est difficile de ne pas constater la pauvreté, voire l’absence d’analyse.
* Ajout. 10 avril 2024. Sous l’intitulé « Femmes de mauvaise vie », il est tout à la fois question des « travailleuses sexuelles » (terme employé à quatre reprises), des femmes « trans », des treize femmes assassinées en 1989 à l’École polytechnique de Montréal par un homme qui haïssait les femmes et les féministes, des trois femmes Kurdes assassinées à Paris par l’État Turc en 2013, de Jeanne d’Arc… J’arrête là : cette confusion m’est insupportable.
Concernant l’emploi du mot « féminicide », j’entends : « un triple féminicide », « féminicides politiques » et même : « femme victime de féminicide par conjoint ».
Quant à l’analyse qui justifierait l’emploi de ce terme, j’entends que « les femmes [qui pourraient être séparées en « femmes-ventres et femmes-sexes »] sont subalternes dans les rapports sociaux », et qu’il est question de « sociétés d’inégalité de genre ».
* Ajout. 11 avril 2024. Dernière émission intitulée : « Ils voulaient nous enterrer ». J’entends définir le féminicide comme « le meurtre d’une femme parce que femme » [penser par comparaison au ‘meurtre d’un homme parce que homme’], évoquer des « cas de féminicides », aborder un « féminicide pas encore étudié comme tel », « travailler sur les féminicides », qu’il s’agit d’ « un outil qui permet de saisir l’ensemble de la gamme » et d’un « système féminicidaire ». J’entends aussi lier les femmes aux plantes, aux animaux, à la terre, « le féminicide et l’écoside », suivi de : « Ils pensaient nous enterrer et ils ne savaient pas que nous étions des graines. »
Concernant les hommes, je lis : « le mandat masculin », j’entends : « Nous devons nous concentrer davantage sur les hommes », « ce qui me fait peur, c’est l’homme » et la conclusion finale, exprimée par Christelle Taraud, concernant les relations entre les hommes et les femmes « On ne peut pas opposer les uns aux autres, les hommes aux femmes », précédé de : « Nous nous sommes trompées ». De qui parle Christelle Taraud : des femmes, des féministes ? À quel titre ? Sur quel fondement, lequel serait suffisamment puissant pour imposer la disparition du « patriarcat » pour lui substituer celui de « féminicide » ?
N.B. Une précision : Ajouter, ça et là, le terme de « patriarcat » ne change rien aux critiques du terme de « féminicide » : l’un est antinomique à l’autre. (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. Taraud Christelle)
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (11) : (7 mai) 2024. Entendu dans l’émission Les pieds sur terre. Les chemins de la réussite de France Culture :
« Il [mon père] a fait le 29ème féminicide avec ma mère ». (Cf. Verbe. Faire)
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (12) : (2 juin) 2024. Lu sur Franceinfo : « Dans un pays qui enregistre l'un des plus forts taux de féminicides par nombre d'habitants au monde, Claudia Sheinbaum promet, en tant que première présidente du Mexique, d'inscrire la lutte contre l'impunité et les violences sexistes et sexuelles au cœur de sa politique en cas de victoire. En 2023, ‘3.800 femmes ont été tuées, même si seulement 24% de ces meurtres sont investigués comme des féminicides par les ministères publics, ce qui contribue à l'impunité pour ces crimes’, explique Delphine Lacombe, sociologue et politiste, chargée de recherche au CNRS.
N.B. Pourquoi, comment - sans omettre les autres graves critiques de ce terme - alors qu’il est évident que le seul emploi du mot « féminicide » ne peut que contribuer à faire drastiquement diminuer le nombre de violences à l’encontre des femmes, les féministes continuent-elles globalement - sans être à même d’en justifier le bien-fondé - à l’employer ?
Et pourquoi est-ce que je me sens obligée de répéter une évidence, qui devrait se suffire à elle-même ?
* Ajout. 3 septembre 2024. Ma dernière phrase : impudente.
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (13) : (2 septembre) 2024. Je découvre l’existence d’une « Union nationale des familles de féminicides » : [!]
Je comprends progressivement qu’une fois qu’un tel mot, après tant d’autres, a été imposé, il faut alors recomposer phrases, les pensées, qui sont alors nécessairement déstructurées et recomposées sur d’autres fondements (Poursuivre) (Cf. Famille, Langage, Penser)
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (14) : (8 septembre) 2024. Entendu sur France Culture ou France Inter : L’athlète Ougandaise Rebeccca Cheptigei « a été victime d’un féminicide. »
Au lieu et place de :
Emmanuel Ibrahim Rotch, le mari Rebeccca Cheptigei est poursuivi pour meurtre ; il avait arrosé d’essence son épouse, puis mis le feu, en présence de leurs enfants et a été arrêté ; brûlé vive, elle est décédée à l’hôpital. Rebeccca Cheptigei fut, comme des millions de femmes dans le monde, agressée, tuée par un homme, son mari : meurtres le plus souvent impunis. Elle sera enterrée le 14 septembre.
- Je lis aussi : « Un acte lâche qui a conduit à la perte d’une grand athlète » [Le président du comité olympique Ougandais]
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (15) : (novembre) 2024. Si vous voulez découvrir toutes les incohérences que recouvre le terme de « féminicide », il faut lire l’article de Laurène Daycar, Féminicide, dire le crime (sic), paru dans Le Monde Diplomatique (p.1, 22, 23). Je lis : :
« meurtre misogyne », « sphère conjugale », « violences masculines », « crimes exécutés par des moyens sexuels », « démonstration du continuum des violences », « conjugalité », « toutes les formes de violences conduisant à une mort prématurée [!] des femmes », « exactions massives contre les femmes », « contextes familiaux et conjugaux », « féminicides intimes », « féminicide sexuel systémique », «sur-meurtre», « avoir subi un viol », « crimes de genre systémiques », « féminicide non-intime », « partenaire », « crimes de genre», « violences sexuelles et sexistes », « pères violents », « violences y compris létales », « homicides des femmes », « droit des travailleurs et travailleuses du sexes. » Et l’article se conclut par :
« La plupart de ces violences restent dans le flou. »
Il ne [me] suffit plus d’écrire que Le Monde Diplomatique « n’a aucune culture féministe. » Cette absence de culture qui exclue la moitié des habitants de la planète de la [pensée] politique- - plus de 3 milliards de personne tout de même, sans oublier les enfants qu’elles élèvent - est une politique patriarcale qui se contrefiche de leurs vies et qui donc s’en satisfait.
N.B. Quant à la photo - qui illustre l’article - de Ruth Marten, All about Eve. 2023, représentant une tête de femme penchée, écrasée par une très imposante, nécessairement fausse, chevelure, elle m’a fait penser à la tête d’une femme, impassible, sur billot.
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (16) : (décembre) 2024. Je lis dans l’article Au Mexique, le bilan contrasté d’un président populaire du Monde Diplomatique (p.11) qu’au Mexique « les homicides atteignent le chiffre de 200.000 dont plus de 5.000 féminicides. »
La comparaison de chiffres, de statistiques fondé-es, construit-es selon des normes différentes, révèlent l’importance de l’erreur conceptuelle de l’emploi du terme de « féminicides » et ses graves conséquences : avaliser l’insigne faiblesse du nombre des violences des hommes à l’encontre des femmes.
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (17) : (18 janvier) 2025. Lu sur Franceinfo : « Une suspicion de féminicide […]. »
Au lieu et place de : « Une femme a été tuée. Son compagnon est suspecté. »
Violences à l’encontre des femmes (« Féminicides ») (18) : (17 septembre) 2025. Yvan Jablonka, interrogé par ailleurs, par deux hommes, sur France Culture, auteur de :
- « La violence du féminicide »
- « Les femmes viennent consommer du féminicide ».
N.B. Consommer : « Mener (une chose) au terme de son accomplissement ».
------------
Violences à l’encontre des femmes (Fielding Henry) : 1749. Henry Fielding [1707-1754], dans l’Histoire de Tom Jones, auteur de ce dialogue entre M. Western et sa sœur :
« Je ne suis qu’une femme, vous savez, mon frère, et mes opinions ne signifient pas grand-chose. D’ailleurs…
- Je le sais bien que vous êtes une femme s’écria le squire, et cela vaut mieux pour toi ; si tu étais un homme, j’te promets bien qu’il y a longtemps que j’taurais donné une pichenette.
- Hé oui, dit-elle, et dans cette pichenette-là réside toute la supériorité que vous vous prêtez. Vos corps sont plus forts que les nôtres, non vos cervelles. Croyez-moi, il est bon pour vous que vous puissiez nous battre ; sans quoi telle est la supériorité de notre intelligence que nous ferions de vous tout ce que sont déjà les hommes braves, sages, spirituels et polis : nos esclaves. » 280 (Cf. Dialogues, Femmes. Intelligentes, Hommes. Féminisme)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Brigitte Fontaine :
Violences à l’encontre des femmes (Fontaine Brigitte) (1) : 1966. Brigitte Fontaine. Jacques Canetti , dans Dévaste-moi :
« Dévaste-moi / Essouffle-moi / Envahis-moi / Et pille-moi / Dépense-moi / Gaspille-moi / Saccage-moi / Dilapide-moi / Lapide-moi / Et râpe-moi / Liquide-moi / Émiette-moi / Ravage-moi / Et presse-moi / Et puis broie-moi / Et puis noie-moi/ Et puis bois-moi / Écaille-moi / Colonise-moi / Piétine-moi / Déglutine-moi / Extermine-moi/ Écrase-moi / Délabre-moi / Ratisse-moi / Corrode-moi / Démantèle-moi / Désintègre-moi / Massacre-moi/ Écrabouille-moi
Mais c'est qu'il le ferait la brute ! »
Violences à l’encontre des femmes (Fontaine Brigitte) (2) : 2019. Brigitte Fontaine dans Vendetta, auteure de :
« Masculin assassin / Masculin assassin / La vendetta du con / C'est la mort du couillon. / Qu'on empale tous les mâles
Ni pardon, ni manif'/ Assez parlementé / Vive la lutte armée
Abats le sexe fort. / A mort, à mort, à mort / Abats le sexe fort. / A mort, à mort, à mort / Assez parlementé / Vive la lutte armée
Assez parlementé/ Vive la lutte armée /
Qu'on empale tous les mâles / Et qu'ont châtre les psychiatres
Vive la lutte armée / Assez parlementé / Vive la lutte armée
Masculin assassin/ Masculin assassin
Abats le sexe fort. / À mort, à mort, à mort. / Mort, mort, mort, mort, mort.
Quand une chanteuse a bien chanté, / Quand une chanteuse a bien chanté
Tous les hommes, tous les hommes, /
Tous les hommes ont le droit de l'embrasser. »
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. France :
Violences à l’encontre des femmes (France. Années 1920) (1) : 1972. Lu, dans le livre intitulé Histoire de Michèle :
« […] Les cris, les coups, dans le quartier, personne ne s’en inquiétait… on disait : ‘Tiens, c’est la mère machin qui dérouille’, et puis…, c’est tout. Personne ne se mêlait des affaires des autres. » 281 (Cf. Histoire)
Violences à l’encontre des femmes (France. 1944) (2) : (3 juin) 1944. Jean Guéhenno [1890-1978] note dans son Journal :
« Hier Paulhan [1884-1968] nous a conduit à Luna-Park (parc d’attraction situé près de la Porte Maillot). Si l’on peut juger d’un monde aux plaisirs qu’il se donne, celui où nous vivons est affreux. […] Nous nous promenions parmi les jeux de balles ou d’anneaux, quand soudain, voici ce que nous avons vu : sur un lit, à peine recouvert d’un drap, une femme à peu près nue ; elle nous regardait approcher ; elle avait l’air d’un bête ; elle est là, couchée tout le jour. Au-dessus d’elle une cible ; le plus habile, en lançant une balle, se fait reverser le lit et tomber la femme. C’est là, ce qu’on peut voir, à Paris, en 1944. […] Comme nous nous en allions, la femme est sortie de son lit, s’est habillée, et a traversé la place en dansant une gigue égrillarde. Nous avons pu voir que c’est une pauvre idiote. Je ne saurais dire si cela a augmenté ou diminué notre dégoût. » 282
Violences à l’encontre des femmes (France. 2016) (3) : (20 octobre) 2016. Info Le Parisien, relayée par l’AFP, reprise par Le Figaro sous le titre :
« Une lycéenne dépouillée et jetée dans la Seine » :
« Une lycéenne de 17 ans a été violemment agressée puis poussée dans la Seine vers 21h mercredi soir à Paris alors qu'elle était en train de pique-niquer, révèle le Parisien. Alors qu'elle était en train de pique-niquer sur un banc du quai d'Orléans, sur l'île Saint-Louis, cinq jeunes, quatre garçons et une fille, l'ont abordée. Ces derniers lui ont d'abord demandé une cigarette puis de l'argent avant de devenir de plus en plus agressifs. La jeune femme raconte avoir été ‘giflée’ puis avoir reçu ‘des coups de poing et des coups de pied’. À terre, l'un des agresseurs lui volent son sac tandis que les autres la poussent dans la Seine. Puis partent en courant. La lycéenne parvient à sortir de l'eau et a composé le numéro des pompiers. Mais son portable ayant pris l'eau, la conversation est rapidement coupée. Elle sera finalement aidée par une passante. Transportée à la Pitié Salpêtrière, la jeune femme a porté plainte jeudi. Les cinq agresseurs ont disparu, non sans lui avoir volé son sac à dos avec ses cours mais aussi son portefeuille avec ses papiers d’identité, ses cartes bancaires, de cantine, de bibliothèque. Ils sont toujours recherchés. » 283
Violences à l’encontre des femmes (France. 2018) (4) : (1er août) 2018. AFP :
« Un homme a abattu hier sa compagne de 32 ans en pleine rue, à Saint-Christophe-les-Alès (Gard) avant de se suicider avec la même arme. […]
Il s’est écroulé à quelques mètres de sa compagne qui était aussi la mère de ses deux jeunes enfants. » 284 Sur France Inter (Journal de 15 heures), j’entends :
« Le couple était déjà connu pour des violences conjugales. » (Cf. Famille. Couple)
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. France Culture :
Violences à l’encontre des femmes (France Culture) : (9 juillet) 2021. Un journaliste de France Culture assistant à une manifestation féministe à Istanbul pour dénoncer les violences des hommes à l’encontre des femmes, invoquant le nom d’une femme inscrit sur une pancarte, auteur de :
« Elle a perdu la vie ». Non. Elle a été assassinée par un homme. Le même, un peu après, décrit les manifestantes ainsi :
« Elles sont inquiètes mais combatives ». Non. Elles sont (très) en colère et combattantes. 285
Violences à l’encontre des femmes (France Culture) : (16 août) 2021. Sur France Culture dans la série d’émission - en partenariat avec Causette - sans doute un signe d’ « ouverture »… - consacrée à Louise Michel [1830-1905] concernant la question de savoir qui du père ou du fils du « château » était son père, j’entends avec horreur, répulsion :
« Peut-être que les deux y passaient. » 286 (Cf. Femmes. Naturalisée. Remarquables. Michel Louise, Langage, Violences. Déni. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Violences à l’encontre des femmes (France Culture) : (20 novembre) 2022. En toute lucidité, en toute cohérence - sauf à s’excuser - France Culture a volontairement décidé, le jour de la lutte internationale de violences à l’encontre des femmes de consacrer une nuit entière à les justifier. Onze émissions consacrées à Bernard Dufour (intégralement écoutées) : un type, accompagnés de tous ses acolytes : tout simplement ignoble. Il est sans doute difficile dans toutes les archives sonores de France Culture de trouver pire, plus grossier, plus grave.
-------------
Violences à l’encontre des femmes (France Inter) : (8 mai) 2024. Entendu dans l’émission de Fabrice Drouelle, Affaires sensibles de France Inter intitulée Rosetta Cutolo, femme d’honneur (sans guillemet), une histoire de la mafia napolitaine :
« Dans ce monde ultra-violent, les femmes ne sont pas toujours innocentes. »
Une mal-pensée.
Violences à l’encontre des femmes (France Insoumise La) : (24 septembre) 2022. Je re-lis dans le Programme de Jean-Luc Mélenchon pour l’union populaire - édition 2022 - Nos propositions : Égaux donc féministes. En finir avec les violences faites aux femmes.
« Il est urgent de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits dans les meilleurs conditions », puis, concrètement, au plan politique, il s’agit de « remettre en route la justice. » Comment être aussi légers-ères ? non : irresponsables. Comment peut-on dénier, et avec quel mépris, des dizaines d’années de dénonciations, de luttes, d’avancées, notamment juridiques, des femmes et des féministes ? (Cf. Droit. Patriarcal, Hommes. « Politiques ». Mélenchon Jean-Luc, Violences. Gifles)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Luc Frémiot :
Violences à l’encontre des femmes (Frémiot Luc) (1) : (25-26 mars) 2012. Luc Frémiot, procureur, en s’adressant à Alexandra lange qui fut, après son réquisitoire, et les plaidoiries de ses avocates, acquittée de l’accusation de crime (de son mari) après avoir défendu son droit à sa vie et à celle de ses enfants, auteur de :
« C’est la guerre que vous avez vécue… » ; « C’est cela être juge : se mettre à la place des autres » ; « Elle a toujours été seule. Aujourd’hui, je ne veux pas la laisser seule » ; « Vous n’avez rien à faire dans une cour d’assises, Madame. » 287
À quand la poursuite de ceux et celles qui l’ont laissée « seule », avec ses enfants, sous les coups et les tortures pendant plus dix ans ? Non : à quand la mise en œuvre de réelles ruptures politiques et donc traduites juridiquement, afin que, plus jamais, pour quiconque, aucune vie ne puisse ressembler à la sienne et à celle vécue par ses enfants ?
* Ajout. 20 janvier 2014. Du même Luc Frémiot, concernant les violences qu’il nomme « intrafamiliales » : « En 2003, cela n’intéressait personne. » 288
Par quels processus en arrivons-nous si souvent à nier ce qui ne nous concerne pas personnellement ? (Cf. Justice. Légitime défense. Frémiot Luc)
Violences à l’encontre des femmes (Frémiot Luc) (2) : (20 janvier) 2014. Luc Frémiot, concernant le procès de Jacqueline Sauvage déclara :
« Ce n’est pas le droit qui doit évoluer, ce sont les consciences. » 289
Triste, si triste que la parole d’un magistrat qui, un jour, prit une position neuve et courageuse, et dont celle-ci a alors d’autant plus de valeur, de l’entendre justifier l’injustifiable, à savoir que le droit doit rester tel qu’en lui-même.… (Cf. Droit, Êtres humains. Conscience, Femmes. Dénis de l’histoire des femmes et du féminisme, Hommes. Solidaires des femmes en lutte, Justice. Légitime défense. Sauvage Jacqueline. Juger la justice)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Freud Sigmund) : 1930. Sigmund Freud [1856-1939], dans Le malaise de la culture, auteur de :
« […] Une autre difficulté résulte du fait qu’à la relation érotique est souvent associée, outre les composantes sadiques qui lui sont propres (sic), une quantité de penchants directs à l’agression (sic). L’objet d’amour (sic) n’accordera pas autant de compréhension et de tolérance à des complications (sic) que cette paysanne qui se plaint que son mari ne l’aime plus, parce qu’il ne l’a pas battue depuis une semaine. » 290 (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes. Plaintes, Famille. Couple, Relations entre êtres humains. Tolérance, Patriarcat, Violences. Sade, « Sciences » sociales. Psychanalyse. Freud Sigmund)
Violences à l’encontre des femmes (Front national) : (14 mars) 2016. Frédéric Boccaletti, responsable du Front national, proche de Marion Maréchal Le Pen, a dénoncé, dans un communiqué, la participation de Joe Starr à la deuxième édition du Pointû Festival le 21 juin prochain, sur l'île du Gaou : :
« Cet artiste, dont la violence n'a d'égale que la lâcheté, a été condamné à de multiples reprises pour avoir battu plusieurs femmes [...] Joey Starr, engagé politiquement à l'extrême gauche et grand donneur de leçons devant l'Éternel, n'est autre qu'une honte pour sa profession et une insulte vivante pour toutes les femmes victimes de violences. » 291
Un jour ou l’autre, les silences / cautions de la gauche, de la droite, des médias et de tous ceux et celles qui justifient les violences à l’encontre des femmes, politiquement, se paient et sont utilisés par le front national.
Faut-il notamment rappeler la responsabilité de Joey Starr, en tant que membre du groupe NTM (Nique ta mère) ? Quant à la liste de ce que Wikipédia nomme ses « démêlés avec la justice », pour violence ou incitation à la violence, elle est impressionnante.
Tant que, en la matière, ces silences ne seront pas dénoncés, tant que toutes les cautions qui ont été depuis si longtemps apportés à tant d’écrivains, d’artistes, de politiques ne seront pas dénoncés, les attaques contre le Front national, qui ouvre ici un nouveau front, dont les féministes au premier chef devraient s’inquiéter, seront très largement inopérantes. (Cf. Droit. Droits de femmes, Patriarcat. Injures envers les femmes, Politique. Extrême-droite. Front national)
Violences à l’encontre des femmes (Gainsbourg Serge) : (3 novembre) 1982. Serge Gainsbourg [1928-1991], auteur de :
« Les femmes… Pas besoin de gueuler. On peut leur casser la gueule. » 292 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes. Gainsbourg Serge)
Violences à l’encontre des femmes (Gauche) : (7 décembre) 2021. Je lis transmis par le Courrier de la marche mondiale contre les violences et la pauvreté, une Tribune intitulée Ensemble contre les violences sexuelles et sexistes dans nos organisations, signé par des membres - singulièrement individuellement nommés - de la CGT, des Verts, de Libertaires, du PCF, du PS, de la France insoumise, du NPA (Nouveau parti anticapitaliste), de l’UNEF de L’UNSA… Après une référence à #MeToo, j’y lis donc :
« Ce mouvement a obligé la société à entendre davantage la parole des femmes et à moins tolérer ces violences, même si les mesures gouvernementales restent largement insuffisantes. » Ils n’ont même pas été capables d’écrire que ces violences étaient intolérables. Mais cela ne pouvait être écrit, car ces violences sont largement tolérées « à l’intérieur de [leurs] organisations » : « moins » serait donc un progrès. Quant aux critiques de la politique gouvernementale, on mesurera leur virulence. La suite, à l’avenant.
Violences à l’encontre des femmes (Gifle) : « Partez à la première gifle » entendons-nous régulièrement. Non : c’est trop tard. Quand alors ? Quelques exemples : Quand il boude sans explications ; Quand il vous manifeste son agacement suite à un échec qui lui est propre ; Quand il hausse le ton ; Quand il ouvre la porte de votre chambre (ou de la chambre commune alors que vous y êtes) sans frapper ; Quand il est servi sans dire merci ; Quand il ne vous écoute, ni ne vous entend, ni ne vous répond (ou vous renvoie la question, ou vous répond ‘à côté’) ; Quand il ne se rend pas compte de votre fatigue ; Quand il vous fait des compliments qui sonnent (sont) faux ; Quand il vous dissuade sans argument de prendre des initiatives ; Quand il vous laisse démunie dans une situation difficile ; Quand il vous laisse seule organiser un projet censé commun ; Quand il vous fait remarquer le coût de la faveur qu’il vous accorde ; Quand il vous fait une remarque désobligeante ; Quand il fait des commentaires (critiques) sur votre corps, votre apparence, vos vêtements ; Quand il n’est pas heureux de vos succès ; Quand il ne se soucie pas de la contraception que vous avez choisie ; Quand il fait des promesses qu’il ne tient pas ; Quand il vous fait travailler pour lui, comme si cela était normal ; Quand il est en retard, s’absente sans vous prévenir, sans vous en informer ; Quand il raconte à d’autres, sans votre accord, un de vos échecs ; Quand il suggère une décision qui ne vous laisse que peu de choix ; Quand il prend une décision qui vous concerne sans en avoir discuté préalablement et avoir obtenu votre agrément ; Quand il vous compare à sa mère, à votre mère ; Quand il vous parle sans précautions de son, de ses ex compagnes ; Quand il dénigre vos ami-es (et/ou quand vous vous rendez compte que vous les voyez plus) ; Quand il juge, jauge une autre femme sur des critères qui vous déplaisent car ils sont, selon vous, blessants ; Quand il critique (bêtement) les féministes ; Quand il se décharge sur vous de la gestion du quotidien ; Quand il vous impose son menu, son émission, son projet ; Quand il vit sur votre dos ; Quand il ment ; Quand il vous interdit quoi que ce soit, fût-ce une ‘futilité’ ; Quand il fait état sans honte, sans regret, sans engagement ultérieur de relations avec des personnes prostituées. D’autres exemples ? À suivre…
N.B. Ces illustrations (à l’exception du dernier) valent pour chaque partenaire d’un couple (femme incluse), et quelle que soit la nature, la durée dudit couple. (Cf. Famille. Couple)
* Ajout. 13 novembre 2003. En contrepoint. (9 juin) 1869. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à sa nièce Caroline [1846-1931] :
« Te rappelles-tu la dame qu’on a arrêtée, sous les fenêtres du café Riche, le jour où nous dînions ensemble. C’était une dame du monde qui venait de flanquer des gifles à son époux qu’elle avait rencontré au bras d’une cocotte. L’histoire était le lendemain dans tous les journaux. » 293 (Cf. Histoire. Mémoire)
* Ajout. 21 mars 2024. Entendu sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) :
« Elle se prend une gifle. » (Cf. Langage. Sujet)
* Ajout. 4 avril 2024. Entendu sur La 5 : « Elles s’est ramassée une baffe. »
Violences à l’encontre des femmes (Godard Jean-Luc) : 1973. Jean-Luc Godard [1930-2022], auteur de :
« Moi, ce qui me gêne dans Le dernier tango à Paris, ce n’est pas du tout qu’on voit Marlon Brandon beurrer le cul de … comme ça… Je trouve très bien. On devrait même le voir plus longtemps et mieux l’expliquer, pourquoi et comment, et comme ça… » 294 (Cf. Culture. Cinéma. Le dernier tango à Paris. Patriarcale, Enfants. Godard Jean-Luc, Femmes. Artistes. Goya Chantal, Hommes. Grossiers, Penser. Expliquer)
Violences à l’encontre des femmes (Guerini Stanislas) : (18 mai) 2022. Stanislas Guerini, délégué général de LaREM [la république en marche], interrogé sur le proposition de ce même parti de confirmer la candidature de Jérôme Peyrat, ancien conseiller de l’Élysée - déjà condamné pour violences contre son ex-compagne en 2020 - aux élections législatives de juin 2022 - l’a présenté comme un « honnête homme » et a poursuivi :
« Je ne crois pas qu’il soit capable (sic) de violences contre les femmes », suivi de :
« Si j’avais la conviction ou même le soupçon qu’on a affaire (sic) à quelqu’un qui puisse être violent et coupable de violences contre les femmes, jamais je n’aurais accepté cette investiture-là. » Pour enfin conclure :
« Je crois et je suis même infiniment convaincu que ça n’a pas été le cas. »
La parole de M. Guerini l’emporte sur celle de la justice ; elle n’a pas même commune mesure avec elle, tant elle est pour lui hors sujet : mais n’est-ce pas ainsi que la parole des hommes a été protégée, légitimée, sacralisée par le patriarcat ? (Cf. Droit, Justice, Hommes. « Politiques », Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
* Ajout. 22 mai 2022. Jérôme Peyrat a retiré sa candidature. Stanislas Guerini a été promu deux jours après ministre.
Violences à l’encontre des femmes (Guy Gilbert) : (7 avril) 2013. Guy Gilbert, auteur de :
« J’ai été très heureux, enfant. J’ai eu quelque chose de souverain : j’ai été aimé par un homme et par une femme. Mon père, un homme très strict, un peu macho, un peu… Les branlées de mon père, je m’en souviens ! Ma mère (de 15 enfants), une femme pleine d’amour, de miséricorde, de patience. Un équilibre de l’homme et de la femme très important... » 295
- « Les branlées », « l’amour », et « l’équilibre » … (Cf. Relations entre êtres humains. Aimer)
Violences à l’encontre des femmes (Handke Peter) : (20 novembre) 1983. Matthieu Galey [1934-1986] rapporte dans son Journal la teneur d’une visite à Peter Handke. Je lis :
« […] (L’image de) L’angoisse d’un gardien de but [au moment du penalty. 1970] est née du récit d’un professeur de criminologie à Graz [Autriche]. L’histoire d’un jeune homme qui s’est réveillé à côté de sa femme. Par la fenêtre, il voit les arbres qui bouge, et du coup, il étrangle sa femme. Le professeur n’a rien expliqué, mais c’est le seul qui m’ait apporté quelque chose au cours de mes études de droit. » (Cf. Culture, Droit)
N.B. Peter Handke a reçu le prix Nobel de littérature en 2019. (Cf. Culture. Prix Nobel)
Violences à l’encontre des femmes (Hollande François) : 2014. François Hollande, réfléchissant sur la responsabilité d’un chef de l’État, ses limites et ses difficultés, auteur de :
« Qu’est-ce que je pouvais faire avec une affaire comportementale ? C’est toujours très curieux une affaire comportementale. Dominique Strauss-Kahn en a eu une. C’est imprévisible. Et, comment l’éviter ? C’est ça le sujet : comment l’éviter ? » 296
Ou : comment une personne, en l’occurrence un homme « politique », en employant cette formulation révèle sa radicale incompréhension de toute réflexion concernant les hommes, les femmes, les violences, les violences sexuelles, le féminisme, le patriarcat…, y incluant la déresponsabilisation de l’homme violeur et l’assimilation des violences à un « comportement ». (Cf. Hommes. « Politiques ». Hollande François, Langage. Critique de mots : « Affaire », Proxénétisme)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Victor Hugo :
Violences à l’encontre des femmes (Hugo Victor) (1) : 1859. Victor Hugo [1802-1885], dans Les pauvres gens, auteur de :
« J’ai mal fait. S’il me bat, je dirai : Tu fais bien. » 297
Violences à l’encontre des femmes (Hugo Victor) (2) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, évoque la mère Hucheloup qui se plaignait notamment de la démolition de son cabaret en juin 1848. Courfeyac lui promet de la « veng[er] ». Et Victor Hugo poursuit :
« La mère Huchloup, dans cette réparation qu’on lui faisait, ne semblait pas comprendre beaucoup son bénéfice.
Elle était satisfaite à la manière de cette femme arabe qui, ayant reçu un soufflet de son mari, s’alla plaindre à son père, criant vengeance et disant : - ‘Père, tu dois à mon mari affront pour affront’. Le père demanda : - ‘Sur quelle joue as-tu reçu le soufflet ? - ‘Sur la joue gauche’. Le père souffleta la joue droite et dit : - ‘Te voilà contente. Va dire à ton mari qu’il a souffleté ma fille, mais que j’ai souffleté sa femme. » 298 (Cf. Femmes. Arabes, Famille, Relations entre êtres humains. Vengeance, Patriarcat. Permanence)
Violences à l’encontre des femmes (Hugo Victor) (3) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, le jour du mariage de Marius et de Cosette, rapporte les propos du grand bourgeois royaliste M. Guillenormand qui se souvient notamment de son passé :
« Ah ! vertu-bamboche ! qu’il y en avait donc de charmantes femmes, à cette époque-là, et des minois, et des tendrons ! J’y exerçais mes ravages. [...] »
» 299 (Cf. Enfants. « Bâtards », Femmes. Servantes, Violences. « Droit de cuissage ». Hugo Victor)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Jablonka Ivan) : 2016. 4ème de couverture du livre d’Ivan Jablonka - « historien et écrivain » - Laëtitia [Prix Médicis] :
« Laëtitia Perrais avait 18 ans et la vie devant elle. Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, elle a été enlevée. Puis tuée. Par la vague d’émotion sans précédent, ce fait-divers est devenu une affaire d’État. À travers cette enquête de vie, Yvon Jablonka rend à Laëtitia à elle-même. À sa liberté et à sa dignité. »
- Ivan Jablonka : un homme démiurge ?
N.B. Je découvre, non pas sur la page de couverture, mais sur la première page que le titre du livre est : Laëtitia ou la fin des hommes.
- Ivan Jablonka : un homme de démesure ? (Cf. Hommes. « Modestes ». Jablonka Ivan, Patriarcat) 300
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Jean de La Fontaine :
Violences à l’encontre des femmes (La Fontaine Jean de) (1) : 1678. On se souvient dans La laitière et son pot au lait [Livre VII. Fable 9] de Jean de La Fontaine [1621-1695] de :
« Le lait tombe / Adieu, veau, vache, cochon, couvée », mais peu des deux vers suivants, où il est écrit que Perrette :
« Va s’excuser à son mari / En grand danger d’être battue ».
Violences à l’encontre des femmes (La Fontaine Jean de) (2) : 1668. Jean de La Fontaine [1621-1695], auteur de :
« Je ne suis pas de ceux qui disent : Ce n'est rien ;
/ C'est une femme qui se noie.
/ Je dis que c'est beaucoup ; et ce sexe vaut bien
/ Que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie […]. » 301
- Lu, sur le site (ou est notamment lisible La femme noyée, dont les quatre premiers vers sont ici reproduits), de l’Association du Musée Jean de La Fontaine :
« Ce conte (plus que fable) ou plutôt plaisanterie se trouve dans de nombreux recueils (fabliaux…) […]. »
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Landru André Désiré) : (8 novembre) 1921. Colette [1873-1954], chroniqueuse judiciaire, assistant au procès d’André Désiré Landru [1869-1922], accusé de l’assassinat d’au moins onze femmes, auteure de :
« A-t-il tué ? S’il a tué, je jugerais que c’est avec ce soin paperassier, un peu manique, admirablement lucide, qu’il apporte au classement de ses notes, à la rédaction de ses dossiers. A-t-il tué ? Alors, c’est en sifflotant un petit air, et ceint d’un tablier par crainte de taches. Un fou sadique, Landru ? Que non. Il est bien plus impénétrable, du moins pour nous. Nous imaginons à peu près ce qu’est la fureur, lubrique ou non, mais nous demeurons stupides devant le meurtrier tranquille et doux, qui tient un carnet des victimes et qui peut-être se reposera, dans sa besogne, accoudé à la fenêtre et donnant du pain aux oiseaux. Je crois que nous ne comprendrons jamais rien à Landru, même s’il a tué. »
En 2016, on comprend mieux… (Cf. Culture. Cinéma, Justice)
Violences à l’encontre des femmes (Langage) : (décembre) 2019. Dans un article du Monde Diplomatique, intitulé En Russie, le fléau des violences domestiques, je relève - en sus du titre, inacceptable - les termes employés, tous confondus, aucun interrogé : « agressions sexuelles, viols, coups et blessures », « violences sexistes », « violences conjugales », « violences physiques », « question des femmes et question sexuelle », « violences contre les femmes », « mœurs », « différends au sein de couples », « querelles d’amoureux » « violences entre partenaires », « violence », « agression », « dispositions discriminatoires », « violence domestique », « parricide ».
Et c’est dans cette ‘confusion’ - a minima - linguistique que l’auteure peut écrire :
« La Russie est l’un des seuls pays à ne pas disposer d’une loi spécifique sur ce sujet », ce qui est non seulement erroné, mais laisse penser qu’une « une loi spécifique » serait une solution à… on ne sait quoi… 302
Comment qualifier l’engagement féministe du Monde Diplomatique lorsque l’on lit dans le chapeau-présentation de cet article : « Dans un pays où il est courant de périr sous les coups de son conjoint, la société doit-elle réprimer les violences conjugales ? » ; lorsque, dans l’article ’ il n’est question que d’un « minimum protection des femmes » ; lorsque que les associations féministes ne font que « s’alarmer » ; lors que l’auteure d’un rapport cité pourtant intitulé ; ‘Je pourrais te tuer, personne ne m’arrêterait’ ne fait que « s’agacer ».
Et que jamais les hommes, hors sujets, irresponsables ne sont l’objet de la moindre critique. Même l’alcoolisme, si souvent évoqué dans la Russie soviétique pour les disculper, a disparu. (Cf. Droit, Famille. Couple, Justice, Langage. Mots. Critique de : « Fléau », Patriarcat)
N.B. Si la journaliste s’était simplement rendue en Russie dans une association féministe de lutte contre les violences, elle aurait pu écrire un article précis, vrai, novateur, original, ancré dans le droit, dans la société. Et donc critique. (Cf. Féminismes, Penser. Pensées)
Violences à l’encontre des femmes (Lebrock Annie) : 1905. Louise Michel [1830-1905], dans Souvenirs et aventures de ma vie, auteure de :
« […] Souvent, le soir, au coin du feu, elle me racontait certains détails de sa vie.
Ancienne institutrice, elle avait été violée par le bourgmestre de la commune où elle exerçait ses modestes fonctions. Et ce viol avait été accompli dans des circonstances particulièrement épouvantables. Le bourgmestre, un nommé Wielang, avait donné à la jeune fille un puissant narcotique, et quand Annie avait été endormie, le satyre déshonoré sa victime.
À son réveil, Annie courut chez le bourgmestre. Celui-ci était à table, entouré de sa famille, de sa femme et de ses enfants.
- Misérable ! Lâche ! infâme ! cria la jeune fille en montrant le poing à l’immonde individu …
Celui-ci ne répondit pas. Il appuya sur un timbre. Un domestique parut.
‘Remettez cette folle entre les mains de la police’, dit-il froidement.
Et Annie, malgré ses protestations, sa résistance, fut brutalement conduite au poste.
M. le bourgmestre envoya sur cette affaire un rapport circonstancié et Annie fut internée, ‘comme folle dangereuse’, dans un asile aussi bien défendu qu’une forteresse. Elle y resta quatre ans en compagnie de démentes, d’hallucinées…
Un jour enfin, elle parvint à s’évader.
Elle arriva à Paris. Là, elle croyait au moins trouver le calme, le repos. Quelle erreur ! Comme la pauvre enfant connaissait mal notre beau pays.
Une dénonciation étant parvenue à la préfecture de Police - cette dénonciation émanait sans doute du bourgmestre - Annie fut conduite à Saint-Lazare ‘anarchiste, dangereuse, propagandiste décidée’ disait la fiche d’incarcération. […]
Annie resta deux mois à Saint-Lazare ; puis un beau matin, on la mit en liberté. Les ogres policiers n’avaient vraisemblablement rien trouvé contre elle. […]
Pauvre Annie. Je l’avais sauvée de la mort, elle ne devait pas atteindre vingt-cinq ans. » 303 (Cf. Femmes. Folie. Comment meurent les femmes, Patriarcat, Politique. État. Répression. Prison. Saint-Lazare, « Sciences » sociales. Psychiatrie, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Violences à l’encontre des femmes (Leiris Michel) : (24 juillet) 1931. Michel Leiris [1901-1990], dans L’Afrique Fantôme, auteur de :
« Je me livre aussi à quelques travaux de couture et découvre dans la trousse que les miens (sic) m’ont préparé quelques magnifiques aiguilles ‘Best White chapel’ de chez Woodfield and sons, longues comme des poignards et au chas large comme l’entrecruisse d’une prostituée de Londres après que Jack l’Éventreur y a passé. »
Ignoble. 304 (Cf. « Sciences » sociales. Ethnologie. Leiris Michel)
Violences à l’encontre des femmes (« Libération de la parole ») : 2021. Qui ne voit que derrière la « libération de la parole des femmes » - dont on nous abreuve - c’est la révolte des femmes que l’on veut refouler, que l’on tente de prévenir, que l’on aspire à briser.
Violences à l’encontre des femmes (Lusset Élisabeth) : (19 mars) 2022. Élisabeth Lusset, auteure (avec Isabelle Poutrin) du Dictionnaire du fouet et de la fessée, et de : « … les femmes qui tombent sous les coups de leurs conjoints », « subir la correction du mari ». 305
Violences à l’encontre des femmes (Luttes sociales) : (16 août) 1819. Une manifestation pacifique d’environ 50. 000 à 60.000 personnes eut lieu à Manchester (St Peters field), dit Massacre de Peterloo. La milice à cheval charge : 15 personnes tuées, 650 blessées. Je lis :
« Il semble que les femmes, dont une centaine furent blessées, aient été particulièrement visées par les sabres, les baïonnettes et les matraques tant la milice trouvait choquante leur participation à un meeting radical. » Et une note précise :
« Michael Bush [en 2004] a calculé que si les femmes ne représentaient qu’un participant (sic) au meeting sur neuf, elles comptaient pour un quart des blessés. » 306 (Cf. Politique. Luttes, Histoire)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Emmanuel Macron :
Violences à l’encontre des femmes (Macron Emmanuel) (1) : (1er décembre) 2021. Emmanuel Macron, en préambule du conseil des ministres - sans bien sûr, aucune excuse- a déclaré notamment que : « l’enjeu, c’est de faciliter et d’accompagner la libération de la parole » […] « accompagner la libération » : au-delà de l’absurdité de la contradiction, urgence d’une vigilance accrue devant le risque, le danger, la menace !
Violences à l’encontre des femmes (Macron Emmanuel) (2) : (3 décembre) 2021. Dans Elle, Jean-Michel Aphatie rappelle le commentaire du porte-parole de l’Élysée en février 2018, après la dénonciation de viols à l’encontre de Nicolas Hulot, alors numéro 2 du gouvernement :
« L’accusation a laissé Emmanuel Macron ‘d’une sérénité de marbre’. »
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Mafia) : 1969. Dominique Fernandez, dans Mère méditerranée, écrit, concernant l’Italie :
« […] La mafia ne tue pas pour une femme. Ceux qui trempent (sic) de près ou de loin dans les activités d’une cosca (clan) ne se mouillent jamais dans des crimes passionnels. Règle absolue. Les boss ne s’intéressent qu’au pouvoir et à l’argent. »
Je ne sais ce qu’il en est en réalité, mais je sais qu’il est impossible d’isoler « les femmes » du « pouvoir et de l’argent » et que le contrôle de ses femmes par les mafias relève pour elles de l’évidence. 307 (Cf. Patriarcat. Mafia, Proxénétisme. Fernandez Dominique)
Violences à l’encontre des femmes (Marzouki Moncef) : 2013. Moncef Marzouki, alors président de la République Tunisienne, dans L’invention d’une démocratie. Les leçons de l’expérience Tunisienne, auteur de :
« […] En septembre 2012, une jeune femme qui a été violée par les policiers, avant d’être poursuivie en justice par des derniers pour …’attentat à la pudeur’. Elle a heureusement été acquittée de cette scandaleuse accusation et les policiers violeurs ont été condamnés. L’affaire a très logiquement frappé les imaginaires et va faire évoluer les comportements. Car d’habitude, lorsque de tels crimes se produisent, la victime est réduite au silence. Cette fois, elle avait eu le courage de protester, parce qu’elle savait que, désormais, les violences policières ne resteront pas impunies. Et son fiancé, au lieu de disparaître comme c’est souvent le cas dans les affaires de viol, s’est montré entièrement solidaire. Je les ai reçus tous les deux et je les ai félicités pour leurs attitudes. Et j’ai présenté les excuses de l’État. Dans ces moments dramatiques, on perçoit donc les changements d’attitude. Une jeune fille ose protester et porter plainte contre des policiers, son fiancé ne l’abandonne pas et fait chœur avec elle, le président de la république présente les excuses de l’État. L’information passe à la télévision : c’est cela aussi notre révolution. » 308 (Cf. Hommes. Féminisme, Justice. Procès, Patriarcat, Politique. État, Violences à l’encontre des femmes. Policiers)
Violences à l’encontre des femmes (Masha Amini) : (21 septembre )2022. Je lis le titre d’un communiqué concernant Masha Amini [2002-2022] :
« Mourir pour des cheveux dépassant le voile !» Non. Masha Amini n’est pas morte pour des « cheveux » : Elle a été arrêtée, puis tuée, assassinée, par une milice dite des « mœurs » d'un État religieux musulman, qui depuis des dizaines d'années maintient par une oppression patriarcale aux mille moyens, aux mille expressions, sur toutes les Iraniennes, laquelle se greffe sur - et aggrave - une oppression aux mille moyens, aux mille expressions sur tous les Iraniens et toutes les Iraniennes. (Cf. Patriarcat, Politique. État. Répression)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Manifestations :
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2018) (1) : (24 novembre) 2018. Pour une présentation de cette manifestation, à l’initiative de Nous toutes, cf. les 13 textes publiés par le Bulletin de la Marche Mondiale des femmes n°361 le 23 novembre 2018, à laquelle ajouter le texte, publié le 24 novembre par le Huffigton Post, intitulé Pourquoi nous ne marcherons pas aux côtés de Nous toutes, dont le sous-titre était :
« Par notre absence à cette marche, nous souhaitons appeler chacune et chacun à éclaircir ses positions et ses soutiens. »
- Concernant la manifestation, la plus grande confusion politique délibérément entretenue et dont les organisatrices sont responsables - n’a pu que logiquement favoriser les plus antiféministes, les soutiens du proxénétisme, le Strass au premier chef, qui ont pu défiler au-devant du cortège.
L’absence de toute critique de la politique menée par Emmanuel Macron, par madame Belloubet, par Christophe Castaner, par Marlène Schiappa, liée à l’absence de toute revendication, ne pouvaient que les réjouir.
- Les femmes victimes de violences se sont vues jeter, en guise de remerciements, le 25 novembre 2018, l’annonce du dépôt de plainte sur internet, présentée comme « le lancement d’une plateforme de signalement des violences sexuelles », déjà depuis longtemps évoquée - et par ailleurs, en aucun cas, une avancée, en ce qu‘elle est encore une fois une régression du recours au droit. Plus encore, une décision, lourde de graves conséquences. Quant au premier ministre il a osé affirmer : Cette plateforme, « c'est le premier des jalons, technique et politique, pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Désormais quelques clics peuvent aider chacune à prendre un nouveau départ : pour soi, pour sa famille. Et peut-être pour éviter le pire. » 309
N.B. Les liens entre les « Gilets jaunes » et les revendications féministes (définies sur une base claire) : la critique de l’injustice et celle de l’État ; l’exigence de dignité, de respect, de justice, la fin des privilèges, de tous les privilèges.
Violences à l’encontre des femmes. Manifestation du 23 novembre 2019 :
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (2) : (23 novembre) 2019. J’ai été frappée, à la lecture des appels à la manifestation, de leur frilosité politique. Je pense notamment à l’appel de la Marche mondiale des femmes : pas une critique d’Emmanuel Macron, du gouvernement, de Marlène Schiappa, de Nicole Belloubet, et, surtout, de l’état, de la police, la justice. Plus encore, étaient joints à l’envoi une liste de slogans - rabâchés, recyclés, répétés, usés jusqu'à la corde par ailleurs – présentés, certes entre guillemets, mais néanmoins, comme « officiels » : !
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (3) : (23 novembre) 2019. 150.000 personnes - femmes dans la très grande majorité - sont estimées avoir manifesté en France.
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (4) : (23 novembre) 2019. (3) La focalisation sur le nombre de femmes assassinées, certes nécessaires, fait cependant passer au second plan les critiques et les revendications politiques précises, concrètes, singulièrement absentes.
* Ajout. 27 novembre 2019. Il y avait, me dit-on, un cortège abolitionniste, avec notamment Osez le féminisme. (Retrouver les slogans) (Cf. Proxénétisme. Abolitionnisme)
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (5) : (23 novembre) 2019 (4) Il apparaissait comme acquis que la violence proxénète, comme celle de la pornographie, était exclue de la manifestation, dont il faut rappeler qu’elle avait pourtant pour finalité de lutter contre les violences sexuelles et sexistes.
Une terrible régression qui ne peut, sauf à devoir pour les féministes assumer une lourde responsabilité politique, durer.
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (6) : (23 novembre) 2019 L’affichage ostentatoire des « personnalités » (femmes politiques, actrices, médiatiques) dont les analyses, les revendications ont été amplement reprises par les médias, au-devant du cortège ne m’a pas plu. Non pas que j’accorde à cette place une importance, mais parce que leur visibilité affichée est, une fois encore une manière de délégitimer les [associations] féministes, auxquelles cependant les « hommages » rendus parfois apparaissent fort comme relevant d’une certaine culpabilité. Et plus encore, de privilégier certaines femmes au détriment de toutes les autres.
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (7) : (23 novembre) 2019. Slogans relevés sur internet :
En lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Nous sommes les cris de celles qui n'ont plus de voix
Elle pleure, il rit. Elle meurt, il vit.
Justice Complice, État coupable
Moins de gnons. Plus de sanctions
Vous n'aurez plus jamais notre silence
Justice complice de nos bourreaux
Fachos. Machos, Lâchez-nous le clito
La raison d'un viol : le violeur
A bas le patriarcat
Les tueurs de femmes sont des conjoints
Ras le viol
Patriarcat. Machisme : Assassin
Une femme a dit : mon mari veut me tuer. Le policier : Rentrez chez vous, madame
Féminicide : arme de destruction machiste
Féminicides : Pas une de plus
I milliard. Pas des bobards
Et Manu, que fais-tu pour elles ?
+ de meufs, - de keufs
On marche sous la pluie, pour que personne ne voit nos larmes
Que fait la police : rien
Plus écoutées mortes que vivantes
Partir ou mourir
Je te crois, Tu n'y es pour rien
Papa, il a tué maman
Ça s'arrête quand ?
État. Justice : Non-assistance des personnes en danger
Non aux violences de genre ; Non aux violences de classe
Mets de paillettes dans ma vie, Kevin. Pas des bleus sur mon corps
Real men are feminists !!
Ovaires et contre tous
Revulvition. A bas le patriarcat
Aimer # Tuer
Un milliard contre les violences sexuelles et sexistes
Patriarcat. Machisme. Assassin
Trop couverte ou pas assez, c'est aux femmes de décider
Du coup, Cantat, il a tué la femme ou l'actrice ?
Simone Veille sur nous toutes
Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours
Pour les règles et pour le sang, on a déjà nos règles
Domination masculine, Tremble
Destruction du patriarcat programmée
Elle le quitte, il la tue
Pas une de plus dans vos cimetières. Pas une de moins dans nos luttes
Les femmes n'appartiennent pas aux hommes
Vivantes, Résistantes, Combattantes
Aux femmes assassinées, l'État indifférent
On ne nait pas homme, on le devient
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2019) (8) : (23 novembre) 2019. Relevé des formulations du journaliste du plateau de LCI en commentaire de la manifestation : « A priori le cortège est assez bien fourni » ; « Il y a du monde » ; [adressé à la journaliste sur place] : « Est ce qu’il y a beaucoup de gens ? » ; « Il y a de l’affluence, déjà, a priori », « Il y a beaucoup de personnalités » ; « Le cortège a l’air assez fourni » ; « C’est surtout la société civile qui semble s’être réunie à Paris ». Et enfin, une question : « Est-ce que cela serait utile un milliard […] ? »
En percevant l’impossibilité du journaliste à prononcer le simple mot de « femmes », je me rends mieux compte du fossé entre les femmes, les féministes et encore tant d’hommes, ici journaliste. (Cf. Femmes, Langage. Mots, Patriarcat, Politique. Médias)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Manifestation du 23 novembre 2024) (9) : Lu sur Nous toutes :
Ma colère ne tient pas sur cette pancarte ;
Féministe radicale en colère ;
Une agression sexuelle toutes les deux minutes ;
Dans dix féminicides, c’est Noël ;
Pas de lutte féministe sans Gaza ;
Sans Oui, c’est non ;
Ovaires et contre tout ;
Pour que nos vies ne soient pas classées sans suite ;
J’ai porté plainte. Il est en liberté. Il continue de violer à Nevers ;
Nous en sommes pas toutes là ; il manque celles qui ont été tuées ;
Détruisons le patriarcat, pas la planète ;
Stop à la culture du viol ; Je te crois, tu n’y es pour rien ;
Grande cause du quinquennat : Bla bla bla …
Maman, je me bats pour toi ;
(Cf. Comment faire disparaître les femmes)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Martin-Fugier Anne) : 2009. Intituler un livre concernant l’assassinat en 1847 de la duchesse de Choiseul-Praslin, « Une nymphomane vertueuse » est, sans même évoquer la rigueur intellectuelle, choquant : une injure - une de plus - faite à une femme, mère de dix enfants, humiliée, massacrée par un mari odieux.
- Et l’éternel argument que, si souvent, l’on évoque en la matière : « c’est l’éditeur qui l’a décidé/imposé » ne peut être invoqué ; sauf à s’abstraire de toute référence à la liberté individuelle d’accepter ou de refuser un titre, comme à toute analyse politique. 310 (Cf. Femmes. Remarquables. Choiseul-Praslin duchesse de, Langage. Adjectif, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Xavier Mauduit :
Violences à l’encontre des femmes (Mauduit Xavier) (1) : (21 janvier) 2020. Xavier Mauduit, responsable de l’émission quotidienne de France Culture, Le cours de l’histoire, pour présenter une émission intitulée L’Iran à la confluence des passions, auteur de :
« Dites donc ! Vous vous souvenez de cette histoire incroyable ? C’était il y a si longtemps !
Pourtant elle a fait beaucoup causer ! Mais si, souvenez-vous !
Le sultan venait d’apprendre qu’il était trompé par son épouse et il l’a faite condamner. Mais si ! C’est lors que le sultan, pour être certain que son épouse lui resterait fidèle, a pris l’incroyable décision qu’il allait changer d’épouses tous les jours, en la faisant tuer au petit matin ; et il tuait l’épouse de la veille.
Nous, nous avions écarquillé à l’annonce de cette nouvelle : 365 épouses par an, pire encore les années bissextile. Mais si ça y est, ça vous revient !
Quand le sultan épouse la fille du vizir, Shahrazade elle le prend au piège : elle lui raconte chaque nuit, une histoire qui reste en suspens, alors que le jour se lève. Et comme le sultan veut connaitre la suite du récit, il ne la tue pas. Mais, ça y est !
Cette histoire incroyable est le propos des Mille et une nuits qui fait rêver ! Ce sultan fabuleux …et qui a fait rêver tant de générations…ce sont des contes au cœur de l’histoire Persanne […] à la croisée de peuples et des cultures ».
La manifeste identification - il faut l’écouter …- de Xavier Mauduit au « sultan fabuleux » - qui tue toutes ‘ses épouses’ - au conte qui « fait rêver », réduisant par ailleurs Shahrazade au néant, pose tout de même un problème politique d’importance. 311 (Cf. Culture, Hommes. Journalistes, Femmes. Comment meurent les femmes, Patriarcat, Histoire. Mauduit Xavier)
Violences à l’encontre des femmes (Mauduit Xavier) (2) : (7 février) 2020. Xavier Mauduit, responsable de l’émission quotidienne de France Culture, Le cours de l’histoire consacre une émission au goulags soviétiques. Hervé Hamon, son invité présente les truands, des voyous qui contrôlent les camps et j’entends qu’« ils violent les femmes ». Xavier Mauduit le coupe et, sans transition, ni commentaire, prend la parole et poursuit : « Ils volent les vêtements, ce qui, dans des régions extrêmement froides a des conséquences terrifiantes ». 312
On peut noter que cette émission consacrée aux goulags est introduite par la lecture d’un passage du livre - dont on voit mal le rapport avec les goulags - de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie [2011]. (Cf. Hommes, Patriarcat, Histoire. Mauduit Xavier)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Mélenchon Jean-Luc) : (15 février) 2022. Jean Luc Mélenchon, à la Sorbonne, sur les « féminicides » et les violences faites aux femmes, termine son analyse - encore bien insuffisante - en s’adressant à la salle, aux femmes, auteur de :
« Je suis sûr que vous y avez réfléchi plus que moi ; c‘est donc vous qui diriez les choses les plus intelligentes. » Applaudissements. (Cf. Hommes. « Politiques ». Mélenchon Jean-Luc)
* Ajout. 20 octobre 2022. Que n’y a-t-il plus réfléchi !
Violences à l’encontre des femmes (Mey Louise) : (6 février) 2020. Louise Mey, romancière, sur France Inter doit répondre à la question suivante :
« Pour quel criminel avez-vous d’un brin d’affection ? » :
« Je n’ai pas d’affection, mais j’ai de l’empathie avec les femmes qui tuent leurs bourreaux. Ça n’excuse rien mais je pense que ça explique. » 313
Violences à l’encontre des femmes (Message au répondeur de Là-bas si j’y suis) : (4 avril) 2013. « J’ai horreur du lynchage, mais horreur ! […] Parfois je me dis que si j’avais vécu pendant la seconde guerre mondiale, et, qu’en mon absence, ma femme avait couché avec un allemand, avec des allemands, j’aurais certainement eu envie de la tuer. C’est humain. Mais je crois que j’aurais encore eu plus envie de tuer ceux qui ont tondu des femmes à la Libération. […] »
De la non-valeur des équivalences… (Cf. Hommes. Journalistes. Mermet Daniel) 314
Violences à l’encontre des femmes (Meyer Daniel) : (2 août) 1985. Daniel Meyer [1909-1996], interrogé sur son itinéraire politique évoque son embauche à 24 ans au Populaire, journal du parti socialiste :
« Le 24 juillet 1933, un ouvrier d’Argenteuil a tué sa femme. C’est la première affaire…On faisait les chiens écrasés… C’est la première affaire dont je me suis occupé. […] » 315
- C’est donc, après avoir été Président de la Ligue des droits de l’homme [De 1958 à 1975] puis de la FIDH [De 1977 à 1985] et Président du Conseil Constitutionnel [De 1983 à 1985], qu’il pourra toujours évoquer les assassinats de femmes comme relevant de la rubrique « chiens écrasés ».
Violences à l’encontre des femmes (Militaires Français au Rwanda) : (20 avril) 2022. Lu dans l’article de Sorj Chalandon Déshonneurs militaires du Canard enchaîné, présentant le film d’Arte, Rwanda - au titre scandaleux - : Le silence des mots [23 avril 2022] :
« Concessa et Marie-Jeanne survivent. Elles sont accueillies par la Croix rouge au camp de réfugiés de Nyarushishi. Le 23 juin [1994], lorsque l’armée française sécurise le périmètre, menacé par les tueurs hutus, les femmes respirent. Pas pour longtemps. Accompagnés de traducteurs, des soldats de l’opération Turquoise rôdent, la nuit, entre les tentes. ‘Ils venaient se servir en femmes’, expliquent-elles. Un médecin nous consolait en disant : ‘C’est votre seul moyen de survivre’. Marie-Jeanne a été violée dans un fossé par plusieurs soldats. Des militaires ont immortalisé leurs crimes au Polaroïd. ‘Ils nous ordonnaient de nous mettre en à quatre pattes ou les jambes en l’air’ raconte aussi Prisca, plusieurs fois violée au camp de Murambi. Elle baisse la tête. ‘On croyait que les Français étaient là pour nous protéger.’ […]
Elles ont porté plainte pour viol contre X en 2004 et en 2012, mais la Grande muette nie en bloc et refuse toute assistance à la justice pour identifier les criminels. Alors le dossier sommeille, au pôle ‘ Génocides et crimes contre l’humanité’ du tribunal judiciaire de Paris. » (Cf. Hommes, Justice. Patriarcale, Politique. État. Guerre)
Évoquer des Déshonneurs militaires suppose que le supposé « honneur militaire » ait pu concerner le respect des femmes et interdire, criminaliser le viol. La réaction du gouvernement français, dans la longue suite de son histoire, en démontre l’absurdité.
Violences à l’encontre des femmes (Moreno Élisabeth) : (9 juin) 2021. Élisabeth Moreno, ministre déléguée à l’égalité, responsable des politiques de lutte contre les violences, dans une émission consacrée aux « féminicides », auteure de :
« Je veux rappeler qu’il y a des femmes qui s’en sortent. » 316
Une telle sensibilité, une telle humanité, une telle intelligence, une telle pertinence crédibilise la politique ‘macronienne’.
Une idée : pourquoi ne pas commencer à comptabiliser - au lieu et place des femmes assassinées, violées… - celles qui ne le sont pas ? celles qui « s’en sortent », même ‘amochées’? (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
Violences à l’encontre des femmes (Mukwege Denis) : (12 décembre) 2023. Denis Mukwege [Prix Nobel de la paix. 2018] dans Le grand entretien sur RFI [Radio-France International], auteur de :
« Notre projet de société prévoit de mettre fin à la guerre, fin à la faim et fin aux vices. »
Il ne suffit pas de « réparer les femmes » pour procéder à une analyse féministe et dénoncer justement les violences à l’encontre des femmes. (Cf. Patriarcat, Violences à l’encontre des femmes. Mutilations sexuelles)
Violences à l’encontre des femmes (Mutilations sexuelles) : (31 octobre) 2016. Entendu ce jour qualifier les mutilations sexuelles de : « coutumes ancestrales violentes ». 317
Au lieu et place de : « tortures patriarcales ». (Cf. Sexes. Mutilations sexuelles, Violences. Patriarcales)
Violences à l’encontre des femmes (Nationalisme / Impérialisme) : En « occident », en France en l’occurrence, la carte de la dénonciation « occidentale » des violences faites aux femmes dans le monde ressemble souvent étrangement à celle des États sur lesquels l’ « occident » a jeté son dévolu. (Reprendre, prolonger) (Cf. Femmes. « Voilées », Féminismes. Féministes. Occidentales, Politique. Nationalisme)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre faites aux femmes. Négation / Négationnisme :
Violences à l’encontre des femmes (Négation / Négationnisme) (1) : 1990. Alexandre Zinoviev [1922-2006], dans Les confessions d’un homme en trop, décrit ainsi la pénétration de l’Armée soviétique en Allemagne, à la fin de la Deuxième guerre mondiale :
« L’Allemagne nous fit la plus heureuse impression également par le nombre de femmes prêtes à nous accorder leurs faveurs, des fillettes d’une douzaine d’années aussi bien que des vieilles femmes. On prétend aujourd’hui que l’armée soviétique s’est rendue coupable d’un nombre considérable de viols en Allemagne. D’après ce que j’ai pu voir de mes propres yeux, l’affirmation est absurde. Lorsque nous entrâmes en Allemagne, les Allemandes avaient déjà été presque toutes violées, si tant est qu’elles aient réellement résisté. Pour la plupart, elles avaient des maladies vénériennes. Dans notre armée, le viol était sanctionné de la cour martiale. Les wagons des syphilitiques étaient verrouillés de l’extérieur et les ouvertures fermées de fil de fer barbelé. Dans un village où nous étions logés chez l’habitant, le maître de maison vint personnellement mettre à notre disposition sa fille et sa petite-fille. Il tenait à la main une feuille où avait déjà été signalé ceux qui avaient bénéficié de son ‘hospitalité’. Les allemands se sentaient complices d’Hitler et coupables de crimes perpétrés par leur armée en Union soviétique et s’attendaient au même comportement de la part des Soviétiques. Leurs complaisances, sans bornes, commençaient par le corps de leurs femmes. Et nos soldats ne laissèrent pas échapper les occasions, à tel point que le nombre de ceux qui furent contaminés est impossible à établir. […] » 318
- En sus de l’ignominie de ce texte, il importe ici de noter que, dans la préface de l’édition française, Alexandre Zinoviev est présenté, sans autre commentaire, comme « un des grands logiciens contemporains ». (Cf. Homme. « Un homme à Berlin », Violences à l’encontre des femmes. Soldats russes en Allemagne)
Violences à l’encontre faites aux femmes (Négation / Négationnisme) (2) : (26 juin) 2014. Dans Libération, Philippe Grangereau présente la lutte de femmes, de féministes Chinoises en soutien à Lu-i Yan. Celle-ci, violentée par son mari, l’avait tué. Condamnée à mort en 2011, une décision en cassation avait cassé le jugement]. Il écrit ensuite :
« À titre comparatif, en France, une trentaine d’hommes qui abusaient leurs conjointes ont été assassinées par celles-ci (statistiques de 2006). Mais en Chine, c’est un véritable problème de société. […] » 319. (Cf. Hommes. Journalistes, Politique. Nationalisme)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Nietzsche Friedrich) : 1883. Friedrich Nietzsche [1844-1900], dans Zarathoustra, auteur de :
« Si tu vas chez les femmes, n’oublie pas le fouet. » 320 (Cf. Violences. Nietzsche Friedrich)
Violences à l’encontre des femmes (« Occultées ») : 1876. Hippolyte Taine [1828-1893], dans Les origines de la France contemporaine, rapportant les violences révolutionnaires, notamment à Saint-Affrique, écrit :
« Quant au commun des assommeurs, ils ont pour salaire, outre la chère, la licence parfaite. Dans ces maisons envahies à onze heures du soir, pendant que le père s’enfuit, ou que le mari crie sous le bâton, l’un des garnements se tient à la porte, le sabre nu dans la main et la femme ou la fille restées à la discrétion des autres ; ils la saisissent par le cou et la maintiennent. Elle a beau appeler au secours […] personne ne vient. »
Une note d’Hippolyte Taine, citant les dépositions effectuées suite à ces violences, poursuit :
« Les détails sont trop précis pour être transcrits. » 321
Violences à l’encontre des femmes (Oufkir Fatéma) : 2000. Fatéma Oufkir [1935-2016], dans Les jardins du roi, écrit :
« Malgré tout ce que j’ai subi, je reste profondément monarchiste. Dans ma famille, on m’a toujours parlé des méfaits de la dissidence du passé… Cette époque [au Maroc] où les tribus se déchiraient entre elles et se rebellaient contre le sultan, secouant le pays de guerres incessantes. Mon grand-père me racontait comment il coupait les mains des femmes pour leur voler leurs bracelets qui allaient lui permettre de se payer une armée, des chevaux et des fusils. » 322 Ou comment la fin justifie les moyens. (Cf. Êtres humains, Femmes. Comment meurent les femmes, Politique. Guerre. Femmes)
Violences à l’encontre des femmes « On ne doit jamais battre une femme, même avec une fleur ») : 1923. Je me suis demandée pendant des dizaines d’années pourquoi cette citation :
« On ne doit jamais battre une femme, même avec une fleur » - dont je découvre qu’elle est de Jean Anouilh - était le plus souvent citée dans les cultures les plus violentes à l’encontre des femmes. Aujourd’hui, il me semble que je comprends mieux. Dès lors que ces violences - justement parce qu’elles sont les plus banales - sont alors les plus déniées, les plus occultées, alors les hommes qui expriment cette opinion peuvent et contribuer à les nier et à se libérer de leur responsabilité, voire de leur culpabilité. D’où la nécessité de, la satisfaction même à la répéter. (Cf. Penser. Répéter)
Violences à l’encontre des femmes (Pardon) : (4 mars) 2015. En Algérie, le projet de loi (voté) portant amendement du code pénal pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, discuté à l’assemblée nationale Algérienne [APN] prévoit « des sanctions envers l’époux coupable de violences contre son conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire, un handicap permanent ou une amputation », mais les poursuites sont abandonnées, « si la victime décide de pardonner à son conjoint ». Cette loi, et cet article qui ouvre la voie à toutes les pressions exercées sur l’épouse qui eut un temps, la force, le courage de dénoncer les violences exercées sur elle, fut votée en l’état.
Lu sur le courrier des lecteurs/trices d’El Watan :
« Qui sont ces députés qui résistent au projet ? et... à qui appartiennent ces voix qui se sont élevées pour encourager le pardon, la docilité en cas de violences conjugales ? On veut les noms de ces adeptes de la violence et qui, ironie du sort, siègent à l'APN. » 323 (Cf. Justice. Pardon, Politique. Élections)
Violences à l’encontre des femmes (Pasternak Boris) : 1957. Boris Pasternak [1890-1960], dans Le docteur Jivago, auteur de :
« Tu demandes comment je suis ? Je suis fêlée, je porte en moi une faille pour toute la vie. On a fait de moi une femme trop tôt, criminellement tôt, en m’initiant à la vie par son plus mauvais côté, en me la montrant dans un jour menteur, comme une comédie de boulevard, comme peut la concevoir un vieux beau à l’ancienne mode, pique-assiette, profitant de tout, se permettant tout. » […]
« Il me semble que pour la voir [la beauté], il faut une imagination vierge, une sensibilité neuve. Or, c’est justement cela qui m’a été enlevé. Peut-être aurais-je eu une vision à moi de la vie si, dès mes premiers pas, je ne l’avais pas vue marquée du sceau avilissant d’un autre. Mais ce n’est pas tout. Un homme immoral, d’une médiocrité satisfaite, est entré dans ma vie quand j’étais toute jeune et, à cause de lui, j’ai raté mon mariage avec un homme supérieur, qui m’aimait et que moi aussi, j’aimais beaucoup. » 324 (Cf. Femmes. Devenir une femme)
Violences à l’encontre des femmes (Paulhan Jean) : 1961. Jean Paulhan [1884-1968], dans sa Préface intitulé : Du Bonheur dans l’esclavage, à Histoire d’O de Pauline Réage (alias Dominique Aury [1907-1988]), auteur de :
« […] Donc il ne manque pas de tortures dans l’histoire d’O. Il ne manque pas de coups de cravache ni même de marques au fer rouge, sans parler du carcan et de l’exposition en pleine terrasse. Presque autant de tortures qu’il est de prières dans la vie des esthètes du désert. Non moins soigneusement distinguées et comme numérotées - les unes les autres séparées par de petites pierres. Ce ne sont pas toujours des tortures joyeuses - je veux dire joyeusement infligées. René s’y refuse ; et Sir Stephen, s’il y consent, c’est à la manière d’un devoir. De toute évidence, ils ne s’amusent pas. Ils n’ont rien du sadique. Tout se passe comme si c’était O seule, dès le début, qui exigeât d’être châtiée, forcée dans ses retraites. […] » 325 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Paulhan Jean. Violents, Langage. Académie française. Paulhan Jean, Penser. Consentement, Patriarcat, Politique. Guerre, Pornographie. Tortures, Violences. Viols. Sade. Violences à l’encontre des femmes. Réage Pauline)
Violences à l’encontre des femmes (Petrucciani Loana) : (9 février) 2021. Loana Petrucciani est invitée dans l’émission TPMP de Cyril Hanouna : elle annonce qu’elle a perdu 16 kilos, arrêté les drogues et qu’elle est « bien ». Certains sur internet s’interrogent :
« Il y a quelque chose qui cloche dans le visage de Loana » ; « Je ne reconnais pas le bas de son visage » ; « Il s’est passé quoi avec la mâchoire de Loana ? » Sur Instagram, une amie réagit :
« Quand vous aurez pris autant de coups dans la bouche par vos conjoints, reveniez me voir afin que je puisse dire à quoi ressemblent vous bouches. » 326 (Cf. Corps. Femmes)
Violences à l’encontre des femmes (Phagan Mary) : (11 septembre) 2022. Présenter, sur France Culture, la jeune ouvrière de moins de 14 ans, Mary Phagan, violée et tuée, le 27 avril 1913, sans autre réaction, sans compassion, comme celle qui va devenir « l’héroïne du monde antisémite » Américain est scandaleux. Mais toute l’histoire, telle qu’exprimée - les divergences entre la présentation écrite et orale sont notamment légion - est à revoir. Les attaques antisémites et le lynchage le 17 août 1915 dont Léo Franck fut l’objet et la victime - et dont les partis-pris bien que fort confus, sont flagrants en sa faveur dans ce reportage - n’autorisent pas que la femme victime de cette violence en soit sacrifiée.
Quant à la valeur accordée aux témoignages des ouvrières, il semble bien que Me too n’ait pas existé. À moins que ce ne soit justement parce que….
Sans oublier certaines réactions de cette présentation qui fleurent bon le racisme anti-noir-es. 327
Violences à l’encontre des femmes (Philippe Édouard) : (3 septembre) 2019. Dans son discours à Matignon lançant le Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes, Édouard Philippe, premier ministre, le conclut en déclarant que la question des « moyens » n’était pas « le sujet essentiel ».
Une politique publique dépourvue de « moyens » : une première ? un futur ?
De fait, son seul engagement financier fut de 5 millions d’euros, concernant la création de structures d’hébergements.
Certaines associations demandaient 500 millions, d’autres, 1 milliard d’euros. 328 (Cf. Hommes. « Politiques ». Philippe Édouard, Politique. État, Violences à l’encontre des femmes. Schiappa Marlène)
Violences à l’encontre des femmes (Picoult Jodi) : 2018. Jodi Picoult, dans Mille petits riens, auteure de :
« ‘Ils disent que j’ai tué mon mari. Et moi, je dis qu’il s’est jeté sur mon couteau. Son regard se posait sur moi. C’était un accident. Comme toutes les fois où il m’a cassé le bras, défoncé la tronche et poussée dans l’escalier. Ça aussi c’était des accidents’. […]
Je ne crois pas aux accidents, dis-je simplement, avant de fermer ma bouche. » 329 (Cf. Droit, Justice. Patriarcale)
Violences à l’encontre des femmes (Piolle Éric) : (7 juillet) 2020. Piolle Éric, EELV, maire de Grenoble, après la nomination dans le gouvernement Jean Castex de Gérald Darmanin et de Éric Dupond-Moretti, auteur de :
« L'égalité Femmes Hommes est au cœur du défi climatique. Ministres, Darmanin et Dupond-Moretti posent 2 verrous sur la puissante libération de la parole des femmes, qui va durablement changer la donne. Que dire aux 225.000 femmes victimes de violence par an ?! » Qu’il est difficile de dire « Je » et de prendre - clairement, politiquement - position, de s’affirmer féministe et être clairement aux côtés, solidaires des femmes ! Quant aux liens avec le défi climatique, je laisse la parole aux commentaires lus sur Twitter :
- « Les deux sujets sont très importants, mais je ne vois pas le rapport entre défi climatique et égalité F/H…, vous pouvez m'expliquer svp ?
- Gloubi-boulga. Et vive le réchauffement climatique entre un homme et une femme !
- Je cherche le rapport entre l'écologie et la violence faite aux femmes ... Je ne m'en sors pas
- Tout est dans tout, et réciproquement !
- Suis-je le seul ou le concept égalité homme/femme au cœur du défi climatique me semble farfelu ? »
Quant à la seule supposée réponse que voici :
« Les femmes sont les premières victimes de la crise climatique. L'éco-féminisme est un courant qui met en évidence la lutte pour l'égalité et l'écologie avec un ennemi commun : le capitalisme. », elle ne fait que révéler l’absence totale depuis des années, de toute pensée féministe - cohérente avec leur soutien du proxénétisme - chez les Verts. C’est une révolution à laquelle ils doivent procéder. (Cf. Politique. Écologie, Pornographie. Piolle Éric, Proxénétisme)
* Ajout. 10 juillet 2020. 1790. Edmund Burke [1729-1797], dans ses Réflexions sur la révolution de France, auteur de :
« Il nous faut séparer ce qu’ils confondent. » 330 (Cf. Penser. Méthode)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Roman Polanski :
Violences à l’encontre des femmes (Polanski Roman) (1) : (août) 2017. Je lis qu’une « troisième femme accuse le réalisateur [Roman Polanski] d’agression sexuelle ».
Je souhaite [ou pense nécessaire, je ne sais] rappeler ce souvenir qui ne m’a jamais quittée.
En 1985, je passais des vacances en Tunisie, à Hammamet, dans la maison d’une amie cinéaste tunisienne. Pendant la journée, elle travaillait dans le cadre du film que tournait alors Roman Polanski, Pirates, un film franco-tunisien [présenté à Cannes en mai 1986]. Et le soir, lorsqu’elle revenait, elle nous disait, choquée, que des jeunes filles [« très jeunes » me souvient-il, sans en être totalement sûre] venues par avion des États-Unis arrivaient sur les lieux du tournage, lesquelles ne venaient pas pour les besoins du film, mais selon elle, pour lui… (Cf. Culture. Viols, Femmes. Jeunes filles)
Violences à l’encontre des femmes (Polanski Roman) (2) : (12 novembre) 2019. Lu sur Mediapart le beau texte de critique du film de Roman Polanski, J’accuse de Coralie Miller : Nous accusons. 331 (Cf. Culture, Féminismes. Antiféminisme. Rondeau Corinne)
-------------
Violences à l’encontre des femmes. Policiers :
Violences à l’encontre des femmes. Policiers (1) : Il faut mettre sur le compte des violences d’État, toutes les violences commises sur le femmes dites-prostituées par les policiers. Et la justice. (Cf. Justice, Politique. État, Violences. Patriarcales)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Policiers :
Violences à l’encontre des femmes (Policiers) (1) : (29 janvier) 2022. Un policier assassine sa compagne, retrouvé morte à son domicile, et disparait avec son arme de service. Sur BFM-TV, un policier - syndicaliste - est interviewé et lui demande qu’il se fasse connaître « avant qu’il ne commette l’irréparable ».
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Polytechnique) : (26 juin) 2024. Lu dans Le Canard enchaîné (p.8) :
« À Polytechnique, en 2023, l’enquête menée par l’Observatoire des violences sexuelles et sexistes a permis de mettre au jour 118 agressions sexuelles et 23 tentatives de viols. L’immense majorité des victimes sont des femmes, dans un campus que ne comptent pourtant que 650 étudiantes. »
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Politique :
Violences à l’encontre des femmes (Politique) (1) : 1771-1775. [Date de publication. 1780] Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Rousseau juge de Jean-Jacques, auteur de :
« Laissez commettre les crimes qu’on peut empêcher n’est pas seulement en être témoin, c’est en être complice. » 332 (Cf. Politique. État)
Violences à l’encontre des femmes (Politique) (2) : (10 août) 2023. Décret relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès de la première ministre chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations.
Article 1. Mme Bérangère COUILLARD, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, prépare, anime et coordonne le travail gouvernemental en matière de parité et d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la lutte contre la discrimination et contre la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.
Elle élabore, coordonne et assure le suivi de la politique de lutte contre les discriminations et en faveur de l'égalité des chances dans les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel et promeut les mesures destinées à faire disparaître les discriminations, notamment en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, d'emploi, de logement, de santé et d'accès aux responsabilités dans la société.
Elle prépare et suit les travaux du comité interministériel aux droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes qu'elle préside par délégation de la Première ministre.
Elle est chargée de promouvoir les mesures destinées à faire disparaître toute discrimination liée au sexe et à accroître les garanties d'égalité dans les domaines politique, économique, professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel. A ce titre, elle veille en particulier, en lien avec les ministres compétents, à l'amélioration de la prise en compte de la maternité et de la paternité dans les parcours professionnels et au développement des modes de garde, notamment collectifs, des jeunes enfants.
Dans ces domaines, elle est notamment associée à la préparation des mesures visant à assurer les droits des femmes, la lutte contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles et la traite des êtres humains et la protection effective des victimes de ces violences, et veille à leur application.
Elle est associée par le ministre chargé de l'éducation nationale à la définition des actions pédagogiques en milieu scolaire sur l'ensemble de ses attributions.
En concertation avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail, et sans préjudice de leurs attributions, elle prépare les mesures relatives à l'égalité professionnelle et des rémunérations dans le secteur privé et le secteur public et à la mixité des métiers et à la lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Elle est chargée, par délégation de la Première ministre, de coordonner les actions menées contre les actes et agissements de haine et de discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, tant pour prévenir ces actes et agissements que pour assurer l'exemplarité des sanctions lorsqu'ils se produisent.
A la demande du ministre chargé de l'Europe et des affaires étrangères, elle apporte son concours à celui-ci dans les négociations internationales ayant pour objet de promouvoir les droits des femmes, l'égalité réelle, la lutte contre les discriminations.
La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, accomplit toute autre mission que la Première ministre lui confie.
Article 2. Pour l'exercice de ses attributions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a autorité, par délégation de la Première ministre, sur la direction générale de la cohésion sociale, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et des familles, ainsi que sur le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans et sur la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
Pour l'exercice de ses attributions en matière de lutte contre les discriminations, elle dispose du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, notamment sa délégation à l'information et à la communication et sa délégation aux affaires européennes et internationales, ainsi que de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, de la direction générale du travail et de la direction générale de l'enseignement scolaire.
Les services d'inspection et de contrôle et les missions ministérielles d'audit sont mis à sa disposition en tant que de besoin pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Les autres départements ministériels ainsi que les organismes qui leur sont rattachés lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services. […] »
Violences à l’encontre des femmes (Politique) (3) : (20 septembre) 2023. Lu ce jour dans Le Canard enchaîné (p.8) ce passage du Rapport de la Cour des comptes daté du 14 septembre 2023, lequel concerne [notamment ?] « la lutte contre les violences faites aux femmes » :
« Entre 2017 et 2019, 119 mesures ont bien été annoncées mais 'sans feuille de route unique '.
Un comité interministériel semestriel avait été promis mais il ne s'est jamais tenu (Libération. 19 septembre). Et la Cour de tacler : ‘Dans de nombreux pas, les mesures visées n'ont été assorties ni de moyens, ni de calendrier de réalisation, ni d'indicateurs de résultats, ni de cibles, ce qui rend leur évaluation impossible’. Ce qui est embêtant [...]. » (Cf. Femmes « Politiques ». Schiappa Marlène, Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Pradié Aurélien) : (10 avril) 2021. Aurélien Pradié, député Les Républicains, concernant « la protection des femmes et des enfants », ce « sujet », cette « cause », auteur de :
« J’ai rencontré plusieurs femmes concernées par ce problème… » suivi d’un curieux : « Je ne l’ai pas vécu personnellement. » 333
Violences à l’encontre des femmes (« Pourquoi n’êtes-vous pas partie ? ») : La si banale et si honteuse question posée à tant de femmes dans tant de commissariats de police, dans tant de tribunaux : « Pourquoi n’êtes-vous pas partie ? » ne peut pas ne pas faire penser à cette autre question, posés notamment aux juifs, sous le nazisme : « Pourquoi ne sont-ils pas défendus ? »
Violences à l’encontre des femmes. Pauline Réage :
Violences à l’encontre des femmes (Réage Pauline) (1) : 1961. Pauline Réage, alias Dominique Aury [1907-1998], dans Histoire d’O, auteure de :
« Alors, […] il usait d’elle lentement […] écoutant sans jamais lui répondre ses supplications, car elle suppliait parfois, répétant les mêmes injonctions aux mêmes moments, comme dans un rituel, si bien qu’elle savait quand sa bouche devait caresser, et quand, à genoux la tête enfouie dans la soie du sofa, elle ne devait lui offrir que ses reins, dont il s’emparait désormais sans la blesser, tant elle s’était ouverte à lui […] elle s’abandonna tout à fait. Et, pour la première fois, si doux étaient ses yeux consentants lorsqu’ils rencontrèrent les clairs yeux brûlant de Sir Stephen […] : ‘O, je vais te mettre un bâillon, parce que je voudrais te fouetter jusqu’au sang, lui dit-il. Me le permets-tu ? - Je suis à vous’, dit O. » 334 (Cf. Femmes. Silence, Penser. Consentement, Politique. Obéir, Sexes. Femmes)
Violences à l’encontre des femmes (Réage Pauline) (2) : 1961. Pauline Réage, alias Dominique Aury [1907-1998], dans Histoire d’O, auteure de :
« Et quand il lui eut mis le bâillon, qui lui remplit la bouche de son goût de toile mouillée, et lui repoussa la langue au fond de la gorge, et sur laquelle à peine ses dents pouvaient mordre, il la prit doucement aux cheveux. Balancée par la chaîne, elle chancelait sur ses pieds nus : ‘O, pardonne-moi’, murmura-t-il (jamais il ne lui avait demandé pardon), puis il la lâcha et frappa. » 335 (Cf. Patriarcat, Politique. Tortures, Pornographie)
Violences à l’encontre des femmes (Réage Pauline) (3) : 1961. Pauline Réage, alias Dominique Aury [1907-1998], dans Histoire d’O, auteure de :
« Sir Stephen ramena O à Paris dix jours avant la fin de juillet. Les fers qui trouaient le lobe gauche de son ventre et portaient en toutes lettres qu’elle était la propriété de Sir Stephen lui descendait jusqu’au tiers de la cuisse, et à chacun de ses pas bougeaient entre ses jambes comme un battant de cloche, le disque gravé étant plus lourd et plus long que l’anneau auquel il pendait. Les marques imprimées par le fer rouge, hautes de trois doigts et large de moitié leur hauteur, étaient creusées dans la chair comme par une gouge, à près d’un centimètre de profondeur. Rien que de les effleurer, on les percevait sous le doigt. De ces fers et de ces marques, O éprouvait une fierté insensée. Jacqueline eut été là, qu’au lieu de lui cacher qu’elle les portait, comme elle avait fait des traces de coups de cravache que sir Stephen lui avait infligées les derniers jours d’avant son départ, elle aurait couru chercher Jacqueline pour les lui montrer. » (Cf. Patriarcat, Politique. Tortures, Pornographie, Sexes. Femmes) 336
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Radio courtoisie) : (25 septembre) 2024. Entendu sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) : « ce drame nous a fendu le cœur » ; « scénario glaçant » ; « échec du système » ; « francocide » ; « Toujours le même profil, toujours les mêmes causes ».
Philippine, 19 ans, étudiante, a été assassinée ; son corps a été retrouvé au Bois de Boulogne ; son assassin Marocain a été retrouvé en Suisse. Il avait déjà été condamné pour viol en 2021, libéré en juin 2024.
Violences à l’encontre des femmes (Renard Jules) : (7 janvier) 1905. Jules Renard [1864- 1910], dans son Journal, auteur de :
« On parle de Syveton. Elle aussi se rappelle avoir été, petite fille, poursuivi par un homme tout décolleté du bas et qu’on appelait l’homme au nez rouge. » (Cf. Sexes. Hommes)
Ne comprenant pas le lien entre ces deux phrases, je lis sur Wikipédia ceci :
« Gabriel Syveton [1864-8 décembre 1904]. Dans les jours qui suivent la mort de Syveton, certaines indiscrétions - dont l'historien Michel Winock suggère qu'elles pourraient provenir d'ennemis politiques de la Ligue [de la patrie française] - révèlent que le député est soupçonné d'avoir « abusé’ de sa belle -fille issue d'un premier mariage de son épouse - Marguerite Ménard, elle-même aux prises avec un mariage malheureux. Ces informations sont confirmées par le témoignage de la mère et la fille devant le juge. Mme Syveton avoue avoir découvert ces agissements le 6 décembre et avoir ordonné à son mari de ‘disparaitre’ ». Finalement, la justice conclut au suicide alléguant que Syveton était menacé de révélations sur son probable détournement de fonds et sa possible affaire de moeurs. Ainsi, Syveton aurait pu se donner la mort par crainte que ces affaires ne soient dévoilées au cours du procès prévu le 9 décembre 1904. » (Cf. Justice. Procès)
Violences à l’encontre des femmes (Renoir Jean) : 1981. Jean Renoir [1894-1979], dans Pierre-Auguste Renoir, mon père, auteur de :
« […] Mais jusqu’à sa mort, il [Auguste Renoir. 1841-1919] il continua de ‘caresser et battre le motif’ comme on caresse et bat une femme pour la mettre en état d’exprimer tout son amour. » 337 (Cf. Relations entre êtres humains. Caresses)
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Maréchal de Richelieu :
Violences à l’encontre des femmes (Richelieu maréchal de) (1) : (19 mai) 1773. Voltaire [1694-1778] et Marie-Louise Denis [1712-1790], dans une lettre à Anne-Madeleine-Louise-Charlotte-Auguste de la Tour du Pin de Saint-Julien [1730-1820], écrivent concernant les rapports du maréchal de Richelieu [1696-1788] avec Voltaire :
« […] Il m’accable de dégoûts, il me traite comme ses maîtresses. » (Cf. Femmes. Maîtresses, Hommes. « Trompeurs de femmes ») 338
Il fut qualifié par Jacques Levron de « libertin fastueux ». (Cf. Hommes. « Libertins », Proxénétisme)
Violences à l’encontre des femmes (Richelieu maréchal de) (2) : (5 avril) 1776. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au comte d’Argental [1700-1788], auteur de :
« Le vainqueur de Mahon [20 mai 1756] et de tant de belles femmes finit désagréablement sa carrière. » 339 (Cf. Langage. Conjonction, Hommes. « Trompeurs de femmes »)
Violences à l’encontre des femmes (Richelieu maréchal de) (3) : (25 mars) 2012. Jean Vitaux, dans une chronique Histoire et gastronomie, auteur de :
« C'était un libertin accompli dont Pierre Larousse dans son Grand Dictionnaire du XIXe siècle dit : ‘Sa vie entière fut un scandale, et il est resté le type le plus brillant de la dépravation de cette époque’. Il eut d'innombrables conquêtes depuis les dames de la cour jusqu'aux chambrières et aux actrices de l’Opéra comme La Souris. Il s'amusa même à conquérir toutes les maîtresses du Régent, certes après lui... […] » (Cf. Hommes. « Libertins », Proxénétisme, Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Robin Muriel) : (22 septembre) 2018. Muriel Robin, l’actrice qui incarna Jacqueline Sauvage dans le téléfilm intitulé Jacqueline Sauvage, C’était lui ou moi [TFI. 1er octobre 2018] fut à l’origine d’un appel - signé de 88 « personnalités du monde du spectacle » - au président de la République publié dans Le Journal du Dimanche, intitulé : Sauvons celles qui sont encore vivantes. On a connu revendications plus subversives. Un appel était lancé pour une manifestation devant le Palais de Justice de Paris, le 6 octobre 2018, dans lequel on pouvait lire :
« Je fais une confiance totale au Président de la République […] »
J’avais par ailleurs préalablement entendu Muriel Robin demander à Emmanuel Macron de « mettre le dossier au-dessus de la pile ».
Quant aux revendications évoquées, toutes déjà cent fois avancées : augmentation des budgets des associations, formation obligatoire pour tous les métiers de loi, hébergement des femmes, refonte de la loi sur la légitime défense, médiation pénale… 340
Une fois encore donc, l’essentiel est occulté. (Cf. Droit, Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène, Justice, Patriarcat)
Violences à l’encontre des femmes. Mary Robinson :
Violences à l’encontre des femmes (Robinson Mary) (1) : 1802. Mary Robinson [1757-1800], dans les Mémoires de Mistriss Robinson, écrit concernant ses débuts à la scène :
« Le sérieux de mes manières me servit même d’égide contre les attaques de ces hommes audacieux qui s’empressent autour de la jeunesse, qui l’assaillent lors de son entrée dans le monde, et qui trop souvent triomphent de l’innocence lorsqu’elle n’est préservée que par les grâces enfantines qui la décorent et qui sont pour le vice plutôt un encouragement qu’un motif sacré qu’ils doivent respecter ; je n’opposais donc à toute l’artillerie de la séduction que la froideur et le dédain ; mes traits, sans en prendre la teinte empruntée, l’exprimaient sans le vouloir, et c’est ce qui m’a empêchée, en bien des occasions, d’être le jouet des efforts qu’employait le vice pour me séduire ou pour me perdre. » 341 (Cf. Enfants, Hommes. Séducteurs, Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Violences à l’encontre des femmes (Robinson Mary) (2) : 1802. Mary Robinson [1757-1800], dans les Mémoires de Mistriss Robinson, harcelée par M. Brereton qui avait préalablement arrêté son mari, qui avait exigé qu’elle « cède à son amour » en échange de la liberté de son époux, et lui avait demandé de le rejoindre à Bath, réagit ainsi :
« Je fondis en larmes. ‘Pourriez-vous être assez inhumain que de m’imposer des conditions qui répugnent à l’honneur que j’ai toujours pris pour ma loi suprême ?’ […]
Je perds patience, et avec le ton le plus sévère, suivi des reproches les plus amers, je lui parlais de l’infamie de sa conduite. ‘Je retournai à Bath, lui dis-je, mais pour y exposer votre conduite déshonorante, vos manœuvres barbares ; j’informerai votre épouse de votre conduite perfide ; l’univers entier connaîtra que non content d’employer les voies ordinaires de la séduction, vous vous servez encore des moyens le plus vils que puissent employer un joueur, un libertin et le roué les le plus décidé, pour chercher à détruite le bonheur domestique de la plus vertueuse des femmes. Oh ! barbare, oh ! monstre, puisse le ciel qui m’entend me venger de l’excès de vos furies’. Je prononçais cette dernière phrase avec tant de véhémence, et avec un courage si expressif que je le vis pâlir et qu’il me pria d'être prudente et discrète. ‘Je ne le serai pas tant que vous m'insulterez, lui dis-je et que vous aurez mon mari en votre pouvoir ; vous avez porté l’outrage à son comble, vous avez éveillé l’orgueil, le ressentiment dans mon âme, et ils ne seront détruits que par une conduite différente de votre part ; vous seul devez trembler des suites de cette affaire ! ». 342 (Lire la suite) (Cf. Femmes. Écrivaines, Hommes. « Libertins », Famille. Mariage, Patriarcat)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Roland Jeanne-Marie) : 1811. Jeanne-Marie Roland [1754-1793], dans ses Mémoires particuliers, auteure de :
« Une tante de mon père choisit pour moi, dans les environs d’Arpajon où elle allait souvent en été, une nourrice saine et de bonnes mœurs, que l’on estimait dans le pays d’autant plus que la brutalité de son mari la rendait malheureuse, sans altérer son caractère ni changer sa conduite. »
Des critères de l’estime accordée au femmes… (Cf. Femmes. Nourrices. Silence) 343
Violences à l’encontre des femmes (Roudinesco Élisabeth) : (2 novembre) 2018. Élisabeth Roudinesco, dans un article du Monde intitulé Jamais une explosion de rage ne doit devenir un modèle de lutte, écrit notamment concernant #meetoo :
« Que de sombres prédateurs [!] aient été poursuivis en justice, voilà une belle victoire contre la barbarie. Mais cela ne doit pas nous interdire de critiquer les dérives [!] d’un tel mouvement. Car la confession publique [!] n’est jamais un progrès en soi.
Jamais une explosion de rage [!], fut-elle nécessaire [!], ne doit devenir un modèle de lutte [!] contre les inégalités [!] et les maltraitances [!].
Nul [!] ne peut nier les exigences d’un droit fondé sur des preuves et le respect de l’intimité [!],
Les usagers [!] des réseaux sociaux ne sauraient se substituer [!] aux magistrats [!] pour jeter en pâture à l’opinion publique des bourreaux ou des criminels [!] […]. »
J’aurais aimé trouver la formulation la-plus-distante-subtile-non-méprisante-mais-néanmoins-critique : je ne l’ai pas trouvée. J’écris donc sans aucune distance : Lorsque l’on ne connait ici manifestement ni le droit, ni la justice, ni les hashtags (Balance ton porc ; #metoo) que l’on est censée condamner, ni les violences que ceux-ci expriment, il vaut mieux ne pas mettre sa signature sur un texte public.
Que Le Monde n’a pas à se vanter d’avoir publié.
N.B. La suite de l’article démontre qu’elle ne connait pas non plus le-s « féminisme-s ». (Cf. Enfants. Miller Alice, Féminismes. Antiféminisme, Penser. « Réseaux sociaux », Politique. « Opinion Publique », « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Violences à l’encontre des femmes (Rues de Paris) : 2000-2002. Vécu : pendant ces deux années, un homme, dans les rues de Paris, m’avait dit : « Tu es moche » ; un autre m’avait donné, sans mot dire, un violent coup sur le corps ; un troisième cracha sur moi et un quatrième, enfin, m’avait traitée de « salope ». Tout cela, sans échange verbal et sans me connaître.
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. George Sand :
Violences à l’encontre des femmes (Sand George) (1) : (Début janvier) 1836. George Sand [1804-1876] écrivit à Marie d’Agoult [Daniel Stern. 1805-1876] concernant son mari - dont elle cherche auprès de la « justice » à se séparer légalement - qu’ « il a[vait] eu l’heureuse idée de vouloir me tuer un soir qu’il était ivre. ».
Elle écrit ensuite :
« En attendant que cette benoîte fantaisie de meurtre conjugal me rende mon pays, ma vieille maison et cinq ou six champs de blé qui me nourriront quand mes longues veilles m’auront jetée dans l’idiotisme, je fais le Sixte-Quint. » (Cf. Justice. Juges. Sand George)
- Pour plus de précision, je lis que :
« Le 19 octobre 1835, Casimir Dudevant s’élance vers elle, la main levée ; retenu par des amis, il revient quelques instants plus tard dans la pièce en brandissant un fusil. Elle quitte Nohant. » 344
* Ajout. 4 avril 2020. Michelle Perrot ne peut donc qualifier Casimir Dudevant [1795-1871] de « brave homme ». 345 Il faudrait à cet égard reprendre précisément les luttes que George Sand a dû mener, notamment mais non pas exclusivement sur un plan juridique, pour se libérer de lui, de ses contraintes, menaces, pressions concernant notamment la garde des enfants, et des avantages matériels dont il espérait devoir bénéficier. (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes, Famille. Mariage. Divorce, Justice. Juges. Sand George)
Violences à l’encontre des femmes (Sand George) (2) : (5 juillet) 1866. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Alexandre Dumas fils qui venait de publier l’Affaire Clemenceau, Mémoire de l’accusé [1866] - justification de l’assassinat d’une femme par son mari -, lui écrit :
« À présent, mon fils, il nous faudrait faire, non pas la contrepartie, mais le pendant en changeant de sexe. Voilà une femme pure, charmante, naïve, avec toutes les qualités et le prestige d’une Clemenceau femelle. Son mari l’aime physiquement, mais, il lui faut des courtisanes ; c’est son habitue et il l’avilit par sa conduite. Que peut-elle faire ? Elle ne peut pas le tuer. Elle est prise de dégoût pour lui, ses retours à elle lui font lever le cœur. Elle see refuse mais elle n’en a pas le droit ; ah ! Qu’est-ce qu’elle fera ? Elle ne peut pas se venger, elle ne peut même pas se préserver, car il peut la violer et nul ne s’y opposera. Elle ne peut pas fuir ; si elle a des enfants, elle ne peut pas les abandonner. Plaider, elle ne gagnera pas si l’adultère du mari n’a pas été commis à domicile ; elle ne peut pas se tuer si elle a un cœur de mère ? Cherchez une solution, moi je cherche. Diriez-vous qu’elle doit pardonner ? oui, jusqu’au pardon physique, qui est l’abjection et qu’une âme fière ne peut accepter qu’avec un atroce désespoir et un invincible révolte des sens. » 346 (Cf. Droit. Patriarcal, Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Justice, Sexes, Violences. Viols)
Violences à l’encontre des femmes (Sand George) (3) : (8 février) 1867. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Gustave Flaubert [1821-1880] qui défendait le 6 février 1867 - je n’ai pas bien compris sur quelle base - Sainte-Beuve [Charles-Augustin. 1804-1869] - « qui n’est ni jésuite, ni vierge ! », et qui de ce fait, l’avait accusée d’être « infestée en cette matière de catholicisme » en terminant par « La Femme, pour nous tous, est l’Ogive de l’infini » lui répondit avec force :
« Non, je ne suis pas catholique ; mais je proscris les monstruosités. Je dis que le vieux laid qui se paie des tendrons ne fait pas l’amour et qu’il n’y a là ni Cypris, ni ogive, ni infini, ni mâle, ni femelle. Il y a une chose contre nature car ce n’est pas le désir qui pousse le tendron dans les bras du vieux laid, et là où il n’y a pas liberté et réciprocité, c’est un attentat à la sainte nature. Donc ce qu’il regrette n’est pas regrettable, à moins qu’il ne croie que ses petites cocottes regretteront sa personne - et je vous le demande, regretteront-elles autre chose que leur malpropre salaire ? Ceci a été la gangrène de ce grand et admirable esprit, si lucide et si sage à tous autres égards. […] Et elle termine ainsi :
« […] Et je peux vous dire que le vice a bien gâté mon vieux ami [Charles-Augustin Sainte-Beuve]. » 347
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Marlène Schiappa :
Violences à l’encontre des femmes (Schiappa Marlène) (1) : Cf. Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène)
Violences à l’encontre des femmes (Schiappa Marlène) (2) : (30 octobre) 2019. Lu dans Le Canard enchaîné :
« Marlène Schiappa avait été initialement conviée par le chef de l’État à La Réunion pour animer avec lui un Grenelle des violences conjugales, sujet majeur sur l’île (sic). Mais lorsque que la sous-ministre a réalisé que le Président n’assisterait pas finalement au dit Grenelle lors de son passage sur l’Ile entre le 23 et le 25 octobre, elle lui a écrit pour … annuler son déplacement. Schiappa ne se voyait pas faire le voyage pour se contenter de remettre, aux côtés du chef de l’État, une médaille à un figure féministe locale, Thérèse Baillif.
Macron, furax, l’a tout de même appelée depuis l’île pour lui indiquer qu’elle devait impérativement organiser le fameux Grenelle sur place, sous trois semaines. Moralité : il se tiendra du 6 au 8 novembre 2019.
Bon voyage ! » 348 (Cf. Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène)
Violences à l’encontre des femmes (Schiappa Marlène) (3) : (29 octobre) 2019. Lu dans La Croix :
« Après deux mois de réflexion, le Grenelle des violences conjugales doit rendre publiques ses propositions ce mardi 29 octobre. La secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, dévoile dans La Croix les pistes qui ont retenu son attention. » Ainsi, en toute transparence, en toute bonne conscience, en toute sereine légitimité, en toute compétence, en toute collégialité, Marlène Schiappa décide, en un jour, des pistes qui, du haut de sa grandeur, « ont retenu son attention ».
Chacun-e pourra noter que pas une ne coûte un sou. 349
* Ajout. 30 octobre 2019. L’article du Monde consacré aux rapport des groupes de travail du Grenelle des violences conjugales se termine par le constat suivant :
« Parmi [?] les soixante propositions des groupes de travail, aucun chiffre n’est précisé ».350
Quant aux hommes violents, ils sont hors sujet. (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. Philippe Édouard)
Violences à l’encontre des femmes (Schiappa Marlène) (4) : (7 novembre) 2019. Marlène Schiappa, par tweet, auteure de :
« Nous allons expulser les étrangers condamnés pour violences sexuelles. » Cette prise de position politique - au nom de qui parle-t-elle ? - est par ailleurs scandaleuse : elle est la porte grande ouverte, sous tous les autres fondements, à toutes les expulsions d’étrangers.
Le féminisme affiché de Marlène Schiappa risque fort un jour, avec ce type de décision, de devenir ce qu’il n’a déjà trop de tendance à être : un bouc émissaire. 351 (Cf. Langage. Mots. Critique de : « Scandale », Politique. Nationalisme)
* Ajout. 20 septembre 2020. La lutte contre les violences à l’encontre des femmes est, dans la confusion dans laquelle elle s’est inscrite, installée, devenue une politique de maintien de l’ordre public, ici à l’encontre des étrangers. Et la notion d’ordre public est vaste…
-------------
Violences à l’encontre des femmes (« Sévices fondés sur le genre ») : (20 août) 2025. Je lis dans Le Canard enchaîné (p.8) :
« L’antenne péruvienne d’Amnesty International a calculé que lors des rencontres [sportives], les sévices fondés sur le genre grimpaient de 34 % au niveau mondial. »
C’est ainsi que les « féminicides », terme employé dans le titre de l’article, qui recouvre des « assassinats de femmes » sont rebaptisé « sévices » qui, lui, signifie : « mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un que l’on a sous son autorité sous sa garde ».
C’est ainsi aussi que les hommes sont subsumés, disparaissent dans « le genre ». (Cf. Langage. Genre, Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
Violences à l’encontre des femmes. Silence des femmes :
Violences à l’encontre des femmes (Silence des femmes) (1) : Les femmes s’épuisent à maintenir les façades (depuis longtemps fissurées) d’un fonctionnement de conventions sociales considérées comme devant être la norme (laquelle n’a jamais existé) ; elles se ruinent à tenter et si souvent réussissent à cacher le spectacle que les hommes violents (maris, compagnons, amants, enfants, agresseurs…) peuvent ou non présenter et donner d’eux-mêmes, et dès lors aussi d’elles-mêmes. Leur mise à mort progressive, si souvent efficace, dans le droit fil des violences qui leur sont infligées, n’a souvent pas d’autres explications à leur poursuite que leur volonté de les cacher. Et c’est ainsi que, en dépit de tant de hurlements, la mise au silence des femmes perpétue le règne de la terreur. (Cf. Femmes. Silence, Politique. Mise au Silence)
Violences à l’encontre des femmes (Silence des femmes) (2) : (7 décembre) 2020. A propos de « la solitude, de l’isolement » et donc du silence des femmes violées, Mathilde Forget, Marcia Burnier, Baptiste de Cazenove, Sol Brun, autrices de :
« On n’est pas censées en parler en public ; on n’est pas censées en parler en soirée ; on n’est pas censées en parler à des inconnu-es ; on n’est pas censées en parler aux gens à qui on en a déjà parlé, parce que ce serait un peu trop dur pour eux ; on est censées en parler un petit peu, mais pas trop… Pas faire de blagues ; pas raconter les détails ; il ne faut pas trop pleurer parce que ça déstabilise ; il ne faut pas trop être joyeuses parce que, du coup, les gens oublient qu’on est traumatisées… Tout ça fait que, du coup, on n’a plus le droit jamais de prononcer ce mot. » 352 (Cf. Femmes. Silence, Langage. Mots)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Simpson O. J) : (novembre) 2029. Lu dans Le Monde Diplomatique - à l’occasion de la sortie en France du film (coffret de 5 DVD) O.J : Made in America, fondé sur des « milliers d’archives télévisées » - cette analyse concernant les liens entre le racisme et l’acquittement d’O.J Simpson (noir) du meurtre de son épouse (blanche) :
« Centré sur le clivage racial, le film rappelle que celui que le boxeur Mohammed Ali [1942-2016] qualifiait de ‘sportif contre-révolutionnaire’ vivait dans le quartier le plus chic et le plus blanc de Los Angeles et claironnait : ‘Je ne suis pas noir. Je suis O.J’. Pourtant ses avocats jouèrent la carte raciale et réussirent à arracher l’acquittement, malgré un faisceau d’indices [preuves] accablantes. Le réalisateur ne s’intéresse pas vraiment à la psychologie du personnage ; il est ici un héros américain déchu devenu l’instrument qui permet à la communauté noire de Los Angeles une revanche symbolique sur la police - la quelle la maltraitait impunément depuis les émeutes de Watts en 1965. » 353 Une brillante synthèse. (Cf. Hommes. « Héros », Violences. Viols. Racisme)
Violences à l’encontre des femmes (Sinclair Anne) : (22 septembre) 2022. Anne Sinclair, sur France Culture, ex-épouse de Dominique Strauss-Kahn, concernant les gravissimes accusations rendus publiques dont il était l’objet - « cette catastrophe » - concernant sa vie, la qualifie ainsi : « une vie assez particulière ou dissolue, ou peu importe, je n’ai pas de jugement à porter dessus ». Elle emploie le terme d’ « emprise », puis se reprend et le remplace par « dépendance » et reconnait le « déni ».
J’ai aussi entendu :
- « Ce n’est pas un homme violent » ;
- « Une histoire parfaitement sordide » ;
- « Sa part d’ombre » ;
- « Des accusations qui sont tombées », et :
- « Aujourd’hui, je m’en fiche ». 354 (Cf. Femmes. Épouse de, Famille. Couple, Proxénétisme. Strauss-Kahn Dominique, Violences. « Droit de cuissage »)
Violences à l’encontre des femmes (Steinem Gloria) : 2015. Gloria Steinem, dans Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe, présente à la manifestation pour les droits civiques du 28 août 1963 de Washington écrit :
« Si Rosa Parks [1905-2013], Fannie Lou Hamer [1917-1977] et d’autres avaient parlé il y a cinquante ans - si les femmes avaient représenté la moitié des orateurs en 1963 - on aurait peut-être entendu que le mouvement des droits civiques était aussi une protestation contre le viol rituel et la terreur exercée contre les femmes noires par les hommes blancs. On aurait peut-être appris que Rosa Parks avait été chargée par la NAACP d’enquêter sur le viol d’une Noire par des Blancs - qui l’avaient laissée pour morte près d’un arrêt de bus de Montgomery - avant le célèbre boycott. On aurait peut-être appris que le chiffre qui permettrait le plus sûrement de déterminer sir le niveau de violence était élevé à l’intérieur d’un pays - ou s’il serait enclin à [utiliser] des armes contre une autre nation -, ce n’était ni le niveau de pauvreté, ni la quantité de ressources naturelles, ni la religion, ni même de degré de démocratie, mais la violence envers les femmes. Elle banalise toutes les formes de violence. » 355 (Cf. Femmes. Remarquables. Parks Rosa, Politique. Racisme, Pornographie, Histoire. Patriarcale)
Violences à l’encontre des femmes (Survivantes) : (5 janvier) 2023. Entendu, dans l’émission Sœurs de plainte de France Culture, dans les remarquables témoignages / analyses de femmes victimes de violences, au lieu et place et /ou de « survivantes » l’expression de « sœurs vivantes ».
Violences à l’encontre des femmes (Sylvestre Anne) : 2011. Dernières strophes de la chanson d’Anne Sylvestre [1934-2020] : Maison douce :
[…] La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom,
Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on.
Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie
Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri.
D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée :
Celles qui sont au village se font toujours respecter.
Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien.
C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin.
Si vous passez par la route et si vous avez du cœur,
Vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur.
Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours.
Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours.
Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée,
C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner.
Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix,
Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé.
Non, non, je n'invente pas. Moi, je dis ce que je dois. »
Violences à l’encontre des femmes (Taraud Christelle) : (22 décembre) 2022. Christelle Taraud, présentant, sur RFI, l’Histoire mondiale des féminicides, livre qu’elle a coordonné, auteure de :
« Encore une fois, nous ne faisons pas la guerre aux hommes. »
C’est à désespérer… Il est des phrases qui, à elles seules, peuvent détruire un livre. (Cf. Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
* Ajout. 16 avril 2024. Pour explicitation : se justifier est une manifestation de faiblesse et une reconnaissance du pouvoir de ceux/celles qui sont reconnu-es dès lors comme la bonne et légitime norme ; qui plus est, se justifier sur le fondement d’un ‘argument’ si grossier qu’il interdit toute pensée féministe interroge la crédibilité de l’emploi même de ‘féminicide’.
Violences à l’encontre des femmes (Tchékhov Anton) : 1894. Anton Tchékhov [1860-1904], dans L’étudiant, auteur de :
« Loukeria, […] abrutie de coups par son mari. » 356 (Cf. Violences. Tchékhov Anton. « Droit de cuissage »)
Violences à l’encontre des femmes (Thiam Awa) : 1977. Dépôt légal. 1983. Awa Thiam, dans La parole aux négresses, concernant les mutilations sexuelles, et précisément « la clitoridectomie », auteure de :
« Il ne s’agit pas ici de traiter de la jouissance, mais on peut se demander quelle est l’utilité de réduire la vie sexuelle de la femme à sa fonction reproductrice alors que, naturellement, elle ne consiste pas uniquement en cela. Pourquoi saccager les organes génitaux des femmes alors qu’elles n’en font aucune demande consciente ? N’y a-t-il pas là aliénation ? Dès lors ces pratiques ne sont-elles pas à bannir de toute société au même titre que toute mutilation exercée sur le corps ou l’esprit de n’importe quel être humain ? » 357 (Cf. Corps. Clitoris, Politique. Répression. Tortures)
N.B. On peut noter l’évolution positive de la pensée féministe depuis cette date aux questions posées, aux termes employés par celle qui en fut l’une des pionnières.
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Léon Tolstoï :
Violences à l’encontre des femmes (Tolstoï Léon) (1) : (22 janvier) 1889. Léon Tolstoï [1828-1910], écrit dans son Journal :
« Est venue une touchante femme avec quatre enfants et sa mère - le mari, de formation universitaire, alcoolique, la met dehors, la bat, elle demandait que faire de lui ? Oui, de deux choses l’une : l’accepter dans la famille et conduire les enfants à leur perte ou le chasser, la main au collet. Quant à la seule chose qui sont nécessaire - le guérir par amour - elle n’est pas là. Et d’ailleurs, je ne sais pas, est-ce ainsi ? Oui, il me semble, il faut l’accepter selon Dieu. » 358
Violences à l’encontre des femmes (Tolstoï Léon) (2) : (4 mai) 1889. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« De là en passant par le chemin des Vierges, je suis tombé sur une scène terrible : un ouvrier, bien portant, grand, proprement vêtu, exigeait d’une femme, tout menue, qu’elle tint sa promesse de coucher avec lui ou qu’elle rendit la moitié de ce qu’il avait bu avec elle, 40 kopecks. Elle lui en offrait 20 et voulait s’en aller. Il se vantait devant la foule, qui l’approuvait, que si elle ne donnait pas 40 il la prendrait pour la nuit et l’étrillerait jusqu’aux durillons (éclats de rires). Il la tirait avec colère pour qu’elle couche avec lui. Puis il l’a menée jusqu’aux autorités pour exiger qu’elle tint sa promesse. Je les ai suivis et n’ai pas pu me contenir, je suis intervenu, lui ai donné 20 kopecks et lui ai dit qu’il oubliait Dieu et sa loi. La foule est passée de mon côté. Il est marié et l‘a dit sans honte. Quand donc les dénoncerais-je ? Se peut-il qu’il ne le faille pas. » 359 (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes, Hommes. Violents, Justice. Patriarcale, Patriarcat, Proxénétisme)
Violences à l’encontre des femmes (Tolstoï Léon) (3) : (19 janvier) 1901. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« La fidélité des femmes a été obtenue et est obtenue chez la plupart des peuples par la violence des hommes sur les femmes. La violence est un mal, mais les hommes considèrent que l’infidélité est pire que la violence […]. Les femmes, elles, pensent que tout se résume à la violence. » 360 (Cf. Femmes. Fidèles)
Violences à l’encontre des femmes (Tolstoï Léon) (4) : (5 juin) 1910. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« Quel délice l’histoire de Paracha la pauvre d’esprit ! »
Et, en note, je lis :
« Prascovie Timofiéievna Tokhmatchov [1867-1915 ?], dite Paracha, s’était trouvée enceinte (sic) puis ayant fait une fausse-couche, promettant que désormais ‘celui qui s’approcherait, elle lui donnerait sur la gueule’. » 361 (Cf. Violences. Viols)
-------------
Violences à l’encontre des femmes (Tristan Flora) : 1840. Flora Tristan [1803-1844], dans Promenade dans Londres, rapportant ce qu’elle avait vu dans les Finishes - « Oh, alors, il faut avoir du coupage pour rester là, muet spectateur de tout ce qui se passe » - auteure de :
« Un des [« jeux »] les plus goûtés est de soûler une fille jusqu’à ce qu’elle tombe morte ivre ; alors on lui fait avaler du vinaigre dans lequel de la moutarde et du poivre ont été délayés ; ce breuvage lui donne presque toujours d’horribles convulsions, et les soubresauts et les contorsions de cette malheureuse provoquent les rires et amusent infiniment l’honorable société. Un divertissement fort apprécié aussi dans ces fashinables réunions, c’est de jeter sur les filles qui gisent mortes ivres sur le plancher un verre de n’importe quoi. J’ai vu des robes de satin qui n’avaient plus aucune couleur : c’était un mélange confus de souillures : le vin, l’eau-de-vie, la bière, le thé, le café, la crème, etc.., y dessinaient mille formes fantasques - écriture diaprée de l’orgie. » 362
Violences à l’encontre des femmes (Trump Donald) : (10 février) 2018. Donald Trump écrit dans un tweet, après que deux conseillers de la Maison Blanche aient été accusés de violences par leurs ex-épouses :
« Des gens voient leur vie détruite et brisée par de simples accusations. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes. Quelqu’un qui est faussement accusé ne peut pas s’en remettre, sa vie et sa carrière sont finies. Il n’existe donc plus de procédures équitables ? » 363 (Cf. Hommes. « Politiques ». Trump Donald, Justice. Trump Donald, Patriarcat. Affaire Weinstein, Politique)
Violences à l’encontre des femmes (Union Européenne) : (19 décembre) 2023. En décembre 2023, plusieurs interventions dans les médias ont eu lieu concernant le projet d’une nouvelle définition du viol dans le code pénal français, centrées autour de la question du « consentement » - une contradiction dans les termes, par ailleurs.
Mais ce qui n’a pas été dit et / ou pris en compte à sa juste importance, c’est que l’un des enjeux - le principal ? - est d’adapter la loi française à la prochaine Directive européenne. Or, que propose-t-elle ?
Je lis : Proposition de Directive du parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique :
Exposé des motifs. Motivation de la proposition :
« La violence contre les femmes couvre les infractions telles que les violences sexuelles, y compris le viol, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, la traque furtive, le harcèlement sexuel, le féminicide, les discours de haine et les crimes à caractère sexuel, et diverses formes de violence en ligne («cyberviolence»), y compris la manipulation ou le partage non consentis de matériels intimes, la traque furtive en ligne et le cyberharcèlement. » (Ce texte du 8 mars 2022 a été depuis modifié, mais je n’ai pu / su trouver la dernière rédaction).
Ainsi, cette formulation, sous couvert de lutte contre « la violence contre les femmes » - le singulier, déjà, est rédhibitoire - englobe, mêle indistinctement - dans un monstrueux amalgame - ce qui relève des viols, des tortures, du proxénétisme, du mariage, du harcèlement sexuel, des discriminations, de la liberté d’expression, de la définition de la haine, des crimes, de la législation sur le net…
Il est facile de comprendre que tous relèvent de législations de natures différentes et bouleversent la constitution et son Préambule, le droit civil, le droit pénal, et leurs jurisprudences, mais aussi le droit européen, et le droit international.
Catherine Le Magueresse, ainsi que de nombreuses féministes qui y sont très attachées, a lié la réforme de la définition du viol à l’article l’article 36 - Violence sexuelle, y compris le viol - de la Convention d’Istamboul émanant du Conseil de l’Europe [entrée en vigueur le 1er août 2014, pour la France, le 1er novembre 2014, actuellement signée et ratifiée par 38 États et dénoncée par la Turquie le 22 mars 2021] dont l’alinéa 2 précise :
« Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. »
Tout d’abord, il importe de dire que la Convention d’Istanbul ne pèse que de peu de poids, comparée aux Directives européennes qui non seulement concernent tous les États-membres de l’Europe, mais a vocation à être mise au oeuvre internationalement. Politiquement, économiquement parlant, le Conseil de l’Europe ne peut être mis sur le même pied que l’Union européenne ; et que cette dernière ait ratifié la Convention d’Istanbul lui accorde certes de l’importance, mais change rien à la valeur comparée de ces deux institutions.
Aussi, si les débats autour du « consentement » qui posent d’importantes questions théoriques, juridiques, politiques, féministes, concernent certes le droit français, ils concernent bien au-delà, cette Directive. Sans oublier tous les pays européens et l’ensemble de leur législation. Et, remet même en cause nombre de Directives européennes.
Les conséquences de ce texte sont donc gigantesques.
Ne pas la prendre au sérieux, ne pas la dénoncer, dans ses principes, dans ses fondements, dans sa finalité, c’est accepter que tous les rapports de domination soient dorénavant définis non pas en eux-mêmes, dans leur ancrage politique, juridique, spécifique, mais par le « consentement » ou non [la réponse à cette question, aussi importante soit-elle, devenant secondaire] des victimes [nous tous et toutes, en réalité] à leur réalité. Il suffit que le terme soit prononcé.
Il importe, à cet égard, de rappeler les débats qui ont eu lieu lors de la Conférence de Pékin sur les femmes de l’ONU de septembre 1995 qui ont abouti le dernier jour à l’ajout du terme de « forcé » à « prostitution » qui a ouvert la voie à la prostitution dite « libre » et donc au proxénétisme.
Si le terme de « consentement » est ajouté à cette Directive - et le débat actuellement en France en est le banc d’essai, la pierre de touche, le prolégomène - la question ne sera plus celle de la définition du proxénétisme, de la prostitution, des proxénètes, des clients, mais celle de savoir si la personne aura ou non été « consentante ». À ?
La suite des nombreuses pages de ce texte (84) n’étant qu’une suite d’amalgames, de brouillamini, de salmigondis, d’associations de mots, jamais définis, de phrases dépourvues de sens, des confusions, de notes, de sources diverses et variées, amalgames, incohérences, contradictions, amalgames, incohérences, contradictions [sans oublier les termes entre crochets] qu’il est littéralement impossible de le critiquer point par point tant ce charabia est inhérent au texte lui-même.
Mais, pourtant, tout est à lire, à analyser, à critiquer, à dénoncer.
Car cette confusion est fonctionnelle. (Cf. Êtres humains, Droit, Justice, Langage, Patriarcat, Penser. Consentement, Politique, Proxénétisme, Violences. Viols)
N.B. Cette analyse qui, me concernant, s’inscrit dans la lignée du texte paru dans Le Monde Diplomatique de mars 1997 : Le corps humain sur le marché, est aussi valable concernant les débats actuels en France sur l’émigration et « la politique de l’UE en matière de migration et d’asile »
* Ajout. 20 décembre 2023. Concernant les débats autour du terme de « consentement », outre la question de la hiérarchie des textes (français et européens),
- outre la question de la comparaison entre la Convention d’Istanbul (existante) et la Directive européenne (en devenir),
- outre la question de ce qui différencie le langage commun - qui rend impossible, impensable tout « consentement » à un viol,
la question du « consentement » - ou non, - explicite - ou non - concerne les relations sexuelles. Aussi fondamentale soit-elle, l’aborder dans le cadre d’une réforme du viol doit être hors sujet.
En sus, il ne faut pas oublier que le langage du droit, tel qu’en l’état, charrie, malgré et en y intégrant ses nombreuses évolutions progressives, sinon des siècles du moins près de deux siècles de pensées patriarcales, auxquelles se surajoute la pensée capitaliste libérale qui est celle de l’Union européenne. Aussi vouloir modifier le droit, c’est nécessairement s’inscrire dans sa logique, ce qui explique les difficultés des juristes féministes lorsqu’il s’agit de proposer des réformes législatives.
Plus encore, l’enjeu que pose ce terme de « consentement » - qui est au cœur est au cœur de ces contradictions – dépasse, et de loin, et la définition du viol, et la Directive européenne : son ajout signifierait que notre monde serait dorénavant analysé, non pas par le prisme des différents systèmes de domination [impérialiste, capitaliste, écologique, patriarcal, proxénète…] qui l’ont constitué et le structurent - mais par le « consentement » - ou le « non-consentement » - individuel de chacun-e.
Qu’adviendrait-il des si nécessaires, incontournables, critiques, politiques, économiques, écologiques, nécessairement, globales, radicales ?
Un éclairage ponctuel : le lendemain de l’émission Le temps du débat de France Culture :
« La France doit-elle redéfinir pénalement le viol ? » [18 décembre 2023] s’intitulait :
« Où en est le consentement à la guerre en Ukraine ? » [19 décembre 2023] (Cf. Penser. Consentement)
* Ajout. 3 février 2024. Tout [bien] considéré, la seule solution, si non juste, du moins la plus juste, pour les femmes victimes de violences patriarcales, évitant les « pièges du consentement » serait l’inversion de la charge de la preuve. (Poursuivre) (Cf. Penser. Consentement)
* Ajout. 28 février 2024. Cette position est aussi celle de Geneviève Fraisse dans Le Un Hebdo. n° 485
Violences à l’encontre des femmes (Victorine) : 2005. Victorine [1911-2010], auteure de :
« […] Habituée à avoir des coups. Tu t’attends à un autre… » 364
N.B. France Culture n’a pas cru bon donner son nom.
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Voltaire :
Violences à l’encontre des femmes (Voltaire) (1) : (11 octobre) 1760. Voltaire [1694-1778] lors de ce qui fut appelé la « Guerre de sept ans [1756-1763] » évoque de l’entrée des Russes à Berlin. Voici les présentations qu’il en fait à ses interlocuteurs français :
- le 26 octobre 1760 à Jean-Robert Tronchin [1710-1793] :
« Les Russes ont pris pour eux à Berlin toutes les vieilles. Soixante et dix, quatre-vingt, nonante, nul âge ne les rebutait. Tout était bon. Ils disaient qu’il fallait laisser les jeunes aux Autrichiens qui ne sont pas si robustes que les Russes. Mon Dieu, que je suis loin d’être russe ! et que vous en êtes près ! »
- le 5 novembre 1760 au seigneur d’Hermenches [1722-1785] :
« Les Russes ont pris pour eux toutes les vieilles, et ont laissé les jeunes aux Autrichiens comme à des gens faibles qui n’auraient pas pu venir à bout des décrépites. Voilà la seule espèce de bravoure dont vous ne vous piqueriez pas. »
- Et ce, tandis qu’à son interlocuteur Russe, il écrit :
- le 7 novembre 1760 à Ivan Ivanovitch Schouvalov [1727-1797] :
« Je ne peux finir cette lettre sans vous dire combien votre nation à acquis d’honneur par la capitulation de Berlin ; on dit que vous avez donné l’exemple de la plus exacte discipline, qu’il n’y a eu ni meurtre, ni pillage ; le peuple de Pierre le Grand eut autrefois besoin de modèle, et aujourd’hui il en sert aux autres. »
- le 15 novembre 1760 au même :
« Je vous fait encore mes compliments sur l’exemple de l’ordre, de l’observation du droit des gens, et de toutes les vertus civiles et militaires que vos compatriotes ont donné à la prise de Berlin. » 365 (Cf. Culture, Femmes, Hommes. Un homme à Berlin, Politique. Guerre. Femmes, Histoire)
Violences à l’encontre des femmes (Voltaire) (2) : (13 novembre) 1770. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Joseph Vasselier [1735-1798] concernant la mort d’une jeune femme assassinée à Lyon, Claudine Lerouge écrit :
« Il me parait clair que la petite Lerouge a été noyée, et que la Forobert est une maquerelle. J’ai grande peur d’avoir dit trop tôt que tout le monde était innocent. »
Mais le 7 juin 1771, il en proposera une autre analyse ; puis ‘vers décembre’ 1771, encore une autre. 366
N.B. Le 25 juin 1767, une jeune fille de 18 ans, Claudine Lerouge, disparaît à Lyon. Cinq jours plus tard, à environ neuf lieues de Lyon, sur les bords du Rhône, des pêcheurs découvrent le corps déjà en partie décomposé d'une jeune fille. Bien qu'alertés, ni les officiers d'état civil, ni les autorités religieuses, ne daignent se déranger pour constater le décès et prendre les mesures nécessaires pour disposer du corps ; le soir, les pêcheurs décident de l'enterrer eux-mêmes là où ils l'ont trouvé, sur la plage, au pied d'un saule.
Pour la suite, Cf. Alain Nabarra, ‘Les rapports que nous font les hommes’. Voltaire et l’affaire Lerouge. 367 (Cf. Justice)
Violences à l’encontre des femmes (Voltaire) (3) : (21 novembre) 1770. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Joseph Vasselier [1735-1798], concernant l’assassinat de Claudine Lerouge, écrit :
« On dit qu’il n’est pas rare qu’à Lyon on jette les filles dans le Rhône après avoir couché avec elles. » 368
* Ajout. 4 mai 2018. (7 juin) 1771. Voltaire, dans une lettre adressée à Élie de Baumont, [1732-1786] écrit que : « jeter [un] corps dans le Rhône est assez commun à Lyon », puis, dans une lettre écrite vers décembre 177I à un inconnu, il écrit : […] [que] « jeter [un] cadavre dans le Rhône, ce qui n’est que trop commun dans la ville de Lyon. » 369 (Cf. Corps. Cadavres)
Violences à l’encontre des femmes (Voltaire) (4) : (25 février) 1774. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée au comte d’Argental [1700-1788], concernant Beaumarchais [1732-1799] accusé ‘d’avoir assassiné deux femmes’, écrit :
« Un homme vif, passionné, impétueux, peut donner un soufflet à sa femme, et même deux soufflets à ses deux femmes, mais il ne les empoisonne pas. »
Beaumarchais, en possession de cette lettre, publie cette note :
« Je certifie que ce Beaumarchais-là, battu quelques fois par des femmes, comme la plupart de ceux qui les ont bien aimées, n’a jamais eu le tort honteux de lever la main sur aucune. » 370
Brevet de ‘bonne conduite’ envers les femmes. Entre hommes. Sur quels fondements ? quelle connaissance ? Leur bon droit, leurs justifications, leurs dénis. Mais pourquoi pas, juste ? (Poursuivre) (Cf. Patriarcat)
-------------
Par ordre chronologique. Violences à l’encontre des femmes. Émile Zola :
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (1) : 1867. Émile Zola [1840-1902], dans Thérèse Raquin, auteur de :
« […] Mais, de grâce, ne m’accuse pas d’avoir tué Camille [l’époux qu’ils sont tués]. Garde ton crime pour toi, ne cherche pas à m’épouvanter davantage.
Laurent leva la main pour frapper Thérèse au visage.
- Bats moi, j’aime mieux ça, ajoute-t-elle, je souffrirai moins. Et elle tendit la face. Il se retint. […]
Laurent, ivre, rendu furieux par les tableaux atroces que Thérèse étalait devant ses yeux, se précipitait sur elle, la renversait par terre et la serrait sur son genou, poing fermé.
- C’est cela, criait-elle, frappe-moi, tue-moi… Jamais Camille n’a levé la main sur ma tête, mais toi, tu es un monstre.
Et Laurent, fouetté par ces paroles, la secouait avec rage, la battait, meurtrissait son corps de son poing fermé. À deux reprises, il faillit l’étrangler. Thérèse mollissait sous les coups ; elle goûtait une âpre volupté à être frappée ; elle s’abandonnait, elle s’offrait, elle provoquait son mari pour qu’il l’assommât davantage. C’était encore là un remède contre les souffrances de sa vie ; elle dormait mieux la nuit, quand elle avait été bien battue le soir. » 371
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (2) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La fortune des Rougon, auteur de :
« Le logis de l’impasse Saint-Mittre resta hermétiquement clos et garda ses secrets. On devina seulement que Macquart devait battre Adélaïde, bien que jamais le bruit d’une querelle ne sorti de la maison. À plusieurs reprises, elle reparut la face meurtrie, les cheveux arrachés. D’ailleurs, pas le moindre accablement de souffrance ni même de tristesse, pas le moindre souci de cacher ses meurtrissures. Elle souriait, elle semblait heureuse. Sans doute, elle se laissait assommer sans souffler mot. Pendant plus de quinze ans, cette existence dura. » 372
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (3) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« […] M. Simpson, attaché à l’ambassade américaine, qui vint après, faillit la battre, et dut à cela de rester plus d’un an avec elle. » 373
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (4) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’assommoir, auteur de :
« Depuis que le père Bijard avait tué sa bourgeoise d’un coup de pied dans le ventre, Lalie (8 ans) s’était faite la petite mère de tout ce monde [« son frère Jules et sa sœur Henriette, deux mômes de trois ans et de cinq ans »]. Sans rien dire, d’elle-même, elle tenait la place de la morte, cela au point que sa brute de père, pour compéter sans doute la ressemblance assommait aujourd’hui la fille comme il avait assommé la maman autrefois. Quand il revenait soûl, il lui fallait des femmes à massacrer. Il ne s’apercevait seulement pas que Lalie était toute petite ; il n’aurait pas tapé plus forte sur une vieille peau. […] » 374 (Cf. Enfants. Filles, Femmes. Comment meurent les femmes. Filles ainées. Mères, Patriarcat. Pères, Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (5) : (20 août) 1878. Émile Zola [1840-1902], dans une lettre à Léon Hennique [1850-1935], critique son livre La Dévouée - édité chez Charpentier dans la série intitulée « les héros modernes » - dans lequel un homme Jeoffrin tue ses deux filles, empoisonne l’une et accuse l’autre du crime, laquelle sera guillotinée :
« S’il tuait ses filles pour manger leur argent, ce serait un vulgaire scélérat, mais il serait humain ; il les tue pour construire son ballon [aérostat], et on dit : ‘C’est un fou’. D’autant plus qu’on se demande si, avant d’en arriver au crime, il n’aurait pas pu dépouiller ses filles sans entrer dans le gros drame. […] » 375
L’assassinat, un moindre mal… (Cf. Hommes. « Héros »)
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (6) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« Alors, poussé à bout, volant dormir, Fontan lui allongea une gifle, à toute volée. La gifle fut si forte, que, du coup, Nana se retrouva couchée, la tête sur l’oreiller. Elle resta étourdie.
- Oh ! dit-elle simplement, avec un gros soupir d’enfant.
Un instant, il la menaça d’une autre claque, en lui demandant si elle bougeait encore. Puis, ayant soufflé la lumière, il s’installa carrément sur le dos, il ronfla tout de suite. Elle, le nez dans l’oreiller, pleurait à petits sanglots. C’était lâche d’abuser de sa force. Mais elle avait eu une vraie peur, tant le masque drôle de Fontan, était devenu terrible. Et la colère s’en allait, comme si la gifle l’avait calmée. Elle le respectait, elle se collait contre le mur de la ruelle, pour lui laisser toute la place. […] » 376
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (7) : 1885. Émile Zola [1840-1902], dans Germinal, auteur de :
« […| Les Maheu apprirent que Chaval gardait Catherine. Il lui faisait des scènes si abominables, qu’elle s’était décidée à se mettre avec lui. » 377
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (8) : 1885. Émile Zola [1840-1902], dans Germinal, auteur de :
« Depuis quelques temps, Jeanlin abusait. Il battait Lydie comme on bat une femme légitime […]. » 378
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (9) : 1885. Émile Zola [1840-1902], dans Germinal, auteur de :
« […] Elle [Catherine] répondit simplement : ‘Je rentre, Chaval est mon homme, je n’ai pas à coucher ailleurs que chez lui. ‘
- Mais il t’assommera de coups !
Le silence recommença. Elle avait eu un haussement d’épaules résigné. Il la battrait, et quand il serait las de la battre, il s’arrêterait ; ne valait-il pas mieux ça, que de rouler les chemins comme une gueuse ? Puis, elle s’habituait aux gifles, elle disait, pour se consoler, que sur dix filles, huit ne tombaient pas mieux qu’elle. Si son galant l’épousait un jour, ce serait tout de même gentil de sa part. […]
Peut-être, en effet, était-ce plus sage de souffrir ce qu’on souffrait, sans tenter une autre souffrance ? » 379 (Cf. Violences à l’encontre des femmes. Gifles)
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (10) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« Jean se mit à rire...
‘Ce sacré Buteau, nous étions camarades… Ah ! Ça ne lui coûte guère de mentir aux filles ! Il lui en faut quand même, il les prend à coups de poings, lorsqu’elles ne veulent pas par gentillesse.
- Bien sûr que c’est un cochon, déclara Françoise d’un air convaincu. On ne fait pas à la cousine la cochonnerie de la planter là, le ventre gros’. » (Cf. Corps. Ventre, Femmes. Enceintes. « Gentilles », Hommes. « Cochons », Patriarcat) 380
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (11) : 1890. Émile Zola [1840-1902], dans La bête humaine, auteur de :
- « Puisqu’il ne les [les femmes] connaissait pas, quelle fureur pouvait-il avoir contre elles ? car, chaque fois, c’était comme une soudaine crise de rage aveugle, une soif toujours renaissante de venger des offenses très anciennes, dont il aurait perdu l’exacte mémoire. Cela venait-il donc de si loin, du mal que les femmes avaient fait à sa race, de la rancune amassée de mâle en mâle, depuis la première tromperie au fond des cavernes ?
Et il sentait aussi, dans son accès, une nécessité de bataille pour conquérir la femelle et la dompter, le besoin perverti de la jeter morte sur son dos, ainsi qu’une proie qu’on arrache aux autres, à jamais. Son crâne éclatait sous l’effort, il n’arrivait pas à se répondre, trop ignorant pensait-il, le cerveau trop sourd, dans cette angoisse d’un homme poussé à des actes où sa volonté n’était pour rien, et dont la cause en lui avait disparu.
- Il sentait que le mâle, en dehors de sa volonté, pousserait la porte, étranglerait la fille, sous le coup de l’instinct du rapt et par le besoin de venger l’ancienne injure.
- Il fut inondé de félicité. […] Elle était à lui sans bataille. […] Il ne sentait plus sa soif de venger des offenses très anciennes dont il avait perdu l’exacte mémoire, cette rancune amassée de mâle en mâle, depuis la première tromperie au fond des cavernes.
- Était-ce sa soif qui était revenue, de venger des offenses très anciennes, dont il aurait perdu l’exacte mémoire, cette rancune amassée de mâle en mâle, depuis la première tromperie au fond des cavernes ? Il fixait sur Séverine ses yeux fous, il n’avait plus que le besoin de la jeter morte sur son dos, ainsi qu’une proie qu’on arrache aux autres. La porte d’épouvante s’ouvrait sur ce gouffre noir du sexe, l’amour jusque dans la mort, détruire pour posséder davantage. […]
Elle reculait, hagarde, sans défense, la chemise arrachée.
‘Pourquoi ? mon dieu, pourquoi ?’ […]
Et il abattit le poing, et le couteau lui cloua la question dans la gorge.
Pourquoi, pourquoi l’avait-il assassinée ? Et elle venait d’être broyée, emportée dans la fatalité du meurtre, en inconsciente que la vie avait roulé de la boue dans le sang, tendre et innocente quand même, sans qu’elle eut jamais compris.
Mais Jacques s’étonna. Il entendit un reniflement de bête, grognement de sanglier, rugissement de lion ; et il se tranquillisa, c’était lui qui soufflait. Enfin, enfin ! il s’était donc contenté, il avait tué ! Oui, il avait fait ça. Une joie effrénée, une jouissance énorme le soulevait, dans la plaine satisfaction de l’éternel désir. Il en éprouvait une surprise d’orgueil, un grandissement de sa souveraineté de mâle. La femme, il l’avait tuée, il la possédait comme il désirait depuis si longtemps la posséder, toute entière jusqu’à l’anéantir. Elle n’était plus, elle ne serait jamais plus à personne. […]
Cet homme que, depuis des mois, épargnaient les scrupules de son éducation, les idées d’humanité lentement acquises et transmises, il n’avait plus à l’attendre ; et, au mépris de son intérêt, il venait d’être emporté par l’hérédité de violence, par ce besoin de meurtre qui, dans les forêts premières, jetait la bête sur la bête. Est-ce qu’on tue par raisonnement ! On ne tue que son l’impulsion du sang et des nerfs, un reste des anciennes luttes, la nécessité de vivre et la joie d’être fort. » 381 (Cf. Êtres humains. Cerveaux. Désirs, Femmes. « Faibles ». Comment meurent les femmes, Hommes. Forts. Irresponsables, Relations entre êtres humains. Haine des femmes, Patriarcat. Permanence, Penser. Raison, Politique. Animalisation du monde, Histoire)
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (12) : 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’argent, auteur de :
« Saccard, un soir, s’étant réveillé trop tôt, et l’ayant trouvée en train de visiter son portefeuille, l’avait giflée comme une fille qui pêche des sous dans le gilet des messieurs et depuis lors, il la battait, ce qui l’enrageait, puis les brisaient et les calmaient tous les deux. » 382
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (13) : 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’argent, auteur de :
« Léonide eut peur, leva le coude, afin de se protéger la figure, dans le mouvement instinctif des filles habituées aux gifles. » 383 (Cf. Violences à l’encontre des enfants. Violences à l’encontre des femmes. Gifles)
Violences à l’encontre des femmes (Zola Émile) (14) : 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’argent, auteur de :
« Elle avait 13 ans, seule au monde désormais, sa mère étant morte un soir de saoûlerie d’un coup de pied dans le ventre qu’un homme lui avait allongé pour ne pas lui donner les six sous dont ils étaient convenus. » 384 (Cf. Corps. Ventre, Femmes. Comment meurent les femmes. Enceintes)
-------------
VIII. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage » :
Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage » :
Violences à l’encontre des femmes (« Droit de cuissage ») (1) : « Elles y passaient toutes […] », entendait-on, sans excès de révolte…
- Et si tout [ou presque…], en matière de compréhension du monde, n’était qu’une question de point de vue, d’analyse, et était donc lisible - et donc dénonciable - par le langage ?
Violences à l’encontre des femmes (« Droit de cuissage ») (2) : Dès lors qu’il s’agit - dans l’esprit de celui en droit ou en fait de l’exiger - d’un droit, il s’agit alors pour celle sur laquelle le dit droit s’exerce d’un dû. La question, pour lui, du consentement, comme du refus, est hors sujet. Et ce n’est que le refus - aux mille formes d’expressions et de manifestations - qui le contraint à s’interroger sur sa légitimité à y prétendre.
Par ordre alphabétique. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage » :
« Droit de cuissage » (Anonyme. XVIIème siècle) : Le roi a fait battre tambour / Pour voir toutes ses dames / Et la première qu'il a vue / Lui a ravi son âme /
Marquis dis-moi la connais-tu / Qui est cette jolie dame ? / Le marquis lui a répondu / Sire roi, c'est ma femme. /
Marquis, tu es plus heureux que moi / D'avoir femme si belle / Si tu voulais me la donner / Je me chargerais d'elle. /
Sire, si vous n'étiez le roi / J'en tirerais vengeance / Mais puisque vous êtes le roi / A votre obéissance. /
Marquis ne te fâche donc pas / T'auras ta récompense / Je te ferai dans mes armées / Beau maréchal de France. /
Adieu, ma mie, adieu, mon cœur ! / Adieu mon espérance ! / Puisqu'il nous faut servir le roi / Séparons-nous d'ensemble ! /
La reine a fait faire un bouquet / De belles fleurs de lys / Et la senteur de ce bouquet / A fait mourir marquise. »
Je lis sur Wikipédia qu’il en existe « au moins 53 versions ». (Femmes. Comment meurent les femmes, Politique. Féodalité)
« Droit de cuissage » (Apollinaire) : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, auteur de :
« La dernière fois que je l’avais vu [Paul Léautaud. 1872-1956], Marie Laurencin [1883-1956] vomissait des horreurs sur Apollinaire [1880-1918] à qui elle ne pardonnait pas de ne pas l’avoir épousée. Selon elle, il culbutait toutes les bonniches de la maison et se branlait dans son lit, dès le réveil ‘pour être tranquille’. Et elle alors, à quoi servait-elle ? » 385 (Cf. Langage. Critique de mots : « Bonniches »)
« Droit de cuissage » (Aragon) : 1936. Louis Aragon [1897-1982], dans Les beaux quartiers, auteur de :
- « Victorine était la bonne que Madame avait mise à la porte quand elle s’était aperçue que Monsieur couchait avec. »
- « […] Il n’avait pas le sou, couchait avec l’une des filles de cuisine du lycée qui lui raccommodait ses chaussettes […]. » 386
« Droit de cuissage » (Assiette de porcelaine) : Années 1930 [?]. J’ai une petite assiette de Badonviller [Lunéville] représentant une bonne à l’apparence stupide s’adressant à une grosse dame à l’apparence obtuse et suffisante, derrière laquelle se cache un mari maigrelet et sournois. Et celle-ci lui dit :
« L’on m’a dit qu’il n’y avait rien à faire et que monsieur était gentil avec les bonnes. » (Cf. Patriarcat. Assiette de porcelaine)
« Droit de cuissage » (Aubry Martine) : 1970. Martine Aubry raconte son stage à France soir - elle est alors en seconde année de licence - et comment elle fut reçue par Pierre Lazareff [1907-1972] :
« Il m’a dit : ‘Ici, il faut coucher avec les hommes du marbre [les typographes] et ça se termine par moi’. J’ai découvert une ambiance incroyable, les filles se faisaient pincer les fesses, la misogynie était terrible et gauloise, certaines en jouaient, comme ailleurs, encore plus qu’ailleurs. Cette coquetterie masochiste donne une très mauvaise image de la presse, ces femmes journalistes nous font du mal à toutes ; elles entretiennent le machisme. » 387 (Cf. Femmes. « Coquettes », Hommes. Journalistes, Patriarcat)
« Droit de cuissage » (Auguste) : (112-122 après J.C). Suétone [vers 70-vers 122], concernant Auguste, empereur Romain [63 avant J-C-14 après J-C], auteur de :
« […] Quant aux plaisirs, il y fut toujours attaché, et plus tard même, dit-on, sa passion fut de déflorer les jeunes filles, que sa femme elle-même faisait venir pour lui d’un peu partout. » 388 (Cf. Famille, Proxénétisme)
« Droit de cuissage » (Bachelot Roselyne) : 1999. Roselyne Bachelot, auteure de :
« (Après un début de discussion sur les mères célibataire) Au passage, je vous raconte cette discussion que ma mère a entendu dans une famille bourgeoise qui a donné deux évêques à la France (sic). Le père à sa femme : «’Marie-Rose vous changerez de bonne, celle-ci ne me plaît plus !’ La bonne était le moyen de contraception de la bourgeoise ! Quand elle avait eu trois ou quatre enfants, elle condamnait la porte de la chambre à coucher et le mari ‘se débrouillait’. » 389
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Honoré de Balzac :
« Droit de cuissage » (Balzac. Honoré de) (1) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« […] Cerizet avait importé les mœurs du gamin de Paris dans la capitale de l’Angoumois. Son esprit vif et railleur, sa malignité l’y rendaient redoutable. […] Cerizet était devenu, mais à l’insu de son tuteur, le don Juan en casquette de trois ou quatre petites ouvrières et s’était dépravé complètement. Sa moralité, fille des cabarets parisiens, prit l’intérêt personnel pour unique loi. » Puis, plus loin, il évoque, toujours le concernant, « les petites ouvrières dont il était le Don Juan et qu’il gouvernait en les opposant les unes aux autres. » 390
« Droit de cuissage » (Balzac. Honoré de) (2) : (7 octobre) 1845. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882] :
« Chez Rothschild, c’est allé comme de cire ; seulement en apprenant que je me mêlais du trousseau d’une D[emoise]lle, il m’a fait la délicate plaisanterie de me demander (comme il l’avait fait pour Lirette [Henriette Boriel, devenue religieuse] si j’avais le droit du Seigneur, et alors je lui ai dit :
- Vous parlez ainsi de gens qui sont au-dessus de nous comme le soleil est au-dessus de vos écus ! …
Il a senti sa bêtise et a ordonné de faire mes affaires le plus avantageusement possible. Cet homme n’a pas la conscience de ce qu’il dit, dès lors qu’il est hors de son commerce. » 391
« Droit de cuissage » (Balzac. Honoré de) (3) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] Si je ne viens pas dîner, il [son mari] dîne très bien avec la bonne, car la bonne est toute à monsieur […]. » 392
« Droit de cuissage » (Balzac. Honoré de) (4) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« Une nuit, Adeline, réveillée par un bruit étrange, ne trouva plus Hector dans le lit qu’il occupait auprès du sien, car ils couchaient dans ses lits jumeaux, ainsi qu’il sied à des vieillards. Elle attendit une heure sans voir revenir le baron. Prise de peur, croyant à une catastrophe tragique, à l’apoplexie, elle monta à l’étage supérieur occupé par les mansardes où couchaient les domestiques, et fut attirée vers la chambre d‘Agathe, autant par la vive lumière qui sortit par la porte, entrebâillée, que par le murmure de deux voix. Elle s’arrêta toute épouvantée en reconnaissant la voix du baron, qui, séduit par les charmes d’Agathe, en était arrivé par la résistance calculé de cette atroce maritorne, à lui dire ces odieuses paroles : ‘Ma femme n’a pas longtemps à vivre, et si tu veux, tu pourras être baronne.’ Adeline jeta un cri, laissa tomber son bougeoir et s’enfuit.
Trois jours après, la baronne, administrée la veille, était à l’agonie et se voyait entourée de sa famille en larmes. Un moment avant d’expirer, elle prit la main de son mari et lui dit à l’oreille : ‘Mon ami, je n’avais plus que ma vie à te donner ; dans un moment tu sers libre, et tu pourras faire une baronne Hulot’. » 393 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes, Famille. Couple)
-------------
« Droit de cuissage » (Berberova Nina) : 1969. Nina Berberova [1901-1993], dans C’est moi qui souligne, écrit en décembre 1942 :
« Un héros de notre temps.
J’ai connu S. autrefois en Russie. Dès l’âge de treize ans, il couchait avec les bonnes dans la maison de ses parents. » 394 (Cf. Hommes. « Héros »)
« Droit de cuissage » (Belgique. 1966) : 1966. En Belgique, à l’usine Herstal - la F.N. - une ouvrière se rappelle les régleurs :
« Quand elles ne voulaient pas, ils mettaient sa machine en panne et elles ne touchaient que le minimum. » Une autre se rappelle les chefs « qui gueulaient ».
Il n’en faut souvent pas plus - et souvent moins - pour licencier, sauf si l’on était ‘gentilles’…395
« Droit de cuissage » (Bistula Maria) : (21 septembre) 1931. Lettre adressée par Maria Bistula, « bonne de ferme » Polonaise en Indre et Loire à Julie Duval, inspectrice de la main d’œuvre immigrée (Ministère de l’Agriculture) :
« […] Il y a un malentendu entre moi et le fils du patron. Je travaille ici depuis sept mois et, pour la chose, il ne m’a pas laissée tranquille du tout, mais il est venu chez moi et moi je n’ai pas réussi à le repousser, il m’a prise de force en me criant dessus et il m’a violée. Qu’est-ce que je vais devenir maintenant, pauvre de moi, je vais me pendre et me noyer. Parce que je n’ai pas d’autre issue. Où aller ? Et lui, ça l’a fait rire quand je lui ai dit. Le 20 octobre il part à l’armée et moi je reste. Que vais-je faire ? […] » 396 Y a-t-il tragédie plus grande ?
« Droit de cuissage » (Broch Hermann) : 1931. Hermann Broch [1886-1951], dans Les somnambules, concernant M. von Pasenow, auteur de :
« Souvent il lui fallait se faire violence pour ne pas décacheter telle ou telle lettre adressée à une servante, acte où il ne voyait que l’exercice d’un jus primae noctis, tout naturellement dévolu au seigneur, et sa nature regimbait contre cette nouvelle mode de respecter le secret de la correspondance, même à l’égard des inférieurs. » 397 (Cf. Femmes. Servantes)
« Droit de cuissage » (Caserio Sante Geronimo) : (3 août) 1894. Sante Geronimo Caserio [1873-1894], anarchiste, après avoir assassiné Sadi Carnot, président de la République, le 24 juin 1894, lors de son procès, lut une déclaration à Messieurs les jurés, non « pour [sa] défense » mais pour exposer [son] acte ». En voici un extrait :
Après avoir évoqué « le si grand nombre de personnes qui souffrent de faim et de froid et voient souffrir leurs enfants » opposés à la richesse qu’il constate, il poursuit :
« Tandis que d’autre part je voyais des milliers et des milliers de personnes ne faisant rien et ne produisant rien, vivre du travail des ouvriers et dépenser tous les jours des milliers de francs pour leurs amusements et leurs plaisirs, déflorer les jeunes filles du pauvre peuple, posséder des palais de 40 et 50 chambres, 20 ou 30 chevaux, et de nombreux domestiques, en un mot, tous les plaisirs de la vie. Combien, hélas ! je souffrais en voyant cette vile société si mal organisée ! […] ». 398 Il sera guillotiné le 13 jours plus tard. (Cf. Femmes. Jeunes filles, Politique. Anarchisme)
« Droit de cuissage » (Charrière Isabelle de) : 1784. Isabelle de Charrière [1740-1805], dans les Lettres Neuchâteloises, traite du « droit de cuissage », bien que, come tant d’autres, l’expression ne soit pas prononcée :
« Quant à Julianne …, la cousette, elle a son mot à dire sur patrons et gens bien. Si elle n’est plus intacte, elle le doit à son premier maître qui a abusé d’elle. Si elle est dans le dénuement, c’est que ses employeuses l’ont chassée en la traitant de coureuse. » 399
« Droit de cuissage » (Chaunu Pierre) : 1982. L’historien Pierre Chaunu [1923-2009], présente un gentleman farmer, célibataire, un hobereau exploitant ses terres, entre Valogne et Cerbour, Gilles de Gouberville qui laissa un journal quotidien et qui fut l’objet par lui d’un travail historique de recherches, présenté sur France Culture en 1982.
Interrogé par Jean Montalbetti (dont la question n’est pas reprise) il s’explique en la matière :
- Réponse : « Là, il faut bien le noter, nous sommes avant la réforme catholique. Naturellement, la réforme catholique ne va pas modifier totalement et fondamentalement les mœurs et les comportements… Parce que ça… bon… l’attirance de l’être humain pour l’autre sexe fait partie de notre nature biologique et avant même… fait partie de notre nature sociale.
Mais il est inconstatable que… devant ces problèmes… Encore que, encore que… je vous fais remarquer justement qu’entre la verdeur et la pudeur du bocage, je choisis la pudeur du bocage. Car je vous fais remarquer que Gouberville parle de ces choses, de ces accrocs avec beaucoup de pudeur.
- Réaction. Mais en même temps, il y a des scènes de débauche, en compagnie de Simonet.
- Réponse : Oui, non, mais, écoutez, il le note, il le note d’une phrase et en caractère grec… Oui, il est allé foutre, etc., selon l’expression. Oui, l’expression est très verte, qu’est-ce que vous voulez, mais il dit bien ce qu’il a fait. Il est mort à 57 ans et demi et, mon dieu, bien qu’il n’ait pas été marié, ce malheureux Gouberville, n’a pas vécu comme un moine idéal du Désert de la Thébaïde.
Question / constat : Il exerce aussi un droit de cuissage sur les paysannes de son village…
Réponse : Un silence… Écoutez, modérément…. Autant qu’on puisse le savoir, modérément…Et vraisemblablement avec … Non, écoutez, ce n’est pas un droit de cuissage généralisé. Disons, qu’il a eu quelques amours ancillaires.
C’est quand même pas ... Vous avez noté qu’il ne frappe pas les femmes. De toutes façons, Gouberville n’est pas un faune déchaîné … Les quelques scènes dans les fossés, c’est pas lui qui est directement en cause. Bon, écoutez, il a le comportement d’un homme de son temps, et d’un homme - vous me permettrez l’expression, je le mettrais avec des gros guillemets - mais enfin c’est un homme normal. C’est quelqu’un qui a une nature, qui n’est peut-être pas volcanique, mais enfin, bon, c’est un mâle. Enfin, c’est un homme. D’autre part, Il ne se contrôle pas toujours. Il reconnaît qu’il a eu des accrocs. Enfin, il laisse passer ces accrocs… Mais, justement, nous sommes en 1450…1560. C’est vraisemblablement le fait majeur, le fait presque troublant, le fait presque hallucinant de la réforme catholique. C’est finalement le fantastique effort qui a été fait - entre en gros en 1580, 1590 et 1670, 1680 - pour contrôler les pulsions sexuelles. Et vous avez alors là vu chuter d’une manière très considérable, les naissances illégitimes. Mais là, nous sommes avant. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois que c’est considéré comme une chose bien, remarquable. On n’en est pas très fier. Mais, ça existe et on n’en fait pas un drame. Par conséquent, voilà la situation où est Gouberville. » 400 (Cf. Hommes. « Gentleman », Histoire. Historiographie. Patriarcale. Chaunu Pierre)
« Droit de cuissage » (Colet Louise) : 1853-1856. Louise Colet [1810-1876], auteure de :
« Nous sommes un débris de l’antique esclavage / l’Homme a toujours gardé sur nous le droit d’outrage / De joug qu’il nous impose, il se fait l’insulteur / Comme il traitait l’esclave avant le rédempteur. » 401 (Cf. Êtres humains, Femmes. Écrivaines. Colet Louise, Relations entre êtres humains. Amour. Flaubert Gustave)
« Droit de cuissage » (Comminges Comte de) : 1933. Le comte Marie-Bernard-Elie de Comminges [1831-1894] écrit ses Souvenirs d’enfance et de régiment. Il évoque, à Saint-Lary [Haute-Garonne, 700 habitants vers 1845], au milieu du XIXème siècle, la permanence de « l’exécrable ‘dîme’ », de « la non moins hideuse ‘corvée’ » et poursuit :
« À l’occasion des mariages [des ’paysans’, des ‘villageois’], la noce venait se promener dans le parc [du château] et l’épousée offrait un bouquet. Je ne sache pas que mon père ait jamais poussé l’amour des vieilles coutumes jusqu’à exiger d’autres droits du seigneur… »
- Plus loin, il évoque « les Caspers à Montbardon, une nichée de gentilshommes campagnards » :
« Cette maison était le royaume de la gauloiserie : un hôte de Montbardon rencontrant une jeune fille dans le vestibule, la trousse et lui maintenant les jupes au-dessus de la tête, la pousse à reculons dans le salon. Elle avait dix-huit ans. Il y avait bien de quoi tuer le farceur, n’est-ce pas ? On trouvait cela très drôle dans ces temps-là. La nuit, les hommes allaient percer la porte de ces dames et les seringuaient au moment où elles grimpaient dans leur lit, etc. C’était délicieux et très à la mode d’ailleurs dans tout le midi. » 402 (Cf. Histoire)
« Droit de cuissage » (Debré Robert) : 1974. Robert Debré [1882-1978] dans son « Livre. Témoignage », « L’honneur de vivre », évoquant l’évolution positive de la société française écrit, au terme de sa vie :
« J’ai le souvenir de domestiques de ferme qui couchaient à l’étable. Je ne parle pas des filles de ferme, bonnes à tout faire. » 403
« Droit de cuissage » (Defoe Daniel) : 1722. Daniel Defoe [1660-1731], dans Moll Flanders, auteur de :
« […] Toutefois, comme il me pressait de parler, je lui dis que je n’avais point de raison de douter de la sincérité de son amour pour moi, après tant de protestations, mais…
Et ici, je m’arrêtais et lui, comme si je lui laissais à deviner le reste.
‘Mais quoi, ma chérie ? dit-il ; je devine ce que vous voulez dire. Et si vous alliez devenir grosse ? ; n’est-ce pas cela ? Eh bien, alors, j’aurais soin de vous et de vous pourvoir, aussi bien que l’enfant ; et afin que vous puissiez voir que je ne plaisante pas, dit-il, voici quelque chose de sérieux pour vous’ et là-dessus il tire une bourse de soie avec cent guinées et me la donna ; et ‘je vous en donnerai une autre pareille, tous les ans jusqu’à ce que je vous épouse.’
Ma couleur monta et s’enfuit à la vue de la bourse, et tout ensemble au feu de sa proposition, si bien que je ne pus dire une parole et il s’en aperçut aisément ; de sorte, que glissant la bourse dans mon sein, je ne lui fis plus de résistance, mais lui laissai faire tout ce qui lui plaisait et aussi souvent qu’il lui plût ; et ainsi je scellai ma propre destruction, d’un coup ; car, de ce jour, étant abandonnée de ma vertu et de ma chasteté, il ne me restait plus rien de valeur pour me recommander ou la bénédiction de Dieu ou à l’assistance des hommes. » 404 (Cf. Enfants, Femmes. Achat. Enceintes. Valeur. Vertu, Langage. Verbe. Être, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Patriarcat. Hymen, Économie. Argent)
« Droit de cuissage » (Desanti Dominique) : 1984. Dominique Desanti [1914-2011], dans La femme au temps des années folles, auteure de :
« Se défendre ? Il le fallait dans le travail. En ces temps d’émancipation féminine, régisseurs, chefs costumiers, sous-directeurs (sic) tentaient de se faire payer ‘en nature’ le droit au travail. » 405
« Droit de cuissage » (Dolto Françoise) : 1985. Françoise Dolto [1908-1988], dans La cause des enfants, auteure de :
« Au XIXème siècle [...] nombre de garçons ont fait leurs premières armes sexuelles avec les servantes de la famille, et pas seulement dans les milieux bourgeois, mais aussi à la ferme. »
‘Armes sexuelles’ : ? 406 (Cf. Enfants, Femmes. Servantes, Hommes, Famille, Langage. Verbe. Faire, Politique. Guerre, Sexes […] »
« Droit de cuissage » (Dostoïevski Fiodor) : (15-25 septembre) 1865. Dans une lettre à Mikhail Nikiforovitch Katkov [1818-1885], Fiodor Dostoïevski [1821-1881], présentant une ébauche de Crime et châtiments [1866], évoque « le besoin de délivre la sœur [du protagoniste], demoiselle de compagnie chez des hobereaux, des assauts lubriques du chef de cette famille noble qui menace de la perdre […]. » 407
« Droit de cuissage » (Dulong Claude) : 1985. Claude Dulong [1922-2017], historienne, dans Anne d’Autriche, auteure de :
« S’il est vrai que l’on mariait les princes à quatorze ans ou plus tôt, on ne les obligeait pas à consommer tout suite leur mariage (sic) ; on laissait à leurs désirs le temps de s’éveiller et l’on chargeait (sic) quelque femme de chambre (sic) de leur initiation (sic). » 408
« Droit de cuissage » (Fielding Henry) : 1749. Henry Fielding [1707-1754], dans l’Histoire de Tom Jones, auteur de :
« Cet insuccès dans sa profession [l’armée] n’était pas uniquement dû au fait qu’il ne comptait pas d’amis parmi les gens au pouvoir. Il avait eu l’infortune de s’attirer le courroux de son colonel, qui conserva pendant de nombreuses années le commandement de ce régiment. Et il ne devait pas la malveillance implacable que lui portait cet homme à quelque négligence ou faute commise en tant qu’officier, ni même à aucune faute personnelle, mais bien uniquement à l’imprudence de sa femme qui était fort belle et qui, en dépit du très grand amour qu’elle portait à son mari, n’avait pas voulu payer son avancement de certaines faveurs que le colonel exigeait d’elle.
Le pauvre lieutenant était d’autant plus malheureux que, tout en ressentant les effets de l’hostilité de son colonel, il ne savait et ne soupçonnait pas même que celui-ci la lui portât. Il ne pouvait, en effet, imaginer une malveillance à laquelle il n’était pas conscient d’avoir offert de motif et sa femme par crainte de ce qu’aurait pu occasionner le souci scrupuleux de son mari quant à l’honneur, s’était contentée de conserver sa vertu sans jouir du triomphe de sa victoire ». Quelle merveilleuse intelligence… 409
« Droit de cuissage » (France. Révolution. 1789) : 1978. Dans un livre consacré à La Nuit du 4 août, son auteur cite, évoque et analyse les Cahiers des États généraux, rédigés par des représentants du Tiers État. Il écrit :
« On passerait à côté de l’essentiel toutefois si l’on ne voyait que ce désir d’égalité fiscale n’est qu’un aspect d’une évidente soif de justice et de dignité. Avec plus ou moins d’éloquence, les ‘pauvres habitants’ disent leur colère devant la liste interminable de vexations dont le sens ne leur apparait pas ou plus. »
Et à l’appui de ce constat, l’auteur reproduit l’un de ces Cahiers qui cite et dénonce « cette nuë de droits » qui accablent les « peuples » - dont le droit de « gambage ». Dans le lexique à ce terme, la définition qui en est donnée est : « Droit payé au seigneur par les brasseurs de bière ». Mais n’est-ce pas plutôt une autre formulation du droit de « jambage » ? 410 (Cf. Penser. Éloquence, Politique. Égalité. « Nuit du 4 août », Économie. « Pauvres Les »)
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Françoise Giroud :
« Droit de cuissage » (Giroud Françoise) (1) : 1990. Françoise Giroud [1916-2003], dans Leçons particulières, concernant le milieu du cinéma en France dans les années 30], auteure de :
« […] Techniciens et ouvriers de plateau mis à part, le milieu était infect. Pourri par le droit de cuissage. Les régisseurs traitaient les figurantes comme du cheptel, choisissant le matin celle qui passerait dans leur lit. Si elle refusait, la rebelle se trouvait sur une liste noire. Les metteurs en scène…Il y en avait de décents, bien sûr. Mais il y avait aussi celui auquel toutes les candidates à un rôle important devaient d’abord montrer ce qu’elles savaient faire dans une autre spécialité. Pendant qu’elles opéraient dans son bureau, il ne fermait même pas la porte, heureux que quelqu’un puisse les voir, là, à genoux, humiliées jusqu’à l’os. » 411 (Cf. Culture. Cinéma)
« Droit de cuissage » (Giroud Françoise) (2) : 2003. Françoise Giroud [1916-2003], dans Françoise Giroud. Une ambition française, interrogée par Christine Ockrent, décrit la même réalité :
« Dans les milieux du cinéma d’avant-guerre, on faisait comme on pouvait. Il fallait bien percer, passer d’un film à l’autre, obtenir un cachet… On était soumis au bon vouloir des producteurs, des directeurs de production… Vous n’imaginez pas les mœurs. À part les actrices, il n’y avait que des hommes, qui à tous les niveaux exerçaient leur droit de cuissage. On couche, on fait son chemin comme on peut, on serre les dents. » 412
-------------
« Droit de cuissage » (Goncourt Edmond de) : 1877. Edmond de Goncourt [1922-1896], dans La fille Élisa, auteur de :
« Les femmes, au milieu des quelles se trouvait Élisa étaient pour la plupart des bonnes de la campagne, séduites et renvoyées par leurs maîtres. » 413 (Cf. Proxénétisme. Femmes-dites-prostituées)
« Droit de cuissage » (Grossman Vassili) : 1960. Vassili Grossman [1905-1964], dans Vie et destin, auteur de :
« Il en avait entendu des histoires sur les infirmières, les téléphonistes, les petites filles sortant de l’école qui devenaient contre leur gré les maîtresses des commandants de régiments ou de divisons. » 414 (Cf. Enfants. Filles, Politique. Guerre)
« Droit de cuissage » (Guillaumin Émile) : 1905. Émile Guillaumin [1873-1951], dans La vie d’un simple, écrit concernant Fauconnet, « le fermier riche, conscient de sa puissance, envié de tous, respecté des marchands, salué bas par les travailleurs » :
« En dehors des foires et des tournées au chef- lieu, il allait dans ses domaines pour donner des ordres, combiner les ventes prochaines ou serrer de près quelque jeune métayère point trop farouche, qui, au maître, n’osait rien refuser… » 415
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Victor Hugo :
« Droit de cuissage » (Hugo Victor) (1) : 1832. Triboulet dans Le roi s’amuse de Victor Hugo [1802-1885] concernant Blanche, sa fille, violée par le roi :
« Oh, l’infâme. Elle aussi ! » [Acte III. Scène III]
« Droit de cuissage » (Hugo Victor) (2) : 1862. Victor Hugo [1802-1885] dans Les misérables, évoquant les étapes de la déchéance de Fantine, abandonnée, sans emploi, car mère, abandonnée par le père, d’une enfant, en recherche de logement, écrit :
« Le propriétaire auquel elle devait son loyer, lui avait dit : ‘Vous êtes jeune et jolie, vous pouvez payer’. » 416 (Cf. Proxénétisme. Hugo Victor)
« Droit de cuissage » (Hugo Victor) (3) : 1862. Victor Hugo [1802-1885] dans Les misérables, auteur de :
« (Concernant M. Gillenormand, resté « vert-galant », ce qu’il nommait « royale renommée »). Un jour, on apporta chez lui dans une bourriche, comme une cloyère d’huitres, un gros garçon nouveau-né, criant le diable et dûment emmitouflé de langes qu’une servante chassée six mois auparavant lui attribuait. M. Gillenormand avait alors ses parfaits quatre-vingt-quatre ans. Indignation et clameur dans l’entourage. Et à qui cette effrontée drôlesse espérait-elle faire accroire cela ?
« […] Ces choses-là n’ont rien que d’ordinaire. Et la Bible donc ! Sur ce, je déclare que ce petit n’est pas de moi. Qu’on en prenne soin. Ce n’est pas sa faute. » - Le procédé était débonnaire. La créature, celle-là qui se nommait Magnon, lui fit un deuxième envoi l’année d’après. C’était encore un garçon. Pour le coup, M. Gillenormand capitula. Il remit à la mère les deux mioches, s’engageant à payer pour leur entretien, quatre-vingt francs par mois, à la condition que leur mère ne recommencerait plus. Il ajouta : ’J’entends que la mère les traite bien. J’irai les voir de temps en temps.’ Ce qu’il fit. » (Cf. Enfants, Bâtards, Femmes. Créatures. Mères, Patriarcat. Pères, Violences à l’encontre des femmes. Hugo Victor)
« Droit de cuissage » (Hugo Victor) (4) : 1992. Lu dans un Dictionnaire des femmes célèbres, concernant Juliette Drouet, présentée ainsi « née Gauvain. Française. 1808-1883 » :
« Malgré ses infidélités ancillaires, le poète ne cessa jamais de l’aimer […]. » 417
Quel euphémisme patriarcal ! Lui, totalement déresponsabilisé. Quant à l’épouse…
-------------
« Droit de cuissage » (Interdiction de recherche de paternité) : 1977. Je lis dans le livre d’Yvonne Knibielher et de Catherine Fouquet, Histoire des mères du Moyen-Âge à nos jours, concernant l’article 340 du code civil Napoléonien - 1814 - :
« La recherche de paternité est interdite : « Cette disposition […] a surtout assuré l’impunité des fils de famille qui jetaient leur gourme avec une servante, ou celle des chefs d’atelier qui s’intéressaient aux jeunes ouvrières. » 418
- « Jeter sa gourme », « s’intéresser » … (Cf. Droit. Patriarcal, Femmes. Servantes, Justice. Impunité)
« Droit de cuissage » (Istrati Panaït) : 1929. Panaït Istrati [1884-1935], dans Vers l’autre flamme, concernant les bureaucrates soviétiques, auteur de :
« S’appuyant d’abord sur une minorité gouvernante avec laquelle le pouvoir partage le meilleur, puis sur une masse qui vient immédiatement après, prête à tout, pour assurer son pain, la bureaucratie fausse les écritures, dilapide la cause, viole la femme qui lui plait, exige des ouvrières un prélèvement de droits ‘en nature’, boit sec et se casse le cou. » 419 (Cf. Politique. Hiérarchie. État, Violences à l’encontre des femmes)
« Droit de cuissage » (Janin Jules) : (30 décembre) 1840. Astolphe de Custine [1790-1857], dans une lettre adressée à Karl-August Varnhagen [1785-1858], écrit :
« Janin [Jules. 1804-1874] est le pacha des coulisses et quand les demoiselles de théâtre ne le paient ni de leur argent ni de leur personne, il se croit offensé et les traite en sujets révoltés. » 420 (Cf. Hommes. « Porcs »)
Jules Janin, pendant 40 ans critique au Journal des Débats fut, pour reprendre Wikipédia, « du fait de son autorité, surnommé le ‘prince des critiques’ ». (Cf. Culture, Femmes. Artistes. Épouse de. Janin Adèle)
« Droit de cuissage » (Kapuściński Ryszard) : 2000. Ryszard Kapuściński [1932-2007], dans Ébène. Aventures africaines, concernant Samuel Doe [1951-1990. Président du Libéria de 1980 à 1990], auteur de :
« Il passe aussi beaucoup de temps dans la cour où les épouses de sa garde présidentielle préparent à manger sur des feux et font la lessive. Il leur fait la conversation, plaisante, de temps en temps en prend une dans son lit. ». 421
« Droit de cuissage » (Knobelspiess Roger) : 1960. Roger Knobelspiess [1947-2017], dans Voleur de poules. Une histoire d’enfant, évoquant ses souvenirs d’enfance en Normandie, dans les années 1960 :
« […] Le maire du village, gros propriétaire terrien employait Sandra dans ses champs. Il lui ordonnait d’aller l’attendre dans sa cabane de chasse pour lui remettre son salaire. Quand elle refusait qu’il profite d’elle, il ne voulait pas lui donner sa paye : ‘Le maire est vieux, il est mou et prend son temps. J’avais froid.’ Elle nous racontait ça et semblait contente de sa nouvelle vie à Elbeuf. [...] » 422
« Droit de cuissage » (La Châtre Maurice. Dictionnaire) : 1865. L’item Droit de cuissage du Nouveau dictionnaire Universel de Maurice La Châtre [1814-1900] se termine par :
« Et il n’y a pas trois cents ans que cette odieuse coutume a disparu complètement. » (p.1181)
« Droit de cuissage » (Lefèvre Frédéric) : 1988. Alice Sapritch [1916-1990], racontant sa vie évoque ses premiers jours à Paris, à 16 ans, écrit :
« [Après une rencontre sans suite, avec André Breton] J’ai rencontré alors Frédéric Lefevre [1889-1949], directeur des Nouvelles Littéraires. Il m’a convoquée un samedi, dans son bureau. Naïvement, j’ai accepté. Au bout d’une enfilade de couloirs, je me suis vue face à une espèce de gros porc, à demi dévêtu, qui me détaillait comme un maquignon et s’est jeté sur moi. Abominable ! J’ai pu me sauver sans consommer. Malgré tout, j’avais dû l’émouvoir » 423 conclue-telle, peu marquée par une analyse féministe, en 1986. (Cf. Femmes. Artistes)
« Droit de cuissage » (LIP) : (24 septembre) 2022. Monique Piton particulièrement engagée dans la lutte des LIP, féministe, radicale, subversive, se souvient de son embauche comme dactylo, à LIP à 36 ans en 1970 :
« Un chef se prévalait du droit de cuissage… à plusieurs reprises, là aussi, je refusais ses gestes et ses chuchotements pervers. Et un jour j’étais à bout et je lui ai enfoncé la corbeille à papier sur la tête. Le bureau était vitré donc tout était visible de l’atelier. J’ai entendu toutes les machines s’arrêter. J’ai couru chez le directeur des ressources humaines. J’étais bouleversé. ‘Calmez-vous, calmez-vous et dites-moi tout.’ »
Elle avait préalablement rappelé que, mineure, serveuse saisonnière, « l’horrible patronne » lui avait demandé « un certificat de virginité. ».
France Culture ose écrire que Monique Piton a été « révélée par Carole Roussopoulos [1945-2009] », ce qui est un mépris de la première, un déni de l’histoire, ainsi qu’une radicale trahison des engagements politiques, féministes de la seconde. 424 (Cf. Femmes. Remarquables. Roussopoulos Carole)
« Droit de cuissage » (Louis XIV) : 1829. Dans les Mémoires du duc de Saint-Simon, celui-ci [1675-1755] écrit :
« La reine eut des filles d’honneur et les filles d’honneur sont dans l’entière dépendance de la dame d’honneur. Le roi était jeune et galant ; tant qu’il n’en voulu point à la chambre des filles, Mme de Navailles [1625-1700] ne s’en mit pas en peine ; mais elle avait l’œil ouvert sur ce qui la regardait ; elle s’aperçut que le roi commençait à s’amuser, et bientôt après, elle apprit qu’on avait secrètement percé une porte dans leur chambre qui donnait sur un petit escalier par lequel le roi y montait la nuit, et que le jour cette porte était cachée par le dossier d’un lit. Elle tint sur cela conseil avec son mari : ils mirent la vertu et l’honneur d’un côté, la colère du roi, la disgrâce, le dépouillement, l’exil de l’autre ; ils ne balancèrent pas. Mme de Navailles prit si bien son temps, pendant le jeu et le souper de la reine que la porte fut exactement murée, et qu’il n’y parut point. »
La suite : le roi découvre que « la porte est devenue muraille », renvoie chez eux Mr et Mme de Navailles et les démets de leur charge [en 1664], lesquels sur demande de la mère du roi, avant son décès [1666], revinrent cependant à la cour. 425 (Cf. Hommes. « Galants »)
« Droit de cuissage » (Luther) : Luther [1483-1546], auteur de :
« […] « Le troisième cas de divorce est celui où l’un des conjoints, refusant de lui rendre le devoir conjugal et de rester auprès de lui, comme il arrive souvent lorsqu’on trouve une femme butée, qui s’entête et ne veut rien savoir, dût son mari tomber dix fois dans l’impureté. Dans ce cas, il est temps que le mari dise : ‘Si tu ne veux pas, une autre veut bien ; si la dame refuse, que vienne la servante’. Le mari doit auparavant l’admonester deux ou trois fois et l’avertir, et le faire savoir à d’autres, afin que l’entêtement de la femme soit connu publiquement et sanctionné par la communauté : si elle continue à refuser, répudie-là : laisse-toi donner une Esther et chasse la Vashi, comme le fit le roi Assuérus. »
Notons que le Concile de Trente [1545-1563] condamna les positions de Luther sur le mariage, tout en sanctionnant la légitimité de la séparation de corps, sans référence - sous réserves d’analyses plus compétentes - à l’évocation de la situation sus évoquée. (Cf. Femmes. Servantes, Famille. Mariage. Divorce, Violence des lois religieuses) 426
« Droit de cuissage » (Malet Léo) : 1956. Léo Malet [1909-1996], dans Corrida aux Champs-Élysées, auteur de :
« […] ‘Vous désirez faire du cinéma, dis-je […]
- Oui
- Et vous comptiez sur ce moyen…
- Oui.
- Il n’en existe pas d’autres ? Vous n’avez jamais entendu parler de talent, par exemple ? ‘
Bougre d’idiote. […] Vous ne pourriez pas abandonner ces idées à la noix et tâcher de vous construite une bonne petite vie facile au lieu de vous vendre à je ne sais combien de porcs, peut-être pour des haricots ?» (Lire la suite) 427 (Cf. Hommes. « Cochons »)
« Droit de cuissage » (Mann Thomas) : 1901. Thomas Mann [1875-1955], dans Les Buddenbrook, évoque longuement la découverte par madame Tony Permander des relations qu’entretient son mari avec la cuisinière Babette. Il est question de « paroles de résistance […] de lutte » ; il écrit aussi : « Elle avait essayé d’échapper et s’était défendue. »
J’ai relevé - après sa décision de retour définitif à la maison familiale et de divorcer - les arguments invoqués, en vain, par sa mère, puis son frère, le chef de famille, pour tenter de la dissuader de quitter sans retour cet « homme abject, abject ».
- « Je vois à présent qu’on t’a réellement fait du chagrin… que tu as des raisons de te plaindre. Mais était-ce nécessaire de manifester si violement tes griefs ? […] Puisque tu es ici, c’est bien. Tu pourras soulager ton cœur et me raconter tout ; ensuite nous verrons comment arranger les choses avec de l’indulgence, de la charité, et en pesant les torts. »
- « Permets-moi de prendre la chose un peu trop à la légère, puisque toi tu la prends un peu trop à cœur, et tu verras que nous nous complétons avantageusement. […] Ne jouons pas à la tragédie. […] C’est une sottise, mon enfant. […] Permander a eu une conduite très répréhensible, il faut l’avouer, et je me charge de le lui faire savoir, sois-en persuadée. […] À tout prendre, on ne peut pas d’ailleurs, lui refuser les circonstances atténuantes. Un ami célébrait sa fête, il rentre à la maison très animé, un peu trop gai, et il se laisse aller à un petit écart inconvenant. […] Tu as surpris ton mari dans un moment de faiblesse, tu l’as vu un peu ridicule … cela ne devrait pas t’indigner si fort, mais plutôt t’amuser un peu et te rapprocher humainement de lui. […] Tu ne pouvais pas, naturellement approuver sa conduite par un sourire et le silence. Dieu m’en préserve. Tu es partie : c’était une manifestation un peu vive, peut-être, une punition trop sévère, je ne voudrais pas la voir en ce moment, triste et seul, chez lui ; mais malgré tout, c’était justice. Je te prie seulement d’envisager les choses avec un peu moins d’indignation et un peu plus de diplomatie. Nous parlons entre nous. Il faut que je te dise quelque chose ; dans un mariage, il n’est pas indifférent de savoir de quel côté on se trouve… se trouve la supériorité morale… Tu me comprends Tony ? Ton mari t’a donnée prise sur lui, il n’y a aucun doute là-dessus. Il s’est compromis, s’est rendu un peu ridicule… justement parce que sa faute est innocente, si peu grave au fond… bref, sa dignité n’est plus sacrée, tu as de ton côté une certaine supériorité et suppose que tu saches t’en servir avec adresse, ton bonheur est assuré… […] Tony, tu ne vas pas faire un scandale ! […] Tu n’es qu’une enfant, Tony. […] Toutes tes paroles sont de l’enfantillage. Ne veux-tu pas, si je t’en prie, daigner considérer un instant, les choses comme une personne adulte ? Ne t’aperçois-tu donc pas que tu agis comme si tu avais éprouvé quelque chose de grave et de pénible, si ton mari t’avait cruellement trompée, t’avais accablée d’outrages en public ? Réfléchis donc un peu qu’il n’y a rien eu. […] Retourne chez Permender en toute tranquillité, tout au plus d’un air moqueur… Tu ne nuiras en rien à ta dignité et à la nôtre, au contraire ! Ce qui y nuira, ce sera de ne pas le faire, de transformer en scandale, cette bagatelle. » 428
« Droit de cuissage » (Marat) : Marat [1743-1793], auteur de :
« [Les princes] doivent à leurs peuples l’exemple des bonnes mœurs et des vertus ; ne sont-ils pas inexcusables lorsqu’ils ne donnent que celui des vices, lorsqu’ils s’abandonnent aux voluptés les plus honteuses, et qu’ils sont les premiers à débaucher les femmes, à débaucher leurs sujets ? » 429 (Cf. Politique. Démocratie, Histoire. Révolution française)
N.B. Écrit entre 1770 et 1772, publié en 1848.
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Màrai Sándor :
« Droit de cuissage » (Màrai Sándor) (1) : 1934. (traduction française. 1993) Sándor Màrai [1900-1989], dans Les confessions d’un bourgeois, auteur de :
« À dire vrai, bien des familles bourgeoises comptaient sur leur jeune bonne qui devait se tenir ‘à disposition’ pour aider leurs grands fils à traverser la période difficile de la puberté. J’ai souvent entendu ces bourgeois exprimer leur satisfaction d’avoir trouvé une jeune bonne pour leur gamin adolescent. Tout compte fait, c’était bien plus ‘hygiénique’ que de recourir comme le font la plupart des garçons torturé par leur nature, à des ‘créatures’. Si la bonne venait à tomber enceinte ‘des œuvres’ du jeune godelureau, le grand-père se substituait alors au fils-père pour verser, avec un sourire à la fois satisfait et espiègle, une pension mensuelle de deux à trois forints. Tel était l’ordre des choses. » 430
« Droit de cuissage » (Màrai Sándor) (2) : 2006. Sándor Màrai [1900-1989], dans Métamorphoses d’un mariage, auteur de :
« À cette époque d’ailleurs, il [« le vieux Monsieur »] n’était pas si vieux que ça. Quand je l’aidais à endosser son pardessus dans l’entrée sombre, il me pinçait quelques fois les fesses ou il me tirait les oreilles… Il me faisait aussi comprendre que je ne lui déplaisais pas et que, s’il n’allait pas plus loin, c’était parce que sa dignité l’empêchait de trousser une servante. En fait, je n’étais pas vraiment de son avis. S’il avait insisté, j’aurais sans doute obéi… sans plaisir et sans entrain, remarque, uniquement parce qu’il me semblait que je n’avais pas le droit de contrarier un personnage aussi puissant. D’ailleurs, il aurait été lui-même fort surpris de me voir réticente. » 431
-------------
« Droit de cuissage » (Marmontel Jean-François) : 2002. Je lis dans une note de La Pléiade des Nouvelles du XVIIIème siècle concernant Jean-François Marmontel [1723-1799] :
« Le monde évoqué dans ces contes [Contes moraux] est celui que Marmontel a connu avant la révolution et il leur donne une apparence historique (sic) en faisant intervenir des personnages qu’il avait fréquenté lui-même et dont les noms étaient familiers eux lecteurs […] Ni l’existence de la noblesse ni même de ses privilèges ne sont contesté dans Il le fallait [1792], mais l’honneur d’un aristocrate, s’il peut encore se défendre par un duels, n’autorise pas à déshonorer une villageoise, au contraire il l’oblige à l’épouser, sans crainte de déroger (on remarquera cependant que c’est le curé qui suggère à D’Orcily l’idée du mariage). » Et ce, concernant deux autres nouvelles publiées dans ce livre, suivi de :
« En 1713, dans la première nouvelle des Illustres françaises de Challe [Robert. 1659-1721], le vieux Dupuis n’hésitait pas à faire décréter de prise de corps une jeune fille que DesRonais avait rendu mère pour pouvoir lui-même marier sa propre fille à DesRonais ; et, en 1784, Isabelle de Charrière [1740-1805], dans son premier roman Lettres neuchâteloises, montrait une jeune fille, Marianne de La Prise, qui amoureuse d’Henri Meyer et désireuse de devenir sa femme, l’aidait à envoyer accoucher à l’étranger une employée couturière enceinte de ses ouvres (sic) et qu’il n’avait nulle envie d’épouser. Ni Challe ni Isabelle de Charrière n’étaient des esprits étroits, mais lui était d’une autre époque et elle d’un autre milieu que Marmontel. » 432 (Cf. Histoire)
« Droit de cuissage » (Marx Karl et Engels Friedrich) : 1848. Karl Marx [1818-1883] et Friedrich Engels [1820-1895], dans le Manifeste du parti communiste, auteurs de :
« Nos bourgeois, non contents d’avoir à leur disposition les femmes et les filles de leurs prolétaires, sans parler de la prostitution officielle, trouvent un plaisir singulier de se cocufier mutuellement. » 433
- Marx, seul, écrivait en septembre 1847 :
« Tout comme alors [dans l’État romain], nos sœurs et nos filles doivent servir à assouvir les passions bestiales de riches débauchés. » 434
Ces citations ne doivent pas faire oublier que Marx a eu un enfant avec Hélène Demuth [1820-1890] et qu’il a demandé à Engels d’en être ‘le père’. (Cf. Femmes. Remarquables. Demuth Hélène, Hommes. Remarquables. Engels Friedrich, Famille)
* Ajout. 5 mai 2021. Daniel Guérin [1904-1988], dans une Postface à son livre l’Anarchie, après étude des Procès-verbaux des séances du Conseil général de la Première internationale, dans un texte intitulé Marx et Engels militants, auteur, concernant ce dernier, de :
« Il fait preuve d’un goût inné pour les basses besognes. » 435 (Cf. Patriarcat. Pères)
* Ajout. 10 juin 2023. Pierre Larousse [1817-1875] dans son Grand dictionnaire du XIXème siècle [1873], auteur de :
« M. Marx qui, dans le silence du cabinet et dans ses écrits, ne recule devant aucune conséquence de ses écrits, est dans la vie privée, un homme paisible, honnête, doux, rangé, un vrai type du bourgeois allemand. » 436
« Droit de cuissage ». Jules Michelet :
« Droit de cuissage » (Michelet Jules) (1) : 1853. Lu dans L’Histoire de la révolution française de Jules Michelet [1798-1874] :
« Comment serai-je juste envers la Révolution, comment la ferai-je comprendre, si préalablement je ne fais connaître le Moyen-Âge, cette terreur de mille ans ! » … [Puis, en note] :
« Le servage, qu’on le sache bien, est un communisme effroyable, le viol en habitude, en droit. La famille y est impossible. Le serf blanc est plus malheureux en ceci que l’esclave nègre. Celui-ci distingue très bien à la peau les enfants qui sont du maître. En Russie et autres pays semblables, nul signe qui accuse la différence : le père infortuné ne sait jamais qui sont les siens. Un ministre protestant m’a assuré avoir vu, vers 1800, sur la cote allemande de la Baltique, une jeune fille enchaînée par une chaine de fer dans une loge à chien, pour n’avoir pas voulu payer le droit du seigneur à l’intendant qui régissait la terre – Nos seigneurs français du dix-huitième siècle usaient plus largement de ces privilèges que ne firent jamais leurs aïeux ; leur fils, par libertinage ou par insolence, couraient tout le village, et qui n’eut pas fermé les yeux aurait été persécuté. L’homme d’affaires aussi, alors comme aujourd’hui, mettait souvent aux délais qu’il accordait pour payements de honteuses conditions, etc., etc. La femme payait tout. Elle eût dû être, en vérité, plus révolutionnaire que l’homme. » 437
Analyses ouvrant la voie à de nombreux commentaires critiques. (Cf. Corps. Peau, Êtres humains. Serfs-Serves, Hommes. « Libertins », Patriarcat. Servage, Histoire)
« Droit de cuissage » (Michelet Jules) (2) : 1853. Jules Michelet [1798-1874] dans l’Histoire de la Révolution française, auteur de :
« Le marchand de Lyon, républicain de principes, n’en était pas moins le maître, le tyran de l’ouvrier et, qui pis est, le maître de sa femme et de sa fille. Notez que le travail, à Lyon, se faisant en famille, la famille y est très forte ; ce n’était nullement un lien détendu, flottant, comme dans les villes de manufactures. L’ouvrier lyonnais est très sensible, très vulnérable en sa famille et c’est justement là qu’il est blessé.
La prostitution non publique mais infligée à la famille comme condition de travail, c’était le caractère déplorable de la vie lyonnaise. » 438 (Cf. Hommes, Femmes, Enfants, Famille)
-------------
« Droit de cuissage » (Mines) : (27 mars) 2023. Entendu sur France Culture, dans l’émission Les mines, une histoire du paternalisme :
« Les gardes, c’était donnant-donnant… avec les femmes ». (Cf. Économie)
« Droit de cuissage » (Montaigne) : 1580. Montaigne [1533-1592] dans Les essais, Livre I. Chapitre 23, évoquant le relativité de « la raison humaine » et des « opinons et des mœurs » écrit :
« […] Et ailleurs, si c’est un marchand qui se marie, tous les marchands conviés à la noce couchent avant lui ; et plus il y en a, plus elle a d’honneur et de recommandation de fermeté et de capacité ; si un officier se marie, il en va de même ; de même, si c’est un noble, et ainsi des autres, sauf si c’est quelqu’un du bas peuple ; alors c’est au seigneur de la faire. […] » Et Montaigne évoque plus loin : « les femmes qui n’osent épouser, qu’elles n’aient offert à leur roi s‘il veut de leur pucelage. » 439
« Droit de cuissage » (Mugnier Abbé) : (13 octobre) 1919. L’abbé Mugnier [1853-1954] écrit dans son Journal :
« Visite de Melle Marquet [Mary. 1895-1979]. Elle m’a dit son amour pour Rostand [Edmond. 1868-1918] et ce qu’il avait été pour elle pendant près de trois ans. […] Melle Marquet m’a dit l’horreur du monde des théâtres, ce par quoi il fallait passer pour arriver à jouer un rôle. » 440 (Cf. Femmes. Artistes)
« Droit de cuissage » (Perrault Gilles) : 1990. Gilles Perrault [1931-2023], dans Notre ami le roi, auteur de :
- « Le jeune Sultan Sidi Mohammed [futur Mohammed V. 1909-1961] s’ennuie dans son palais. […] Les femmes sont sa distraction. Conformément à la tradition alaouite, il fait aux tribus l’honneur d’accueillir les plus belles filles dans son lit. »
- « Les femmes occupent beaucoup le roi [Hassan II. 1929-1999] qui est avec elles Kennedy et Louis XI. Kennedy, dans la mesure où il fit abondante et rapide consommation de starlettes, petites chanteuses, professionnelles de haut vol expédiées d’Europe par les maquerelles spécialisées dans les plaisirs des grands. Louis XV, car, pour chaque courtisan, glisser sa femme dans le lit royal fait avancer de plusieurs cases dans la faveur du souverain. Comme à Versailles, toute femme honorée par le roi, fût-ce furtivement au coin d’un couloir, publie sa bonne fortune pour la capitaliser en crédit et en influence : quel ministre refusera ce passe-droit à un courtisan dont la femme a servi au plaisir du roi. […]
Puis il évoque « le harem ». Et ensuite :
- « Un jour qu’il est allé chasser dans le Moyen Atlas, le roi remarque la beauté d’une fille de notable, près du village de Mrirt. Elle est mariée, mère de deux enfants. Une voiture vient la chercher le lendemain avec ses enfants. Un ordre du roi ne se discute pas. Le malheureux mari tentera vainement à récupérer au moins sa progéniture. Pour lui aussi, d’une heure à l’autre, c’était comme si sa famille avait disparu de la surface de la terre. » 441 (Cf. Êtres humains. Courtisans, Famille. Polygamie. Monarchie Marocaine)
« Droit de cuissage » (Pétain Philippe) : 1940-1944. Lu, concernant Philippe Pétain [1856-1951] :
« Il passait son temps à séduire toutes les femmes qui s’approchaient de lui. Toutes les serveuses de l’hôtel, à Vichy, sont passées par son lit. » Vrai ? 442
* Ajout. 19 avril 2021. Philippe de Gaulle [1921-2024], dans De Gaulle, mon père [1890-1970,] décrit Philippe Pétain [1856-1951], dans sa vieillesse, en reprenant entre guillemets les formulations de son père « victime de sa vanité, comme ‘un vieux Don Juan [Il avait eu même tardivement beaucoup de succès auprès des femmes] et qui continue à croire qu’il est irrésistible.’ » 443 (Cf. Hommes. Âgés, Famille, Relations entre êtres humains. Vanité)
N.B. « Avoir beaucoup de succès auprès des femmes » : aujourd’hui, la traduction est aisée.
* Ajout. 11 juillet 2022. Bénédicte Vergez-Chaignon, biographe de Philippe Pétain [1856-1951], auteure de :
« Il multiplie les maîtresses et fréquente assidûment les maisons closes », puis elle évoque « une vie sexuelle intense et variée », et précise enfin :
« Cela perdure, décennies après décennies ». (Cf. Famille. Pétain Philippe, Politique, Proxénétisme)
N.B. Après Me-Too, il n’aurait pas ‘tenu’ longtemps, et la face de la France en eu été changée… 444
* Ajout. 5 novembre 2022. 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, auteur de :
« Le vainqueur de Verdun approchait des quatre-vingt-dix ans mais il était resté un vert-galant, le bruit courait qu’à l’hôtel du Parc, il recevait encore des dames émoustillantes. On colportait avec admiration qu’il était un vieux fripon. » 445 (Cf. Hommes. « Galants »)
« Droit de cuissage » (Phoolan Devi) : 1996. Phoolan Devi, concernant l’Inde, auteure de :
« Lorsqu’ils [les propriétaires terriens] avaient envie d’une femme d’une basse caste, ils disaient : ‘Telle femme, elle me plait’ et ils étaient obligés d’envoyer la femme. »
Eh, oui, c’est aussi simple que cela : combien a-t-il fallu de dénis, de contournements, d’occultations, de détournement des yeux et des pensées, de théories, de pressions, de mensonges, pendant si longtemps, pour occulter cette évidence ?
Ils prennent les femmes comme ils prennent les terres. Souvent en sus… 446 (Cf. Femmes. Remarquables. Phoolan Devi, Histoire)
« Droit de cuissage » (« Prime de mariage ») : 1960. Lu dans un livre publié par les Éditions sociales concernant une entreprise employant des femmes de la région de Millau dans les années 1960 :
« Il y a aussi dans telle usine un prime de mariage de 5.000 francs. C’est mieux que rien. Mais il faut aller la demander au patron. Pour qu’on sache que ce n’est pas un droit, mais une royale faveur. Rien de plus : venir la chercher. Au grand maximum, une caresse bon papa sur les cheveux. Mais parfois on préfère ne pas s’y abaisser - ‘C’est un reste du droit de cuissage ! Un petit reste, mais tout de même… » 447
« Droit de cuissage » (Proust Marcel) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, évoque « ce que la pédante Mme Bloch appelait [les] découchages en cuisine de M. Nissim Bernard [qui] étaient les vraies raisons de son retour annuel à Balbec. » 448
« Droit de cuissage » (Renard Jules) : (4 août) 1908. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« À douze ans, Augustine gagnait 40 frs par an, dans une ferme. Une place dont une fille sort ‘embarrassée, dit-elle, c’est-à-dire enceinte. » 449 (Cf. Enfants)
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Samuel Richardson :
« Droit de cuissage » (Richardson Samuel) (1) : 1740. 4ème de couverture du Pamela de Samuel Richardson [1689-1761] :
« À la mort de sa maîtresse, Paméla, jeune domestique d’une grande beauté, doit subir et repousser les assauts de son nouveau maître, M.B …, pris d’une violente passion pour elle. Farouchement décidée à conserver sa vertu, la jeune fille va user de tous les subterfuges pour échapper aux séductions, menaces et manigances de M.B, et le conduire à une extrémité inattendue. »
Confronté à ses refus, j’ai relevé, dans le livre, les qualificatifs, les termes que ledit « maître» employa à son encontre : « petite sotte », « petite salope », « petite artificieuse », « vanité, suffisance, orgueil », « petite sotte », « fine matoise », « insolente », « effrontée », « arrogante », « insolente », « jolie petite folle », « pareille sotte », « babillarde et mal avisée », « effrontée », « impertinente », « perverse », « hypocrite », « sorcière », « paresseuse », « souillon », « sorcière », « petite infâme », « hypocrite », « misérable », « sorcière », « impertinente », « folle », « voleuse », « ingrate », « impertinente », « ingrate », « insolente », « méchante fille », « ingrate », « impertinente », « orgueilleuse », « fière », « impertinente »… 450 (Cf. Relations entre êtres humains. Injures. Injures à l’encontre des femmes)
« Droit de cuissage » (Richardson Samuel) (2) : (16 septembre) 1762. Denis Diderot [1713-1784] écrit à Sophie Volland [1716-1784] :
« Combien petitement vous voyez le sujet de Paméla ! Cela fait pitié ! Non. Mademoiselle, non. Ce n’est pas l’histoire d’une femme de chambre tracassée par un jeune libertin. C’est le combat de la vertu, de la religion, de l’honnêteté, de la vérité, de la bonté, sans force, sans appui, avilie, s’il est possible qu’elle le soit, dans toutes les circonstances imaginables, par la dépendance, l’abjection, la pauvreté, contre la grandeur, l’opulence, le vide et toutes ses puissances infernales. »
Denis Diderot, à lui seul, par cette seule analyse, par cet engagement, fait - devrai faire - honte, plus spécifiquement, à tous les hommes qui ont passé sous silence, justifié, légitimé les violences patriarcales. 451 (Cf. Hommes. Féminisme. « Libertins », Violences. Patriarcales)
* Ajout. 5 décembre 2021. Réaction excessive suite à cette si heureuse découverte ? Mais que veut dire : « excessif » ?
« Droit de cuissage » (Richardson Samuel) (3) : (29 mai) 1769. Voltaire [1694-1778] dans une lettre à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772], écrit :
« Dans les six tomes de Paméla [1740. Samuel Richardson. 1689-1761] il n’y a rien. Ce n’est qu’une petite fille qui ne veut pas coucher avec son maître à moins qu’il ne l’épouse. » 452
-------------
« Droit de cuissage » (Roi de Naples et de Sicile) : 1792. Après un portait élogieux de la reine de Naples [Marie-Caroline [1752-1840], sœur de Marie-Antoinette et « meilleur[e] ennemi[e] » de Napoléon [1769-1821], Élisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842] écrit dans ses Souvenirs :
« La reine de Naples avait un grand caractère et beaucoup d’esprit. Elle seule portait tout le fardeau du Gouvernement. Le roi [Ferdinando. 1751-1825] ne voulait point régner ; il restait presque toujours à Caserte, occupé de manufactures [de soie], dont les ouvrières, disait-on, lui composait un sérail. » 453
« Droit de cuissage » (Rousseau Jean-Jacques) : 1762. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] dans L’Émile, auteur de :
« Un célèbre auteur de ce siècle [L’abbé de Saint-Pierre. 1658-1743] dont les livres sont plein de grands projets et de petites vues, avait fait vœu, comme tous les prêtres de sa communion, de n’avoir point de femme en propre ; mais se trouvant plus scrupuleux que les autres sur l’adultère, on dit qu’il prit le parti d’avoir de jolies servantes, avec lesquelles il réparait de son mieux l’outrage qu’il avait fait à son espèce par ce téméraire engagement. Il regardait comme un devoir du citoyen d’en donner d’autres à la patrie, et du tribut qu’il lui en payait en ce genre il peuplait la classe des artisans. […] » 454 (Cf. Enfants. « Bâtards », Femmes. Servantes)
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Russie :
« Droit de cuissage » (Russie) (1) : (28 mai) 1928. Lu dans le Journal de Russie. 1928-1929, de Pierre Pascal [1890-1983] :
« Le Troud [journal des syndicats], ces jours-ci, fourmille de scandales. À Smolensk ce sont des choses à peine croyables : on renvoie des ouvriers pour refuser de payer à boire au contremaître, des ouvrières pour refuser de coucher avec lui, les fonctionnaires syndicaux ou bien ignorent les faits, ou bien agissent de même. Quand ces ouvriers signalent un abus, on les menace. […] Le syndicat reste muet. Et cela dans toutes les branches, dans toute la province. […] ». 455
« Droit de cuissage » (Russie) (2) : (24 août) 1929. Lu dans le Journal de Russie. 1928-1929, de Pierre Pascal [1890-1983] :
« Le procureur Pavlov qu’on vient de juger et de condamner à 7 ans de prison pour avoir favorisé des ci-devant femmes en se faisant payer en nature (en plein bureau, porte à peine poussée), était un ouvrier ‘sorti du rang’. » 456
-------------
« Droit de cuissage » (Sartre Jean-Paul) : 1944. Évoquant une pièce de Lope de Vega [1562-1635], Sartre [1905-1980], dans Situations II, écrit :
« Il n’est pas jusqu’au seigneur des Amants de Galice [autre intitulé : Le meilleur alcade est le roi] qui, jusque dans ses violences, ne soit assuré d’avoir raison : la femme qu’il a enlevée n’est-elle pas une villageoise vivant sur ‘ses’ terres ? N’exerce-t-il pas, en la violant, son droit seigneurial ? » 457
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Sicile :
« Droit de cuissage » (Sicile) (1) : [19]50. Danilo Dolci [1924-1997], dans son Enquête à Palerme, rapporte le récit d’un interlocuteur anonyme :
« Il y a une autre coutume qui tend à disparaître : dans de nobles familles, on prend des enfants pour en faire de valets de pied. On leur met une livrée rayée les jours de visite ou de fête. L’enfant grandit sans toucher de salaire, il devient une sorte d’objet de famille qui se transmet de père en fils, comme les meubles et autres biens. Ces gens-là se donnent l’air d’agir en bienfaiteurs, ou en dames de charité. Souvent ces garçonnets deviennent pédérastes ou service de leurs maîtres dégénérés.
Puis, il y a les ‘femmes de chambre à dot’, des fillettes pauvres qu’on élève dans la famille noble à la place du petit garçon dont j’ai parlé. Dès qu’elle est pubère, le maître en profite, la fait avorter ou envoie l’enfant à l’Assistance publique. Puis il force un des régisseurs de ses domaines à l’épouser et lui donne en guise de dot une vache ou un lambeau de terre. Un tel seigneur est considéré comme un bienfaiteur ; mais le mari de l’ancienne femme de chambre se met souvent à boire, prétend que sa femme est une prostituée car de toute façon aux yeux de monde il est cocu. Le maître c’est le bienfaiteur ; lui, c’est le cocu. » 458 (Cf. Êtres humains, Enfants, Femmes, Hommes. « Cocus », Relations entre êtres humains. Valets, Famille. Mariage. Dot, Économie. « Pauvres Les »)
« Droit de cuissage » (Sicile) (2) : [19]50. Danilo Dolci [1924-1997], dans son Enquête à Palerme, rapporte le récit d’un journalier Sicilien :
« Dans notre province, pour glaner, des gens viennent de Modica [sur la côte sud, alors que l’interviewé évoque la situation prévalant au nord-ouest]. Ils arrivent par petits groupes et les surveillants de la ferme à condition que les hommes leur donnent un coup de main (sic), laissent les femmes et les enfants ramasser les épis tombés. Les glaneurs arrivent par familles entières, couchent à la belle étoile et parfois même acceptent que les intendants profitent de leurs femmes.
Dans l’industrie, pour être embauchés, les ouvriers doivent signer une traite de vingt à trente mille lires au profit de l’agent d’embauche et ceci pour travailler quelques mois, au maximum six mois. Les agents leur prennent leur argent et parfois même les cocufient. » 459
-------------
« Droit de cuissage » (Simenon Georges) : 1961. Georges Simenon [1903-1989], dans ses Mémoires intimes, auteur de :
« Un matin, je trouve Teresa, la « femme de chambre ‘personnelle’» de son épouse, seule, penchée sur la coiffeuse du boudoir, un vif désir d’elle me saisit et je le trousse, sans qu’elle bouge ou proteste. Jamais de ma vie, je l’affirme, je n’ai forcé une femme, d’une façon ou d’une autre à accepter mes avances. Je n’ai pas non plus pratiqué ce que les grands bourgeois appellent dédaigneusement ‘les amours ancillaires’ auxquels ils se livrent d’ailleurs les premiers en s’arrogeant ce que les grands seigneurs de jadis appellent ‘le droit de cuissage’.
Pour moi, une femme et une femme, digne de respect, quelles que soit ses fonctions et ce qu’on appelle d’un mot que je déteste, ‘sa situation sociale’.
J’ignorais le catéchisme que D. (son épouse) avait dû enseigner à la nouvelle venue. Elle m’a entendu entrer, m’approcher, sent ma main sur ses hanches et ne réagit pas quand je relève sa robe. J’en garde le souvenir dans ses moindres détails. À peine l’ai-je pénétrée que je sens sa jouissance et, la mienne proche, je me retire à temps.
La pilule existait-t-elle déjà ? Je n’en sais rien et, l’aurais-je su, j’ignorais si elle l’avait prise.
Elle me regarde ensuite d’un regard sans expression et je sors de la pièce, à la fois confus et heureux.
Le soir même, après le ‘rapport’, Teresa s’attardera pour mettre D., fort honnêtement, au courant de ce qui s’est passé. ‘Je suis prête à partir dès maintenant si vous le désirez.’ D. rit : ‘Sachez, ma fille, que si j’étais jalouse de ‘Monsieur’, il y a longtemps que je ne vivrais plus avec lui.’ - ‘Et s’il recommence ?‘ - ‘Si cela ne vous gêne pas… Quant à moi, cela ne me regarde pas et vous pouvez continuer si cela vous amuse’. Marie-Jo (leur fille) est entrée et D. la met au courant. » 460
« Droit de cuissage » (Sinclair Anne) : 1997. Anne Sinclair, auteure de :
« Quant au fameux cliché qui veut que les femmes doivent coucher avec un rédacteur en chef pour avoir une émission, ça existe bien sûr, mais ce droit de cuissage est moins fréquent que dans l’entreprise et surtout, ça ne dure pas longtemps, si l’émission ne marche pas, on te renvoie… » 461
Le journalisme qui sait aller à l’essentiel…
« Droit de cuissage » (Stendhal) : 1811. Stendhal [1783-1842], dans Histoire d’une partie de ma vie, auteur de :
« Son mari [Noël Daru. 1729-1804], d’un caractère très sanguin, a été le plus aimable, le plus gai, le plus fouteur des hommes ; il était financier riche et aurait été fermier général sans la révolution. […] Ce mari n’a jamais causé à sa femme d’autre chagrin que d’enfiler ses femmes de chambre. » 462 (Cf. Hommes. Grossiers)
« Droit de cuissage » (Styron William) : 1967. William Styron [1925-2006], dans Les confessions de Nat Turner, auteur de :
« […] Non seulement il [Marse Samuel] supporta l’ivrognerie de McBride bien plus longtemps que ne l’eut fait un autre planteur, mais il s’aperçut de son penchant pour les femmes noires deux bonnes années après que tout le monde dans la propriété s’était étonné de la venue d’au moins trois petites esclaves nés avec la peau claire, des cheveux blonds bouclés et la grosse lippe de l’Irlandais. » 463 (Cf. Corps. Peau, Politique. Esclavage)
« Droit de cuissage » (Sylvestre Anne) : (31 décembre) 2003. Anne Sylvestre [1934-2020] évoquant les promenades qu’elle faisait avec son grand-père en Bourgogne sur les terres du domaine où ses ancêtres avaient été « serfs », en se reportant dans ce passé, auteure de :
« Moi, je n’aurais pas été princesse, j’aurais porté des seaux d’eau et je me serais sans doute fait culbuter derrière un buisson par le châtelain. » 464 (Cf. Histoire. Mémoire)
« Droit de cuissage ». János Székely :
« Droit de cuissage » (Székely János) (1) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
- « Je ne claquerai pas, rien que pour t’embêter, piaillait la [sa] femme. Je te survivrai, sale cochon ! C’est moi qui te verrai crever !
- Le ‘sale cochon’ ne tenait pas à crever. Il se rattrapait avec les femmes des autres, de ce qu’il n’obtenait pas auprès de la sienne. Il adorait les très jeunes femmes ; comme elles ne lui rendaient pas la pareille, il les faisait chanter. Si l’une d’elles était en retard pour son terme, il allait le trouver en l’absence de son mari, et en venait tout de suite au fait.
- Allons, chère âme, paie ton loyer, ou alors…
- Voilà ‘ou alors’, disaient les femmes quand elles le voyaient rendre l’une de ces visites. […]
Je crois que, chez lui, ce n’était pas tant du désir physique qu’une satisfaction d’amour-propre. C’était une passion de collectionneur détraqué. Une fois qu’il avait eu une femme, il ne la regardait plus et se mettait en chasse d’une nouvelle conquête. Si l’on parlait de l’une d’entre elles au café, il haussait les épaules avec indifférence.
- J’ai couché avec elle, assurait-il.
Et pour montrer qu’il disait vrai, il se lançait dans une description détaillée de ses prouesses amoureuses. » 465 (Cf. Êtres humains. Amour-propre, Hommes. Cochons, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Langage. Verbe. Avoir)
« Droit de cuissage » (Székely János) (2) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« L’oncle Matyas savait que sa jolie femme couchait de temps en temps avec le concierge, à cause du loyer ; elle devait le prévenir à l’avance, car il disparaissait toujours à cette occasion : il allait à l’église avec ses cinq fils. […]
Ce n‘est pas si dur pour ces gens-là, disaient les bourgeois des ‘classes populaire’. Ils n’ont aucune moralité.
Et ils les traitaient en conséquence. [...] » 466
« Droit de cuissage » (Székely János) (3) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« […] Ceux-ci [chargés d’expulser des locataires] obéirent, puis ils s’en furent tous les trois. Jamais ces murs n’avaient été témoins d’un pareil miracle ! La maison se saoulait de l’idée qu’un simple locataire avait eu raison du concierge, qui s’arrogeait des droits sur les femmes elles-mêmes. Les voisins hissèrent mon père sur leurs épaules et le portèrent en triomphe sur les galeries. Vive Beaumichel ! hurlaient le sous-sol et les quatre étages. Vive Beaumichel !
J’étais enthousiaste moi aussi. L’humanité finit par triompher, pensais-je. J’avais dix-sept ans et je n’avais pas la moindre notion des traitements inhumains qu’il nous faudrait subir du fait de cette ’victoire’. » 467
-------------
« Droit de cuissage » (Thackeray William Makepeace) : 1848. William Makepeace Thackeray [1811-1863], dans La foire aux vanités, auteur de :
« […] [Sir Pitt Crawley] était d’humeur assez sociable et assurément loin d’être fier. Il préférait la société d’un fermier et d’un maquignon à celle d’un homme comme milord son fils. Il prenait son plaisir à boire, à jurer et à lutiner les filles des fermiers. […]
Ses prévenances pour le beau sexe avaient déjà été notées par miss Rebecca Sharp ; en un mot, parmi tous les baronnets, les pairs et les roturiers de l’Angleterre, il n’y avait pas un être plus bas, plus égoïste, plus bête et plus mal famé que ce vieux ladre. » 468 (Cf. Relations entre êtres humains. Vanité)
« Droit de cuissage » (Tchékhov Anton) : 1893. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Récit d’un inconnu, auteur de :
« ‘Oui, je suis jalouse, répéta-t-elle et des larmes brillèrent dans ses yeux. Non, ce n’est pas de la jalousie, mais quelque chose de pire… que j’hésite à nommer. ‘». Elle se prit les tempes dans les mains et poursuivit avec emportement : ‘Vous les hommes, il vous arrive d’être si vils, c’est affreux !’
- ‘ Je ne vois là rien d’affreux !’
- ‘Je ne l’ai pas vu, mais je ne le sais pas, mais on dit que vous les hommes, vous commencez dès l’enfance avec les femmes de chambre et qu’après par habitude, vous n’en éprouvez aucun dégoût. […]
Mais comprends-moi, je ne peux pas faire autrement. Elle me dégoûte et me fait peur. Sa vue m’est pénible.’
- ‘Ne peut-on s’élever au-dessus de pareilles mesquineries ? dit Orlov en haussant les épaules d’un air interdit et en s’éloignant de la cheminée. Il n’y a rien de plus simple, ne faites pas attention à elle, elle ne vous dégoûtera pas et vous ne serez pas amenée de faire un drame à propos de rien.’ » 469 (Cf. Violences. Tchékhov Anton)
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Léon Tolstoï :
« Droit de cuissage » (Tolstoï Léon) (1) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, retranscrit un échange entre Oblonski et Lévine :
« - […] Tu prends un mauvais pli avec ta femme. J’ai remarqué l’importance que tu attachais à obtenir son autorisation pour t’absenter pendant quarante-huit heures. Cela peut être charmant à titre d’idylle, mais cela ne saurait pas durer toute la vie. L’homme doit maintenir son indépendance, il a ses intérêts à lui, conclut Oblonski, en ouvrant la porte.
- Lesquels ? ceux de courir avec les filles de ferme.
- Pourquoi pas si cela l’amuse ? Ça ne tire pas à conséquence. Ma femme ne s’en trouvera pas plus mal. Respectons seulement le domicile conjugal ; mais pour le reste, ne nous laissons pas lier les mains. […] » 470
« Droit de cuissage » (Tolstoï Léon) (2) : 1878. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Souvenirs, auteur de :
« Mon père, à vingt ans, n’était plus un jouvenceau innocent : avant même son entrée en service [de l’armée], donc vers seize ans, pour sa santé, ainsi qu’on pensait à l’époque, l’unirent à une jeune fille de la domesticité. De cette liaison naquit un fils, Michenka, dont on fit un postillon. Tant que vécut mon père, il se conduisit bien (sic), mais ensuite il quitta le droit chemin (sic) et vint souvent nous demander du secours, à nous ses frères, lorsque nous fûmes adultes. Je me rappelle le sentiment de perplexité (sic) que je ressentais lorsque ce frère tombé dans la mendicité, et qui ressemblait à mon père plus qu’aucun d’entre nous, nous demandait assistance et se montrait reconnaissant pour les dix ou quinze roubles que nous lui donnions. » 471 (Cf. Enfants, Femmes. Mères, Famille. Mariage, Patriarcat. Pères)
« Droit de cuissage » (Tolstoï Léon) (3) : (13 novembre) 1898. L’épouse de Léon Tolstoï [Sophie. 1844-1919] écrivait concernant l’écriture de Résurrection [1899] dans son Journal :
« Je souffre de ce que Lev Nikolaïevitch, vieillard sentimental, se délecte particulièrement, tout comme un gastronome jouit d’un met succulent, à la description du roman d’amour entre la bonne et l’officier. Je sais, car il me m’a raconté lui-même, que Lev Nikolaïevitch, dans ces scènes, décrit sa propre liaison avec la femme de chambre de sa sœur à Pilogov. J’ai vu cette Gacha par la suite, elle est maintenant une vieille femme de 70 ans, il me l’a montrée lui-même à mon grand d’espoir et à mon grand dégoût. » 472
À la lecture de la présentation par Wikipédia de Sonia Tolstoï [1844-1919], je lis :
« Il remet à la future comtesse Tolstoï son journal intime, la veille de leurs noces, relatant ses aventures avec ses serves. » (Cf. Femmes. Épouse de, Hommes, Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. « Faire l’amour », Patriarcat. Domination masculine)
« Droit de cuissage » (Tolstoï Léon) (4) : (14 juin) 1909. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« Clairement, vivement souvenu de mes saletés : Aks[inia], Chouv[alov]. Et j’ose condamner des hommes. » Et il en conclue :
« Et comme je me suis senti bien de cette conscience de ma saleté. (Cf. Êtres humains. Conscience, Patriarcat. Pères. Tolstoï Léon) 473
« Droit de cuissage » (Tolstoï Léon) (5) : 1899. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Résurrection, écrit : Après avoir été séduite et abandonnée par le séducteur - le prince Nekhlioudov qui sera le sujet du livre - Katioucha, après avoir reçu 100 roubles de lui, est « jetée dehors » par ses tantes chez qui elle était employée. Puis elle « entra en qualité de femme de chambre chez commissaire, un homme de plus de 50 ans qui se mit dès le second mois à lui faire la cour. Un jour qu’il se montrait particulièrement pressant, elle le traita de brute et de vieux diable, et le repoussa si fort qu’il tomba. On la renvoya pour insolence. » Elle accouche d’un enfant qui meurt. […]
Elle trouve alors à s’engager chez un garde forestier. Il était marié, mais dès le premier jour, comme le commissaire, il se mit à faire la cour à la jeune servante. Celle-ci d’abord, essaya d’échapper à ses poursuites, car elle tenait à garder la place. Mais il avait plus d’expérience et plus de ruse qu’elle, et surtout, il était le maître, pouvant lui commander ce qui lui plaisait. Après avoir guetté l’instant propice, il se jeta sur elle et la posséda. Sa femme ne tarda pas à en être informée. Un jour, surprenant son mari seul dans une chambre avec Katiouchka, elle frappa la servante au visage jusqu’à la faire saigner et la congédia sans lui payer ses gages. […] »
Puis Nekhlioudov revoie Katioucha :
« Le souvenir de cette scène le torturait comme l’eut fait une vraie blessure. Mais que faire ? Puisque tout le monde agissait ainsi… N’était-ce pas ainsi qu’avait agi Chenbok à l’égard de cette gouvernante son on lui avait parlé. Et l’oncle Gricha ? Et son père, au temps où il habitait la campagne quand il avait eu un fils illégitime, ce Mitienka qui vivait encore ? Puisque tout le monde agissait de cette façon, il devait faire de même ! Il cherchait à se rassurer grâce à ces raisonnements, sans jamais y parvenir. […]
Dans le fond, dans le coin le plus profond de son cœur, il sentait qu’il avait agi d’une façon si indigne, si abjecte, si cruelle, qu’il avait perdu non seulement le droit de juger les autres, mais encore de regarder le monde en face. […] » 474 (Cf. Femmes. Servantes)
« Droit de cuissage » (Tolstoï Léon) (6) : 1951. Pierre Pascal [1890-1983] écrit concernant l’écriture par Léon Tolstoï [1828-1910] de Résurrection :
« Tolstoï […] se débat au milieu de conflits qui l’épuisent : comment mettre d’accord les idées et les actes ? Ses disciples le poussent au renoncement total. Sa femme le retient. Peut-être aussi son propre passé l’embarrasse-t-il. Il avait lui aussi, comme il le confessera plus tard à son biographe, séduit une jeune bonne, nommée Gacha, qui travaillait chez sa tante et qui, comme Rosalie s’était perdue (sic). Il lui faut alors intégrer ses souvenirs personnels dans l’histoire de Katiouchka. Ils n’ont pas cessé de vivre en lui. »475
-------------
« Droit de cuissage » (Tulard Jean) : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant :
- Seigneur de la guerre (Le) [1965. Franklin J. Schaffner] : « Au XIème siècle, Chrysagon repousse les Frisons et se taille (sic) une principauté. Au cours d’une chasse, il remarque une jeune paysanne fiancée à un jeune homme, Marc. Le jour du mariage, il fait valoir le droit de cuissage et, au petit jour, part avec la femme, abandonnant sa principauté. Il sera tué. Curieux et attachant film historique : scènes de bataille et scènes érotiques font ici bon ménage. A voir. »
- Un amour désespéré [1950. William Wyler] : « Petite campagnarde, Carrie part pour Chicago et y trouve un emploi d’ouvrière. Blessée, elle est licenciée. Éperdue, elle demande à Charlie, un commis voyageur rencontré dans un train, de lui procurer un emploi. Il lui ne trouve un, mais la prie, en échange, de devenir sa maîtresse. Carrie accepte, tout en n’aimant pas Charlie. […] » 476 (Cf. Culture. Cinéma)
« Droit de cuissage » (Université. CNRS. France) : (6 avril) 2016. Commentaire lu suite à un article du Figaro :
« Si l'on veut vraiment faire une loi qui lutte contre la prostitution […] on pourrait aussi réprimer pénalement l'attribution de postes et de grades contre faveurs sexuelles dans la fonction publique ? Pour avoir passé suffisamment de temps dans les labos du CNRS, je peux témoigner que certaines mais aussi certains ont obtenu leur bourse de thèse où leur poste d'ATER (attaché-e temporaire d’enseignement et de recherches) contre faveur… » 477 (Cf. « Sciences » sociales, Proxénétisme)
Ce constat me remémore un souvenir : une amie enseignante dans une faculté de province, au début des campagnes en faveur de la parité, me disant en parlant de ses collègues hommes :
« Ils sont en train de constituer leur harem. »
Lorsque je retransmettais son analyse, la réaction était immédiate, fulgurante. (Cf. Politique. Parité)
« Droit de cuissage » (Vaillant Roger) : 1957. Roger Vaillant [1907-1965], dans La loi, roman-vérité dont l’action a lieu au milieu du XXème siècle dans le sud d’une Italie quasi féodale (les Pouilles), concernant le seigneur des lieux, Don Cesare, auteur de :
« Les hommes faisaient semblant de ne pas savoir qu’il faisait l’amour à leurs filles et à leurs sœurs ; lui, pour les faire venir à la maison, prenait toujours prétexte d’un travail : lessive, couture, épluchage du maïs, séchage des figues ; ainsi l’honneur des hommes était sauf. Quand la fille, la première nuit passée, lui plaisait, il l’engageait comme servante ; on ne lui fit jamais de chantage, parce qu’il est dans la tradition des seigneurs du marais d’Uria de témoigner de l’amitié aux filles et aux femmes de leur maison. Quand une jeune fille ne lui plaisait plus, il mariait. Il garda Julia après l’avoir mariée, parce qu’elle cuisinait bien et que son mari prenait grand soin des antiques (qu’il collectionnait) : chargé de l’entretien des collections, elle ne cassa pas une seule pièce en dix ans. Ensuite, il la garda à cause de ses filles. » 478 (Cf. Femmes. Servantes)
« Droit de cuissage » (Vassilokos Vassilis) : 1964. Vassilis Vassilikos [1933-2023], dans Les photographies, auteur de :
« […] Elle vit dans le couloir une foule de femmes qui criaient : ‘Du travail ! Du travail !’. ‘On a des bras ! on a des mains !’. Ils veulent des jeunes pour les manufactures. Celles qui excitent la convoitise des patrons. Vous, vous êtes trop ridées. Bonnes pour l’hospice. » 479 (Cf. Corps. Rides, Femmes. Âgées. Concurrence entre femmes. Travail)
Par ordre chronologique. « Droit de cuissage ». Voltaire :
« Droit de cuissage » (Voltaire) (1) : (26 août) 1752. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Charles-Jean-François Hénault, [1685-1770] écrit :
« J’aime assez les anecdotes des rois et des servantes. » 480 (Cf. Femmes. Servantes)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (2) : (13 octobre) 1759. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à madame du Deffand [1697-1780], lui écrit :
« J’aime les mœurs des patriarches, non pas parce qu’ils couchaient tous avec leurs servantes, mais parce qu’ils cultivaient la terre comme moi. » 481 (Cf. Femmes. Servantes)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (3) : 1762. Voltaire [1694-1778], écrivit une « comédie en vers », publiée à Genève, intitulée : Le droit du seigneur. 482
- Lu dans une note de La Pléiade : « Le droit du seigneur, créée en 1762, avait été ‘remise’ en 1778. » Que signifie : « remise » ?
Par comparaison, Le mariage de Figaro de Beaumarchais, terminé en 1778, ne sera joué la première fois que 27 avril 1784, tandis que l’interdit de publication ne sera levé que le 7 avril 1785. (Cf. Culture. Censure)
J’y lis aussi qu’ « en 1783 une œuvre de Desfontaines [?-?] portait ce même titre. » 483
« Droit de cuissage » (Voltaire) (4) : (9 janvier) 1761. Voltaire [1694-1778] écrit au comte d’Argental [1700-1788], lui demande de lui renvoyer un manuscrit et lui écrit :
« J’attends aussi ce Droit du seigneur que vous n’aimez point et que j’ai le malheur d’aimer. » 484
« Droit de cuissage » (Voltaire) (5) : (11 juillet) 1761. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Étienne-Noël Damilaville [1723-1768] lui écrit :
« […] Je crois qu’il serait bon de joindre le titre du Droit du seigneur à celui de L’Écueil du sage, car les Bellecourt [comédien] et ejusdem farinae homines [et les gens de même farine] ne savent pas qu’autrefois les seigneurs séculiers et les prêtres avaient dans leurs domaines le droit de cuissage, le droit de prélibation ; cette partie du sujet ignorée des comédiens perd de son piquant aux yeux de ceux qui n’en sont pas instruits. » 485
« Droit de cuissage » (Voltaire) (6) : (19 octobre) 1761. Denis Diderot [1713-1784] écrit à Sophie Volland [1716-1784] :
« On ne jouera point Le droit du seigneur. Crébillon [censeur dramatique de la police de la librairie. 1674-1762], qui n’aime pas de Voltaire (?), trouve l’ouvrage indécent. » 486 (Cf. Culture. Censure)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (7) : (8 janvier) 1762. Voltaire [1694-1778] écrit à nouveau au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774] :
« Mon Dieu que j’aime Cassandre et Le droit du seigneur ! » 487
« Droit de cuissage » (Voltaire) (8) : (18 janvier) 1762. Voltaire [1694-1778] écrit à nouveau au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774] :
« On parle de jouer à présent Le Droit du seigneur, mais si on fait des coupures dans les premiers actes, comme on le dit, si on substitue des choses insipides à des plaisanteries assez naïves et assez bonnes, tout est perdu. […] » 488 (Cf. Culture. Censure)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (9) : (26 janvier) 1762. Voltaire [1694-1778], écrit au duc de Richelieu [1696-1788] dont Wikipédia note « ses innombrables conquêtes féminines » :
« Je vous exhorte à voir Le Droit du seigneur qu’on a sottement appelé L’Écueil du sage. On dit qu’on (la police) en a retranché beaucoup de bonnes plaisanteries, mais qu’il en reste assez pour amuser le seigneur de France qui a le plus usé de ce beau droit. » Puis, deux paragraphes plus bas, il l’invite chez lui et poursuit :
« Je vous avertis que Melle Corneille [qu’il présente à d’autres comme sa « fille », sa « pupille », qu’il nomme Cornélie-Chiffon] est une laideron extrêmement piquante et que si vous vouliez jouir du droit du seigneur avant qu’on la marie, il faut faire un petit tour au Délices [résidence de Voltaire, de sa nièce Marie-Louise Denis [1712-1790] et la petite nièce de Corneille] […]. » 489 (Cf. Culture. Censure, Femmes. « Féminin », Langage. Féminisation du langage)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (10) : (vers le 1er février) 1762. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Marie-Élisabeth de Dompierre de Fontaine [1715-1771], auteur de :
« On a mutilé, estropié trois actes du Droit du seigneur ou de l’écueil du sage à la police. C’est le bonhomme Crébillon [nommé censeur royal de la Librairie en 1759. 1707-1777] en qui a fait ce carnage, croyant que ces gens-là étaient mes sujets. » 490 (Cf. Culture. Censure)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (11) : (22 novembre) 1762. Voltaire [1694-1778] écrit à M. Bernard-Louis Chauvelin [1716-1773] qui lui avait demandé l’envoi de sa pièce, le Droit du seigneur :
« Le titre en est beau je l’avoue, mais je tiens avec vous, Monsieur l’Ambassadeur, qu’il vaut mieux être possesseur de Madame de Chauvelin que d’avoir le droit des prémices de toutes les filles du village. » 491
« Droit de cuissage » (Voltaire) (12) : (23 décembre) 1762. Voltaire [1694-1778] écrit au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774] :
« En attendant, il faut que je vous parle de Mlle d’Épinay ou de l’Épinay ; ce n’est pas pour la marier. M. le maréchal de Richelieu [1696-1788] paraît avoir usé de ses droits de premier gentilhomme de la chambre [du roi] avec cette infante. Il veut la payer en partie par les rôles [de comédienne] qu’avait Melle Gaussin dans les pièces de votre serviteur. Il me demande une déclaration en faveur de la demoiselle, et même au détriment de l’enfant Hus. Dites-moi […] ce que je dois faire. […] » En note, je lis :
« Si ce que dit Voltaire est vrai, le véritable père de sa fille, Élisabeth Félicité, née le 23 juillet 1760, peut avoir été Richelieu. » 492 (Cf. Hommes. « Trompeurs de femmes », Patriarcat. Pères, Proxénétisme. « Clients »)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (13) : (25 février) 1763. Voltaire [1694-1778] écrit au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774], après avoir critiqué ses deux pièces, Adelaïde et Zulime :
« J’aime assez Le droit du seigneur, je vous l’avoue, mais je voudrais qu’il y eût un peu plus de ces honnêtes libertés que le sujet comporte, et que les dames aiment beaucoup quoi qu’elles en disent. » 493
N.B. Une ambiguïté quant à la signification que Voltaire accorde au terme de « libertés ».
« Droit de cuissage » (Voltaire) (14) : (vers le 25 mars) 1763. Voltaire [1694-1778] écrit à Jean Ribote-Charron [?-?]. « jeune commerçant protestant » :
« Si vous pouviez […] dire aussi à vos ministres (?) qu’ils fassent le plus d’enfants qu’ils pourront aux servantes [sans donc ‘dommage’, ni risque pour eux], mais que d’ailleurs [par ailleurs] ils soient infiniment circonspects [sans doute avant le terme définitif de ‘l’affaire Calas’]. Il est question de leur faire du bien pourvu qu’ils ne l’empêchent pas. »
- Une note de La Pléiade [1981] précise que les éditions antérieures avaient supprimé le passage depuis « fassent plus d’enfants ». 494
Cette censure révèle la gêne, ancienne, concernant l’effectivité de la permanence du « droit de cuissage ». (Cf. Culture. Censure, Femmes. Servantes)
« Droit de cuissage » (Voltaire) (15) : (20 février) 1764. Voltaire [1694-1778] écrit au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774] :
« Je serais fort aise qu’on jouât Le droit du seigneur, quoi que je ne suis guère homme à jouir d’un si beau droit. Vous pensez bien que je ne connais Mlle d’Épinay que par le droit que les premiers gentilshommes ont sur les actrices. » 495
- Là encore, plus qu’ambigu…
-------------
« Droit de cuissage » (Wikipédia) : (5 août) 2024. Lu sur Wikipédia, me concernant :
« Une partie de son travail a été critiquée, notamment à cause de l'emploi du terme ‘Droit de cuissage’ qui fait référence à un mythe, au lieu du terme ‘harcèlement sexuel’ qui correspond, lui à une réalité sociale. Alain Boureau, dans l'épilogue de son ouvrage Le Droit de cuissage. La Fabrication d'un mythe, XIIIe- XXe siècle [1995] lui reproche une légèreté certaine dans la reproduction de ce mythe qui relève historiquement, d'abord de la propagande orchestrée par les moines puis les juristes royaux contre le pouvoir des seigneurs laïcs, puis de la propagande anticléricale du XIXe siècle. »
Il y en a qui ont tout compris…
« Droit de cuissage » (Zinoviev Alexandre) : 1978. Dans L’avenir radieux d’Alexandre Zinoviev [1922-2006], celui-ci évoque une soirée en présence de Canarille, directeur de l’institut de philosophie dans lequel il travaille, prototype de l’apparatchik soviétique des années 1950/60 :
« Canarille était là, et il passa toute la soirée à prodiguer des compliments larmoyants sur mon talent et la beauté de Tamara. Sans doute a-t-il eu vent de des rumeurs selon lesquelles nous nous acheminions vers le divorce et il me chantait sur tous les tons que je devais conserver ce trésor qu’était ma femme, pestaient contre les écervelées modernes (ces « rapaces »), lançait des trémolos sur la morale du savant soviétique. Et lui, ce salaud, il s’est marié trois fois et il a couché avec toutes les femmes de ménage, les expéditionnaires de tous les organismes qu’il a dirigés. » 496
Par ordre chronologique, « Droit de cuissage ». Émile Zola :
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (1) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« La belle éducation que recevait Maxime eut un premier résultat. À dix-sept ans, le gamin séduisit la femme de chambre de sa belle-mère. Le pis de l’histoire fut que la chambrière devint enceinte. Il fallut l’envoyer à la campagne avec le marmot et lui constituer une petite rente. Renée [la belle-mère de Maxime] resta horriblement vexée de l’aventure. Saccard [le père de Maxime] ne s’en occupa que pour régler le côté pécuniaire de la question ; mais la jeune femme [Renée] gronda vertement son élève. Lui, dont elle voulait faire un homme distingué, se compromettre avec une telle fille ! Quel début ridicule et honteux, quelle fredaine inavouable ! » 497 (Cf. Femmes. Enceintes. Mères, Hommes. Irresponsables, Économie. Argent)
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (2) : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon, évoque les « préfets d’alcôve qui, pour coucher librement avec les femmes, envoient les maris à la Chambre. » 498 (Cf. Politique. Démocratie)
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (3) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« […] Vous savez, elle [selon Gueulin, le nouvel amant de Clarisse, maîtresse de Duveyrier] l’exècre, oh ! un dégoût à en être malade. Dame ! elle n’aime guère les boutons non plus, cette fille ! Mais elle n’a pas la ressource de l’envoyer dehors, comme sa femme ; autrement, si, elle pouvait le passer à sa bonne, je vous assure qu’elle se débarrasserait vite de la corvée. » 499 (Cf. Femmes, Épouses. « Bonnes-à tout-faire ». Maîtresses, Hommes. Amants, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (4) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« Et on ne savait ni où ni comment il s’était jeté sur Adèle : sans doute derrière une porte, dans un courant d’air, car cette grosse bête de souillon empochait les hommes comme les gifles, l’échine tendue, et ce n’était pas au propriétaire qu’elle aurait osé faire une impolitesse. » 500
N.B.1. « Empocher » (Le Littré) : « […] se dit d'une parole désagréable, surtout quand on n'a rien à répliquer. » Aujourd’hui [2024] : « toucher, recevoir [de l’argent]. »
N.B.2. « Échine » : « Colonne vertébrale de l'homme et de certains animaux ; région correspondante du dos ; Viande de porc correspondant à une partie de la longe. »
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (5) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, évoque, concernant le patron du Bonheur des dames, « les filles ramassées par lui dans les rayons », puis « les filles ramassées dans les coulisses des petits théâtres et dans les restaurants de nuit ». 501
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (6) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Clara Prunaire, fille d’un sabotier des bois de Vivet, débauchée par les valets de chambre au château de Mareuil, quand la comtesse la prenait pour les raccommodages, était venue plus tard d’un magasin de Langres [au Bonheur des dames], et se vengeaient à Paris sur les hommes des coups de pied dont le père Prunaire lui bleuissait les reins » (Cf. Enfants. Filles, Femmes. Vengeance, Hommes. Violents, Famille, Patriarcat. Pères) 502
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (7) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
«- À propos, vous vous souvenez de Clara Prunaire. Eh bien, ! il paraît que le patron l’aurait… vous comprenez ? […]
Elle [Denise], toute pâle, s’écria :
- M. Mouret !
- Un drôle de goût, n’est-ce pas ? reprit-il. Une femme qui ressemble à un cheval… La petite lingère qu’il avait eue deux fois, l’an passé étaient gentille au moins. Enfin, ça le regarde. » 503
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (8) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« [...] Il [Mouret] eut un geste fou. C’était la première qui ne cédait pas. Il n’avait eu qu’à se baisser pour prendre les autres, toutes attendaient son caprice en servantes soumises ; et celle-ci disait non sans même donner un prétexte raisonnable. […] »
Jamais les filles ramassées par lui dans les rayons ne s’étaient inquiétées d’êtres aimées. [...] 504
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (9) : 1885. Émile Zola [1840-1902], dans Germinal, concernant les ouvrières - les hercheuses - de l’usine auteur de :
« Oui, toutes y passaient, c’était plus fort que la raison. » 505
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (10) : 1886. Émile Zola [1840-1902], dans L’oeuvre, auteur de :
« Sa mère était morte, le père Bécot avait fini par coucher avec ses bonnes pour éviter de courir dehors. » 506
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (11) : 1887. Émile Zola, [1840-1902], dans La terre, rapporte ‘de la lecture’ lors d’une veillée par ‘le caporal’ du livre Les malheurs et le triomphe de Jacques Bonhomme, et écrit comment le dénommé Jésus-Christ « rigolait dans sa barbe. » Et Émile Zola poursuit :
« Il voulut insister sur les droits polissons, auquel le petit livre se contentait de faire une allusion pudique.
- Et le droit de cuissage, dites donc ? Ma parole ! le seigneur fourrait la cuisse dans le lit de la mariée et la première nuit, il lui fourrait…
On le fit taire, les filles, Lise elle-même avec son gros ventre, étaient devenues toutes rouges, et les deux galopins, le nez tombé par terre, se collaient les poings dans la bouche, pour ne pas éclater. » 507
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (12) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« Hourdequin, carré des épaules, avec sa large face haute en couleur, n’ayant gardé que des mains petites de son affinement bourgeois, avait toujours été un mâle despotique pour ses servantes. Même du temps de sa femme, toutes étaient prises ; et cela naturellement, sans autre conséquences ; comme une chose due. Si les filles de paysans pauvres qui vont en couture, se sauvent parfois, pas une de celles qui s’engagent dans les fermes, n’évite l’homme, les valets ou le maître. » 508 (Cf. Femmes. Servantes. Travail, Économie. « Pauvres Les »)
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (13) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« Monsieur Charles (par ailleurs patron de bordel ‘géré’ par sa femme, puis par sa fille) Croyez-vous ça ! avez-vous jamais vu une abomination pareille ! … J’étais à nettoyer mon rosier, je monte sur le dernier échelon, ne me penche de l’autre côté, machinalement ; et qu’est-ce que j’aperçois ! … Honorine, oui ! Ma bonne Honorine, avec un homme, l’un sur l’autre, les jambes en l’air, en train de faire leurs saletés… Ah, les cochons, les cochons ! au pied de mon mur ! ‘
Il suffoquait, il se mit à marcher, avec des gestes nobles de malédiction.
‘Je l’attends pour la flanquer à la porte, la gueuse, la misérable !... Nous ne pouvons en garder une. On nous les engrosse toutes. Au bout de six mois, c’est réglé ; elles deviennent impossibles dans une famille honnête, avec leurs ventres. Et celle-ci que je trouve à la besogne, et d’un cœur ! Décidément, c’est la fin du monde, la débauche n’a plus de bornes !’ » 509 (Cf. Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Proxénétisme. Bordels)
« Droit de cuissage » (Zola Émile) (14) : 1890. Émile Zola [1840-1902], dans La bête humaine, auteur de :
« Car tu sais, le Président, malgré son air glacé, on en chuchote de raides sur son compte. Il parait que, du vivant même de sa femme, toutes les bonnes y passaient. Enfin, un gaillard qui, aujourd’hui encore, vous trousse une femme […]. » 510
-------------
IX. Violences à l’encontre des femmes. Harcèlement sexuel :
Violences à l’encontre des femmes. Harcèlement sexuel :
Violences à l’encontre des femmes (Harcèlement sexuel) : L’expression de harcèlement sexuel a toujours été employée pour euphémiser la gravité des « violences » ; les meurtres, assassinats, viols peuvent y être dorénavant inclus. Encore une avancée féministe dévoyée, détournée ; encore des contresens.
Exemple : (17 février) 2015. Cf. Turquie : après le meurtre d’une étudiante, des femmes dénoncent le harcèlement. 511
À nouveau, après L’Express, Le Monde : (9 juin) 2015. « En février, le décès d’Özgecan Aslan, une étudiante de 20 ans violée puis tuée à coups de barre de fer par un chauffeur de bus, avait incité des milliers de femmes à prendre la parole sur le harcèlement sexuel. » 512 (Cf. Langage)
Par ordre alphabétique. Violences à l’encontre des femmes. Harcèlement sexuel :
Harcèlement sexuel (Akerman Chantal) : 2013. Chantal Akerman [1950-2015], après avoir dit que sa mère [qui avait été déportée à 15 ans et demi] comprenait très bien ses films, en donne l’exemple suivant :
« Quand elle a vu le film que j’ai fait sur Pina Bausch [1940-2009], elle a vu une femme qu’on tripotait et puis, après, il y avait une danse. Ma mère m’a dit : ‘Tu vois, c’est ça les camps, on pouvait tout vous faire.’ » 513 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Mères, Féminismes)
Harcèlement sexuel (Anachronisme) : 2008. Lu dans le livre de Michelle Perrot, Mon histoire des femmes, concernant le travail des femmes dans les usines :
« Le harcèlement sexuel fait partie des motifs de grève. » 514 Trop allusif ? rapide ? anachronique ? (Cf. Histoire)
Harcèlement sexuel (Appel. Levons l’omerta. 10 mai 2016) : (11 mai) 2016. Dans Le Canard enchaîné, sous l’intitulé : Duflot et Mélenchon à la manœuvre, on apprend qu’un courriel daté du 4 mai « circule discrètement sur les réseaux sociaux qu’utilisent les amis de Cécile Duflot et de Jean-Luc Mélenchon, les deux candidats putatifs de la gauche de la gauche, pourtant brouillés et rivaux. Ce courriel prévient ses destinataires de la parution ‘dans deux grands médias français, d’enquêtes complémentaires approfondies sur la question des violences et harcèlement sexuels en politiques’. Sans citer précisément le cas Baupin, il invite les destinataires à signer un appel qui ‘sera publié après la révélation dans les médias de ces affaires, pour apporter notre soutien aux femmes qui ont courageusement accepté de témoigner’. » 515.
Six jours après l’envoi de ce mail, seront publiés notamment par Libération, le 10 mai 2016, et la dénonciation des agissements de Denis Baupin (Vert, époux d’Emmanuelle Cosse, ministre verte qui soutient François Hollande) et le texte intitulé : « Levons l’omerta » miraculeusement « signé par plus de 500 militant-es et élu-es » contre le harcèlement sexuel et le sexisme dans le monde politique.
- En résumé : une manip politique anti-Hollande ? ; ce qui pour autant, bien sûr, ne lave pas T. Baupin des accusations portées à son encontre.
- Quant aux réactions des femmes politiques interrogées, il faudrait une par une, en montrer l’impudence, l’irresponsabilité, le mépris de la loi et des femmes qu’elles révélaient. Qu’ont-elles donc fait depuis toutes ces années en soutien avec les femmes harcelées, agressées avant qu’elles-mêmes, dans le contexte rappelé, affirment collectivement, dorénavant vouloir être dorénavant respectées ?
- Certes, certaines revendications législatives ont été évoquées, mais quelle crédibilité leur conférer ? Plus grave, de quelle morale politique peuvent-elles se prévaloir ? (Cf. Hommes. « Politiques ». Mélenchon Jean-Luc, Penser. « Réseaux sociaux », Politique. Remerciements, Proxénétisme. Vert-es)
- (19 mai) 2016. « Après l’affaire Baupin, le groupe écolo se disloque à l’Assemblée Nationale » 516
- (24 mai) 2016. « Le groupe socialiste a regagné sa majorité absolue à l’Assemblée après que six députés écologistes ‘réformistes’ eurent décidé jeudi dernier de le rejoindre. ‘Nous sommes désormais 291 » a dit mardi Bruno Leroux lors de sa conférence de presse avec trois des six députés écologistes qui ont sonné le glas de leur groupe déchiré en deux camps en se ralliant aux socialistes. » 517
- (9 mars) 2017. Après classement sans suite de la plainte ouverte pour harcèlement sexuel et agression sexuelle portée à l’encontre de Denis Baupin pour prescription, celui-ci annonce son intention de déposer quatre plaintes « pour dénonciation calomnieuse contre [ses] accusatrices » et, une autre, contre EELV « pour diffamation ». Honte à lui, à son avocat, au droit et à la justice… 518 (Cf. Justice. Prescription)
Harcèlement sexuel (Avocat général) : 2002. Procès en appel d’une victime harcelée puis violée. En substance, l’avocat général déclara :
« Nous ne sommes pas dans la séduction, ce n'est donc pas du harcèlement sexuel. Nous sommes dans la goujaterie et celle-ci n'est pas pénalisable. » (transmis par la partie civile). (Cf. Justice)
Harcèlement sexuel (Capek Karel) : 1934. Karel Capek [1890-1938], dans Une vie ordinaire, auteur de :
« Calme-toi. Tu avais beaucoup de pouvoir au ministère ; il suffisait de froncer les sourcils et les jeunes femmes en tremblaient. Qu’est ce qui te coûtait de faire venir l’une d’entre elles : ‘Mademoiselle, vous avez fait beaucoup de fautes, je ne suis pas satisfait de vous ; je ne sais que faire, je ne sais que faire, je devrais proposer votre licenciement.’ Et ainsi de suite, tenter la chance auprès de chacune d’elles. […] Que n’aurait-elle pas fait, une jeune femme de cette sorte, en récompense d’une petite indemnité et de quelques chiffons en soie ! Elles étaient jeunes et elles étaient tes subordonnées…
- L’ai-je fait ?
- Bien sûr que non ! Sauf que tu essayais de les impressionner : ‘Mademoiselle, je ne suis pas satisfait de votre travail’, et ainsi de suite. N’ont-elles pas suffisamment imploré ta miséricorde ! Il aurait suffi de les caresser gentiment, et ça aurait été fait. Mais ce n’était qu’une possibilité parmi d’autres avec laquelle tu jouais voluptueusement. Il y en avait une quantité de ces dactylos, on ne pouvait même pas toutes les compter : puisqu’il en est ainsi, alors, allons-y : les passer toutes au crible, une par une. » 519
Harcèlement sexuel (Diderot Denis) : (2 septembre) 1762. Denis Diderot [1713-1784], dans une lettre à Sophie Volland [1716-1784], auteur de :
« Un jeune libertin se promène au Palais-Royal. Il voit un petit nez retroussé, des lèvres riantes, un œil éveillé, une démarche délibérée, et il s’écrie : ‘Oh, qu’elle est charmante !’ Moi, je tourne le dos avec dédain et j’arrêt mon regard sur un visage où je lis de l’innocence, de la candeur, de l’ingénuité, de la noblesse, de la dignité, de la décence. Croyez-vous qu’il soit bien difficile de décider qui a tort du jeune homme ou de moi ? Son goût se résume à ceci : J’aime le vice. Et le mien à ceci : J’aime la vertu. Et ainsi de presque tous les autres jugements. Ils se résolvent en dernier à l’un ou l’autre de ces mots. » (Cf. Femmes, Hommes. « Libertins », Justice, Langage. Mots, Penser. Pensées. Binaires)
Cette citation de Denis Diderot révèle toute l’ambiguïté des termes de « harcèlement sexuel ». (Poursuivre)
Harcèlement sexuel (Fonction) : Si tant est que l’on puisse penser que l’émergence de l’expression « harcèlement sexuel » puisse être expliquée par la fonction qu’elle remplirait, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle elle permettrait d’ouvrir à la conscience de leurs auteurs la perception de leurs déficiences.
Harcèlement sexuel (Fraisse Geneviève) : 1999. Geneviève Fraisse, auteure de :
« Au moment de la loi sur le harcèlement, personne ne croyait que c’était un vrai problème dans l’entreprise. On (sic) en a pris la mesure après coup. » Ah bon ? 520
Harcèlement sexuel (Gide André) : (7 juillet) 1930. André Gide [1869-1951], dans son Journal, écrit, sous le curieux intitulé : « Projet de sermon » :
« Mais, le plein embrassement de la Vérité, mes frères, nous est refusé ; et du reste il donnerait à notre âme une satisfaction moins vive que la recherche ; de même que souvent le libre accès d’un corps nu déçoit la main qui prenait tant de joie à s’insinuer entre chair et robe. » 521
Harcèlement sexuel (Grahn Lucile) : 1992. Lu dans un Dictionnaire de femmes célèbres concernant Lucile Grahn « danseuses danoise. 1819-1907 » :
« Grande et mince, blonde aux yeux bleus, cette élève d’August Bournonville [1805-1879] fit des débuts remarqués au Théâtre royal de Copenhague en 1834. C’est aussi pour échapper aux assiduités de son maître qu’elle accepta un contrat de trois ans à l’Opéra de Paris après le succès du Carnaval de Venise (Milan), en 1838. […] » 522
Par ordre chronologique. Harcèlement sexuel. Claude Lanzmann :
Harcèlement sexuel (Lanzmann Claude) (1) : (8 février) 2012. Claude Lanzmann [1925-2018] s’est souvent targué [vanté ?] d’avoir été le dernier amant de Simone de Beauvoir.
Arrêté (brièvement) et interrogé pour cause d’accusation de harcèlement sexuel par et sur une employée de sécurité qu’il aurait touchée ? embrassée ? harcelée ? contre son gré à l’aéroport de Tel-Aviv. 523
- À son arrivée dans l’avion [qui avait attendu qu’il soit ‘relâché’], Claude Lanzmann aurait déclaré :
« Vous rendez-vous compte ? Me faire ça à moi, 86 ans, moi qui ai tant fait pour Israël… » 524 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Lanzmann Claude, Politique. État. Nationalisme, Pornographie. « Ce n’était pas une partouze »)
Harcèlement sexuel (Lanzmann Claude) (2) : (7 juillet) 2018. Alice Coffin, après avoir cité les accusations de harcèlement, de violences à l’encontre de Claude Lanzmann - dont la presse française ne fait pas état - a relevé la manière dont elle l’a qualifié : dans Le Monde : « un séducteur insatiable » ; dans Libération : un « séducteur brusque et enflammé », dans Le Parisien : un « galant et séducteur envers les femmes », dans Les Inrockuptibles : « un séducteur narcissique ». Lire l’intégralité de son texte. 525 (Cf. Hommes. « Galants »)
-------------
Harcèlement sexuel (Leroy Myriam) : (8 septembre) 2022 [1ère diffusion : 7 janvier 2022]. Écouté dans Les grands entretiens de LCP (La Chaîne parlementaire) le remarquable entretien de Myriam Leroy, auteure de Les Yeux rouges [Éditions du Seuil. 2019]. L’une de ses conclusions n’en a que plus de valeur :
« Lutter à l’intérieur du système, c’est conforter le système. » (Cf. Justice)
N.B. Cet entretien est présenté par LCP comme s’inscrivant dans le cadre d’ « un nouveau thème : la résilience »…
Harcèlement sexuel (Lewinski Monica) : (12 mai) 2014. Dans un interview à Vanity Fair, Monica Lewinski déclare qu’elle « regrette profondément » ce qui s’est passé.
« Il est clair que mon patron a profité de moi, écrit-elle. Mais je serai toujours ferme sur un point : c’était une relation consensuelle ». S’il y a eu abus, ça a été après, « quand on s’est servi de moi comme bouc émissaire pour protéger son pouvoir », dit-elle. 526 (Cf. Relations entre êtres humains. « Bouc émissaire »)
Harcèlement sexuel (Lois) : N’ont que rarement été considérées comme devant être mises au crédit des féministes. Un progrès qu’il ne puisse plus l’être à leur débit ?
* Ajouts. 5 Mai, 4 juin 2012. Mon questionnement était encore trop optimiste : le Conseil Constitutionnel, réunion de barbon-nes, surpayé-es, certain-es, condamné-es ou méritants de l’être, donc certains ont nommés à vie - dont dire qu’ils sont illégitimes est encore leur faire trop d’honneur - vient de supprimer les lois concernant le harcèlement sexuel. Une information qui devrait, en elle-même, casser cette décision : quatre des membres du conseil constitutionnel « connaissaient » G. Ducray, l’agresseur à l’origine de la QPC. Il n’en fut rien pour autant. 527
- La décision de l’AVFT de porter plainte, le 5 mai 2012, au commissariat du 1er arrondissement contre le Conseil constitutionnel en la personne morale de son président, M. Debré, fils de son père : toute la hiérarchie des normes juridiques - sur lesquelles se fondent le patriarcat - est [pour la première fois ?], mise sens dessus dessous. Le dépôt de plainte lui-même - qui ne fut pas « symbolique » - suite à la manifestation Place Colette : un grand moment féministe, joyeux et dynamique. Radical. (Cf. Politique. État. Conseil constitutionnel. Lois)
Harcèlement sexuel (Macron Emmanuel) : (25 novembre) 2017. Emmanuel Macron, dans son discours « à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat », auteur de :
« Le lieu de travail doit ainsi être un endroit où les victimes se sentent protégées et écoutées. Hélas ! Le lieu de travail est parfois un lieu de la violence faite aux femmes aussi. »
- On pourra apprécier la profondeur du champ historique du président de la République, sa connaissance de la société française, de celle de l’État et de ses lois, comme de celle des « lieux de travail » et donc des entreprises…
- La minute de silence qu’il a imposé à ‘son’ auditoire « en hommage aux femmes battues, violées, et tuées », vécue par moi comme une grossière manipulation, révèle ainsi les dénis que son texte, confus, démagogique, verbeux, exprime.
- Quant à son mépris des femmes [travailleuses], il est redoublé par son refus politique - criant de vérité - de toute référence au féminisme, aux féministes. (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Macron Emmanuel)
Harcèlement sexuel (Naipaul V. S) : 1990. V. S. Naipaul [1932-2018], dans L’Inde, rapporte cette séance chez M. Patil, « chef de zone » à Thane (près de Bombay) :
« L’inspecteur de police était venu, ce dimanche matin, demander l’aide du Sena pour régler un problème local de ‘chasse à l’Ève’. Le harcèlement sexuel des femmes dans les lieux publics, tantôt sournois, tantôt pratiqué tout à fait ouvertement était un problème de l’Inde entière. L’incident particulier qui préoccupait l’inspecteur avait incité deux groupes du quartier à s’affronter. Au milieu d’une telle foule, dans cette promiscuité, il ne fallait pas grand-chose pour mettre les nerfs à vif ; les ennuis arrivaient facilement. […]
L’inspecteur de police […] était content, dit-il que M. Patil se soit montré aussi compréhensif. Les deux groupes, dans cette affaire de ‘chasse à l’Ève’, avaient assez de partisans pour déclencher de véritables émeutes dans le quartier et, dans ces cas-là, la police avait pour règle de tenter de concilier les adversaires. » (Cf. Harcèlement - dit de - de rue) 528
- Une question d’ordre public, donc, dont les femmes étaient nécessairement non parties prenantes…
Harcèlement sexuel (Question prioritaire de constitutionnalité. QPC) : Sous couvert de conférer à toute personne le droit de contester la constitutionnalité d’une loi, les QPC autorisent et légitiment la remise en cause des fondements mêmes du droit. Il serait plus rapide de dire : jetons, en fonction de nos intérêts, ce qui nous gêne dans le droit actuel, tant sont nombreux les articles pouvant peu ou prou être qualifiés comme tels : être ‘mal définis’.
Concernant la définition du harcèlement sexuel, l’argument selon lequel « les éléments constitutifs de l'infraction [ne] so[i]ent [pas] suffisamment définis », ce qui a été traduit par la presse comme étant une définition « trop floue » : une (sinistre) plaisanterie qui ne justifie en rien l’abolition du texte de loi la concernant.
C’était à l’État de procéder à une nouvelle rédaction sans préjudice aucun pour les plaignantes.
La position de 1988 de la Cour européenne des droits de l’homme, analysée par Coralie Ambroise-Castérot mérite, en la matière, d’être citée : La Cour « a souligné l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois » et elle a pu juger que « beaucoup de lois, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins vagues. (Müller C: Suisse. 24 mai 1988. Série A. n°133, & 29). La matière pénale conduit, bien évidemment à plus de prudence que dans d’autres domaines, mais il n’est pas souhaitable, sinon à paralyser la répression et à conduire à une inflation de législation encore plus grande, d’exiger une rigidité plus absolue ». 529
- Dans la foulée : à quand la QPC concernant la définition du proxénétisme ? de la notion de « client », dès lors qu’il serait question de le pénaliser ? 530 (Cf. Droit)
* Ajout. 30 août 2017. (29 août) 2017. Cette question était prémonitoire. Je lis, dans Le Parisien, qu’à l’occasion d’un procès d’un « client », devenu « fer de lance du combat des associations hostiles à la pénalisation du texte législatif, le bus des femmes et le Strass [Syndicat du travail sexuel] », son avocat. Me Gardères a demandé une QPC. Certes le Parquet de jugé que cette demande était dépourvue de « caractère sérieux » et a été repoussée. Mais ce n’est, pour eux, sûrement que partie remise. 531
* Ajout. 20 septembre 2018. Mon hypothèse s’est révélée avérée juste. Une QPC, défendue par le Strass, Acceptess. T, Médecins du monde a été déposée à l’encontre de la loi dite de pénalisation des « clients ». Cette QPC après avoir été annoncée comme « information », non critiquée par Marlène Schiappa, est la semaine suivante, soutenue par Le Canard enchaîné. 532 (Cf. Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène, Proxénétisme)
* Ajout. 25 septembre 2024. Lu dans Le canard enchaîné (p.4) : « La QPC [Question prioritaire de constitutionnalité] est une tambouille cuisinée autour des règlements européens, du droit français et du fait que le seconde doit primer sur le premier. » (Cf. Droit, Justice)
Harcèlement [sexuel] (Roudy Yvette) 1983. Je lis dans le Guide des droits des femmes publié par le Ministère des droits de la femme, préfacé par Yvette Roudy (p.15) :
Question : Promotion et avances sexuelles. Faut-il accepter les avances sexuelles pour avoir de l’avancement ?
Réponse : Non, bien sûr ! Sachez que c’est une situation de chantage fréquente mais dont on n’ose pas parler. Ne restez pas seule : osez en parler autour de vous, parlez-en aussi aux délégués du personnel. Ces comportements sont punis par la loi. Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République. » (Cf. Justice, Langage. Mots. Critique de : « On »)
Par ordre chronologique. Harcèlement [sexuel]. « de rue » :
Harcèlement [sexuel] (« de rue ») (1) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« […] Mais elle souffrait davantage encore des importunités de la rue, de la continuelle obsession des passants. Elle ne pouvait descendre acheter une bougie, sur ces trottoirs boueux où rôdaient la débauche des vieux quartiers (sic) sans entendre derrière elle un souffle ardent, des paroles crues de convoitises ; et les hommes la poursuivaient jusqu’au fond de l’allée noire, encouragées par l’aspect sordide de la maison. Pourquoi donc n’avait-elle pas un amant ? » 533
Harcèlement [sexuel] (« de rue ») (2) : 1957. Roger Vailland [1907-1965], dans La loi, auteur de :
« Les fils de notables sont groupés à l‘entrée du bar des Sports, à l’affût de quelques jeunes paysannes descendues faire des achats en ville et qu’ils poursuivent de rue en rue. Peu de chance de la toucher, sinon en s’arrangeant pour la croiser, le bras ballant, et la frôler, comme par mégarde (en faisant baller adroitement le bras, on arrive à effleurer l’entrecuisse, on appelle cela la main morte) ; on s’écarte en disant ‘pardon, mademoiselle’ et toute la bande de garçons rit très fort. Mais ce qui est encore plus plaisant, et même un peu troublant, c’est de la suivre en lui chuchotant d’énormes obscénités ; ces rustaudes sont tellement intimidées qu’elles n’osent ni rabrouer leur persécuteur ni se plaindre à un vigile urbain. Elles rougissent, et hâte le pas. On se les repasse de l’un à l’autre. » 534 (Cf. Corps. Mains, Femmes. Timides. Échange des femmes, Hommes. Grossiers)
-------------
Harcèlement sexuel (Vallaud-Belkacem Najat) : (14 juin) 2012. Najat Vallaud-Belkacem, [ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement Ayrault, ce qui donne la mesure de son autonomie politique en matière de dénonciation des violences à l’encontre des femmes…], auteure de (ou du moins l’« un des membres de son cabinet ») :
« L’AVFT est une association très technique, qui a une lecture très juridique de la loi, ce qui est très bien. Mais elle est moins politique, a moins conscience de l’importance de valoriser un tel projet de loi pour que les magistrats s’en emparent. » L’aune de la politique, c’est, pour elle, la conscience que les juges auraient du droit, comme de la légitimité des seuls député-es à voter la loi…
Pour mieux délégitimer l’AVFT, la qualifier de n’être « pas assez politique » … : il faut oser… L’action de l’AVFT depuis plus de 30 ans : à la poubelle… 535
Harcèlement [sexuel] (Vergès Jacques) : (24 août) 2005. Jacques Vergès [1924-2013], dans son Journal, concernant la prison comme « pourrissoir », « déchetterie », auteur de :
« Ayant reçu la plainte d’une gardienne (qui se suicidera) contre un collège pour harcèlement, le procureur la classe au motif que l’infraction n’est pas caractérisée, mais il adresse au gardien mis en cause un avertissement où il attire son attention ‘sur [son] comportement fréquemment grossier, méprisant, voire injurieux à l’égard de cette fonctionnaire féminine’, ce qui est la définition même du harcèlement ! » 536 (Cf. Femmes. « Féminin »)
Harcèlement sexuel (Vigna Xavier) : 2022. Je lis, sous la plume de Xavier Vigna, historien, dans une « entrée » du Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, intitulée Usines. XIXème-XXème siècle :
« Ainsi, en dépit du développement des contremaîtresses, les ouvrières demeurent, au moins jusqu’aux années 1968, exposées au harcèlement sexuel de la part de la hiérarchie masculine […]. »
Dans quel monde vit-il ? 537
Par ordre chronologique. Harcèlement sexuel. Émile Zola :
Harcèlement sexuel (Zola Émile) (1) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« - Oui, allez vous coucher, monsieur Coupeau, ça vaudra mieux, déclara madame Putois.
- Ah bien ! bégaya-t-il, vous êtes encore joliment toc… On ne peut plus rigoler, alors ? Les femmes, ça me connaît, je ne leur ai jamais rien cassé. On pince une dame, n’est-ce pas ? mais on ne va pas plus loin ; on honore simplement le sexe… Et puis, quand on étale sa marchandise, c’est pour qu’on fasse son choix, n’est-ce pas ? Pourquoi la grande blonde montre-t-elle tout ce qu’elle a ? Non, ce n’est pas propre… » 538 (Cf. Femmes. Marchandises, Hommes. Irresponsables, Sexes. Femmes)
Harcèlement sexuel (Zola Émile) (2) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« - [Gervaise] Que voulez-vous, il n’a pas sa raison, on ne peut pas se fâcher. Quand je le bousculerais [Coupeau], ça n’avancerait à rien. J’aime mieux dire comme lui et le coucher ; au moins c’est fini tout de suite et je suis tranquille… Puis, il n’est pas méchant, il m’aime bien. […] Oh ! je lui pardonne de bon cœur. Il est comme tous les autres, pardi. Elle disait ces choses mollement, sans passion, habituée déjà aux bordées de Coupeau, raisonnant encore ses complaisances pour lui, mais ne voyant déjà plus de mal à ce qu’il pinçât, chez elle, les hanches des filles. » 539
Harcèlement sexuel (Zola Émile) (3) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« Quand il [Coupeau] avait bien embêté les ouvrières, sa femme [Gervaise] lui donnait vingt sous pour qu’il débarrassât le plancher. » 540
Harcèlement sexuel (Zola Émile) (4) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« Elle [Gervaise] s’était levée, en comprenant que Goujet la croyait mise avec Lantier, comme le quartier l’affirmait. Et les bras tendus, elle cria :
‘- Non, non, je vous le jure… Il me poussait, il allait m’embrasser, c’est vrai mais sa figure n’a pas même touché la mienne, et c’était la première fois qu’il essayait… […]
Cependant le forgeron hochait la tête. Il se méfiait parce que les femmes disent toujours non. » 541
Harcèlement sexuel (Zola Émile) (5) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« Mais voilà que, dans l’allée, elle [madame Lerat] aperçut le monsieur planté là, comme un cierge, encore en train de jouer de la prunelle avec Nana ! La petite devint très rouge. Sa tante lui prit le bas d’une secousse, la fit trotter sur le pavé, tandis que le particulier emboîtait le pas. Ah ! le matou venait pour Nana ! Eh bien ! c’était gentil, à quinze ans et demi, de traîner ainsi des hommes à ses jupes. Et madame Lerat, vivement, la questionnait. Oh ! mon Dieu ! Nana ne savait pas : il la suivait depuis quinze jours seulement, elle ne pouvait plus mettre le nez dehors, sans le rencontrer dans ses jambes. […] » 542
-------------
X. Violences patriarcales :
Violences patriarcales :
Violences patriarcales (1) : Focaliser les critiques féministes sur « les violences faites aux femmes » (elles-mêmes de plus en plus atomisées, plus en plus fréquemment dissoutes dans les violences qualifiées de « sexuelles » et ou « sexistes »), c’est - faute de précisions plus rigoureuses - ne focaliser l’attention que sur certaines des modalités d’expression des violences [dans le patriarcat]. Et, dès lors, c’est sinon s’interdire, du moins, étroitement limiter, circonscrire les analyses en termes de violences du patriarcat, lui-même adossé sur les violences, légales comprises, inhérentes à tous les systèmes de domination.
* Ajout. 10 juin 2021. George Eliot [1819-1880], dans Félix Holt, le radical, auteure de :
« Bien sûr, bien sûr, je suis radical. Je suis radical seulement lorsqu’il s’agit d’éradiquer les injustices. […] Je retire les poutres qui sont pourries, dit Harold, secrètement amusé et je les remplace par du chêne neuf, c’est tout. » 543
Violences patriarcales (2) : Une critique féministe des « violences faites aux femmes » doit avoir pour ambition d’empêcher qu’elles ne soient dissoutes dans le cadre des violences politiques, sociales, étatiques, inhérentes à, consubstantielles à tout système de domination. Le processus est d’ores et déjà extrêmement avancé.
Violences patriarcales (3) : Ces violences à l’encontre des femmes ne sont pas des expressions, des manifestations pathologiques, explicables, sinon excusables, mais les expressions, les manifestations sinon normales, cohérentes, logiques, du moins incompréhensibles si elles ne sont pas resituées dans ce contexte patriarcal qui seul leur donne sens et significations. Quant à l’expression elle-même - une avancée majeure eu égard à « violences faites aux femmes » - elle n’est pas, pour autant, adéquate ; elle permet en effet que soient amalgamées les violences des États et celles des hommes [patrons, religieux, pères, maris, amants, inconnus, proxénètes…] et donc que les différents systèmes de domination [familialistes, capitalistes, religieux, proxénètes…] soient amalgamés. Dès lors la confusion qui est à son comble contraint à se poser la question : le terme de « violence » est-il un concept rigoureux, approprié donc ? Non. Lorsque l’on peut invoquer les « violences à Gaza » et les « violences dans le couple », ou « les violences faites aux femmes et aux noirs », etc.…544 c’est que le terme est inadéquat. Doit-il être abandonné ? Oui. Mais pour cela, il faut définir ce qu’est le patriarcat et clarifier ce que l’on doit précisément définir par violences patriarcales.
Afin d’en retarder l’échéance, on nous impose « la violence genrée » … et « le fémi[ni]cide ».
Violences patriarcales (4) : Cesser de s’interroger sur le degré de conscience que les hommes auraient - ou non - de leurs violences ; s’interroger, les interroger sur les droits qu’ils estiment légitimes de s’attribuer, et sur les fondements qui les légitimeraient. Seule une analyse fondée sur la prise en compte première de patriarcat est à même d’y parvenir ; et c’est là que réside la spécificité des violences à des hommes à l’encontre des femmes et si souvent, en sus, des enfants ; elles ne prennent leur signification et ne peuvent donc cesser que lorsque l’on reconnaitra que le monde est patriarcal.
Violences patriarcales (5) : En règle - quasi - générale, lorsqu’une femme tue un homme, elle dénonce, révèle le patriarcat, la domination masculine et les innombrables violences qui leur sont consubstantielles ; lorsqu’un homme tue une femme, il conforte comme toujours, révèle - mais encore si peu -, le patriarcat, la domination masculine et les innombrables violences qui leur sont consubstantielles.
Violences patriarcales (6) : Les hommes violentent les femmes et les enfants parce qu’ils les ont sous la main, parce qu’ils se contentent de ce qu’ils ont à se mettre sous la dent, parce que les boucs émissaires sont tout près, parce que les dangers de contestations sont faibles, parce que pendant des siècles ils ont en eu le droit. (Cf. Relations entre êtres humains. « Bouc émissaire »)
Violences patriarcales (7) : Dénoncer les violences du patriarcat, ce n’est pas dénoncer le patriarcat. Ce peut même s’interdire de l’analyser.
Violences patriarcales (8) : Les violences patriarcales comme constitutives de la perpétuation de l’ordre établi.
Par ordre chronologique. Violences patriarcales :
Violences patriarcales (Ségur Comtesse de) : 1863. La comtesse de Ségur [1799-1874], dans Le général Dourakine, auteure de ces quelques échanges :
- Le général Dourakine : « Derigny […] allez dire qu’on donne cent coups de bâton à ce coquin, ce voleur […]. »
- Le général Dourakine : « Ma chère amie [madame Papofsky] … Si pendant votre séjour ici, j’apprends que vous avez fouetté, maltraité vos enfants ou vos femmes, je vous en témoignerai mon mécontentement… dans mon testament. »
- Madame Papofsky : « Mon bon oncle, faites comme vous voudrez ; soyez sûr que je ne … »
- Le général Dourakine : « Madame, vos enfants sont abominablement élevés ! Vous en faites des tyrans, des sauvages, des hypocrites ! Je ne veux pas de ça chez moi, entendez-vous ! Vous et vos méchants enfants, vous troublez la paix de ma maison… […] »
- Madame Papofsky : « Je suis désolée, mon oncle ! désolée de cette scène ! je les fouetterais tous si vous me permettez ; fouettez-les vous-mêmes si vous le préférez. Ils ne recommenceront pas, je vous le promets… […] » 545
N.B. Présentation - mal nommée - dans le cadre d’un livre justifiant le servage et tout imprégné, sous de multiples formes (coups de fouets, de pieds, de bâton, knout, supplice, menaces de déportation en Sibérie…) par plusieurs personnes, au premier chef le général Dourakine, dans de nombreuses sphères (familiales, politiques, sociales, économiques…) (Poursuivre) (Cf. Politique. Servage, Patriarcat. Servage, Violences à l’encontre des enfants)
* Ajout. 1er avril) 2024. Sylvie Bermann, ambassadrice de France, notamment à Moscou, dans l’émission À voix nue de France Culture, évoque dans son enfance l’influence positive qu’eut sur elle la lecture du Général Dourakine de la comtesse de Ségur, qu’elle juge aujourd’hui « un peu naïf, un peu bête », sans aucune référence à ses multiples actions, expressions, manifestations, bien féodales, d’autoritarisme, de violences.
Violences patriarcales (Tchékhov Anton) : 1889. 1892. 1894. Anton Tchékhov [1860-1904] écrit :
- le 2 janvier 1889, à son frère Alexandre :
« Je te demande de te souvenir ce qu’est le despotisme et le mensonge qui ont ruiné la jeunesse de notre mère. Le despotisme et le mensonge ont défiguré notre enfance à un point qu’il est écœurant et effrayant d’évoquer. Souviens-toi de l’horreur et du dégoût que nous éprouvions quand notre père faisait une histoire pendant le dîner trop salé, ou traitait notre mère d’imbécile. Le despotisme est triplement criminel. Souviens-toi qu’il vaut mieux être victime que bourreau. »
- Anton Tchékhov lui écrira aussi :
« Notre grand père était battu par les seigneurs et le dernier des fonctionnaires pouvait lui casser la gueule. Notre père était battu par notre grand père et nous par notre père. De quels serfs, de quel sang avons-nous hérité ! »
- le 9 mars 1892, Anton Tchékhov écrit, dans une lettre à I. Chtcheglov [?-?] concernant son père :
« Je me souviens qu’il commença à faire notre éducation, ou plus simplement, à me battre, quand je n’avais pas encore 5 ans. En me réveillant, chaque matin, je pensais avant tout : Serais-je battu aujourd’hui ? »
- le 27 mars 1894, Anton Tchékhov écrira, dans une lettre à Boris Souvarine [1895-1984] :
« La morale tolstoïenne a cessé de me toucher jusqu’au fond de l’âme, je n’ai plus de sympathie pour elle, ce qui, sans doute, est injuste. Mais c’est parce que le sang qui coule dans mes veines est un sang de moujik et qu’on ne peut pas m’étonner avec des vertus de moujik. Dès mon enfance, j’ai appris à croire au progrès et n’aurait pas pu ne pas y croire car la différence entre l’époque où on me fouettait et celle où on avait cessé de me fouetter était terrible. […] » 546 (Cf. Hommes, Famille, Patriarcat. Pères, Politique. Servage)
Violences patriarcales (Pédagogie) : 2003. Pendant longtemps, la seule pédagogie enseignée pour s’en prémunir, dans la famille et dans la rue, aux petites filles, notamment dans la bourgeoisie, fut celle rapportée par Marie-Louise Girod [1915-2014], au début du XXème siècle. Elle rappelle les propos de son frère :
« Mademoiselle sort toute seule ! Tu n’as pas peur des vilains messieurs ? Attention, n’accepte pas de bonbons… » et ceux de sa mère :
« Surtout ne parle à personne ! Et surtout ne t’arrête pas devant une bijouterie, un monsieur inconnu pourrait te dire : ’Choisissez mademoiselle !’ » 547 (Cf. Enfants. Pédagogie)
Violences patriarcales. Résistance :
Violences patriarcales (Résistance) (1) : Ne pas formellement résister, c’est tout simplement aussi défendre sa vie, la sidération n’en étant qu’une des modalités d’expression de cet instinct de vie dans un monde patriarcal qui pose l’accord comme la norme.
Violences patriarcales (Résistance) (2) : (15 août) 1905. Cf. Georges Clemenceau [1841-1929], auteur, dans L’Aurore, de :
« […] Qui vit, résiste ; qui ne résiste pas se laisse dépecer par morceaux. » 548 (Cf. Êtres humains)
Violences patriarcales (Weinstein Harvey) : Cf. Patriarcat. Weinstein Harvey
-------------
1 Le Monde, Patrick et Isabelle Balkany, Les amis du Président. 29 juin 2009
2 Le Figaro, Isabelle Balkany, L’indéfectible épouse, pour le meilleur et pour le pire. 13 mai 2019
3 In : Honoré de Balzac, La comédie humaine. XII. La Pléiade. 1972p. 1981. p.44
4 Russel Banks, Continents à la dérive. Actes Sud. 542p. 2016. p.278
5 Georges Bataille, Ma mère, 10/18. Jean-Jacques Pauvert. 1966. p.126
6 Samira Bellil, Dans l’enfer des tournantes. Éditions France loisirs. 234p. 2003. p.45
7 William Boyd, Les nouvelles confessions. Points, Éditions du Seuil. 623p. 1990. p.528, 537
8 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus Classiques. 615p. 2006. p.228
9 France Culture, Brigitte Bardot. 13 août 2020
10 In : Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe. Côté-Femmes. 291p. 1991. p.149
11 Alexis de Tocqueville, Voyages en Angleterre et en Irlande. Idées. Gallimard. 376p. 1967. p.312
12 Gavi / Sartre / Victor, On a raison de se révolter. La France sauvage. Gallimard. 378p. 1974, p.116
13 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.1045
14 France Inter, Affaires sensibles. La torture pendant la guerre d’Algérie. 17 mars 2022 [1ère diffusion. 9 juin 2016]
15 France Culture, Le viol. Une histoire de domination. 10 octobre 2022 [1ère diffusion. 7 décembre 2020]
16 Source oubliée de noter
17 Fannie Flagg, Beignets de tomates vertes. J’ai lu. 475p. 2009. p.232, 233
18 Gustave Flaubert, Correspondance. III. (janvier 1859-décembre 1868). La Pléiade. 1727p. 1991. p.162
19 Gustave Flaubert, Correspondance. IV. (janvier 1869-décembre 1875). La Pléiade. 1484p. 1997. p.984, 987
20 Gustave Flaubert, Correspondance. V. (janvier 1876-mai 1880). La Pléiade.1556p. 2007. p.493
21 Matthieu Galey, Journal Intégral. 1953-1986. Bouquins. Robert Laffont. 983p. 2017. p.424
22 Gandhi, Tous les hommes sont frères. Idées. Gallimard. 313p. 1981. p.85, 181, 278, 301
23 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.573
24 Mouloud Feraoun, Journal. 1955-1962. Éditions du Seuil. 348p. 1962. p.209, 210
25 Jacques Vergès, Michel Zavrian, Maurice Courrégé, Le droit et la colère. Les Éditions de minuit. 174p. 1960. p.16
26 Louis Guilloux, Le sang noir. Folio. Gallimard. 1982. 631p. p.420
27 Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit. Idées. NRF. 380p. 1963. p.129
28 Edgar Morin, Au rythme du monde. Un demi siècles d’articles dans Le Monde. Archipoche. 588p. 2015. p.332
29 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.272
30 France Culture, Chirurgie réparatrice au Brésil. 16 septembre 2015
31 In : Clémentin Autain, Elles se manifestent. Viol, 100 femmes témoignent. Don Quichotte. 185p. 2013.p.62, 63
32 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022. p.241, 242, 1388
33 Ekaterina Olitksaïa, Le sablier. Les éditions du bout de la ville. 656p. 2024. p.599, 600
34 TV5. Monde, 12 Janvier 2018
35 Cf. Marie-Victoire Louis, Les mots du viol. Le langage, révélateur de la légitimation de la violence sexuelle http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=451&themeid=450
36 Bernard Lemettre, Je veux juste qu’elles s’en sortent. Mon combat pour briser les chaînes de la prostitution. Michel Lafon. 253p. 2015. p.133
37 Radio. Free. Dom, Nouvelle session d’Assises : Viol en tournante d’une adolescente de 16 ans après une soirée sur la plage de Saint-Pierre. 3 avril 2017
38 Voltaire, Correspondance. XII. (janvier 1775-juin 1777). La Pléiade. 1361p. 1987. p.722, 718
39 In : Denis Langlois, Les dossiers noirs de la Justice française. Combats. Le Seuil. 222p. 1974. p.93, 94
40 R.F.I, Priorité santé. Violences faites aux femmes. 26 décembre 2014
41 France Culture, Condamnés / victimes : un dialogue possible. Une histoire de la justice restaurative. 20 novembre 2017
42 France Culture, 2 septembre 2015. 06h. 20
43 Le Canard enchaîné, Et Macron créa un nouveau délit ! 21 octobre 2020. p.2
44 Le Figaro avec AFP, Une maternité pour les femmes victimes de viols ouvre à Londres. 29 juillet 2016
45 Moncef Marzouki, L’invention d’une démocratie. Les leçons de l’expérience tunisienne. La Découverte. 177p. 2013. p.121
46 Guy de Maupassant, Une vie. p.50 (sur le net)
47 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. II. La Pléiade. 1308p. 1939. p.173
48 André Morali-Daninos, Sociologie des relations sexuelles. Que sais-je ? PUF. 126p. 1982. p.15
49 Mo Yan, Beaux seins, belles fesses. Éditions du Seuil. Points. 895p. 2004. p.117, 244
50 France Culture, Une fois pour toutes, Interview d’Aldo Naouri. 6 avril 2013. 12h 30
51 Henri Torrès, Le procès des pogromes. Plaidoirie et Témoignages. 1927. Ressouvenances. 270p. 2010. p.80
52 Émile Zola, Correspondance. X. 1899-1902. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 647p. 1995. p.198 et note 3
53 In : Préface. Marcel Proust. Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.IX
54 Paris Luttes. Info, ‘Une femme violée à Calais. Mastication féministe et antifasciste’. 21 octobre 2016
55 Arundhati Roy, Mon cœur séditieux. NRF. Gallimard. 1050p. 2020. p.192
56 Claude Roy, Nous. Folio. Gallimard. 564p. 1980. p.224
57 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les acteurs. Bouquins. Robert Laffont. 987p. 1991. p.193, 976
58 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008 p. 2003. p.78, 484
59 Le Monde, Odon Vallet, Le vice et la vertu. 6 juin 2002
60 Jacques Vergès, Beauté du crime. Plon. 214 p.1988. p.67, 68
61 Le Figaro, Deux hommes interpellés pour le braquage d’un couple qui a tourné au viol. 2 décembre 2014
62 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Garnier Flammarion. 512p. 1967. p.428
63 Le Figaro, Procès d’André Hazout. 12 ans de prison requis. 19 février 2014 ; André Hazout : Je ne suis pas un violeur. 20 février 2014 ; Le gynécologue André Hazout, condamné à 8 ans de prison pour viols. 20 février 2014
64 Docteur Gilbert Tordjman, La femme et son plaisir. Les éditions de la Seine. Succès du livre. 1989. 395p. p.332, 333, 336, 338
65 France Culture, Prendre en charge les agresseurs. 5 janvier 2022
66 Svetlana Alexievitch, La guerre n’a pas un visage de femme. J’ai lu, 415p. 2016. p.25
67 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.(à retrouver)
68 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.112
69 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.76
70 Émile Zola, Germinal. Fasquelle. Le livre de poche. 503p. 1969. p.125, 128
71 Éric Zemmour, Le premier sexe. Denoël. 135p. 2006. p.24
72 Panoramiques, Bizutages. Réuni (?) par Marie-Odile Dupé. Arléa-Corlet. n°6. 4ème trimestre 1992. 227p.
73 In : Benoît Bréville, Le mirage de l’apaisement. Le Monde Diplomatique. août 2024
74 André Breton, Manifeste du surréalisme. Idées. Gallimard. 188p. 1973. p.78
75 Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution de France. Pluriel. 816p. 2011. p.104, 105
76 Le Figaro, Angela Merkel n’a pas perçu la différence entre Islam et Islam politique. 23 septembre 2017
77 France Culture, À voix nue. Dounia Bouzar, envers et contre tous. 13 juin 2016
78 France Inter, La librairie francophone. 30 janvier 2021
79 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.344
80 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468 p. 1997. p.786
81 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468 p. 1997. p.853
82 Pascal Bruckner, Un bon fils. Grasset. 251p. 2014. p.118, 119
83 Le Monde Diplomatique, Guerres sans fin contre les Palestiniens. juin 2021. p.1
84 André Breton, Anthologie de l’humour noir. Jean-Jacques Pauvert. Le livre de poche. 1966. 446p. p.271, 272
85 Kropotkine, La morale anarchiste. 1889. p.22. Lisible sur Wikisource
86 In : Studs Terkel, Hard times. Histoires orales de la grande dépression. Éditions Amsterdam. 596p. 2009. p.488
87 George Bernanos, Journal d’un curé de campagne. Plon. 160ème mille. 366p. 1936. p.72, 73
88 El Watan, Violences contre les femmes : un bon projet, une loi inapplicable. 10 octobre 2014
89 In : Marat. Écrits. Présenté par Michel Vovelle. Messidor / Éditions sociales. 251p. 1988. p.69
90 Le Monde, Emma Thomson, le féminisme ‘comme un devoir’. 20 août 2019
91 Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des romains et leur décadence. 188p. 1968. p.117
92 Friedrich Nietzsche, Mauvaises pensées choisies. Tel. Gallimard. 612p. 2002. p.173
93 Anaïs Nin, Journal. 1939-1944. Le livre de poche. 508p. 1971. p.56, 57
94 Blaise Pascal, Pensées. Éditions du Seuil. 442p. 1966. p.169
95 Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. 1818p. 1968. Librairie Droz. note 2191 [?]. p.1402
96 Europe 1, Alexandre Benalla, avant la révélation de l’affaire : ‘J’ai pété les plombs’. 22 juillet 2018
97 France Inter, Affaire sensibles. Le prix humain de la crise. 18 octobre 2016
98 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse. Garnier Flammarion. 610p. 1967. p.119
99 Arundhati Roy, Le Ministère du Bonheur Suprême. Folio. Gallimard. 554p. 2018. p.392
100 Léon Tolstoï, Souvenirs. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.417
101 Fannie Flagg, Beignets de tomates vertes. J’ai lu. 475p. 2009. p.279
102 Georges Simenon, Mémoires intimes. Presses de la cité. 753p. 1981. p.311
103 Libération, Plus de 600 signalements de violences sexuelles dans le sport français en deux ans. 9 mars 2022
104 William Styron, Le choix de Sophie. I. Folio. Gallimard. 456p. 1990. p.380
105 In : Victoria Vanneau. La paix des ménages. Histoire des violences conjugales. XIXème-XXIème siècle. Anamosa. 363p. 2016. p.268, 269, 270
106 Le Monde, Un hiver dans la vallée d’Aspe. 24 mars 2017
107 Anton Tchékhov, Trois années. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.450
108 In : Studs Terkel, « La bonne guerre ». Histoires orales de la Seconde guerre mondiale. Éditions Amsterdam. 378p. 2006. p.89
109 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. II. La Pléiade. 1399p. 1980. p.1048
110 Jules Vallès, Choix d’articles. In : Oeuvres I. 1857-1870. La Pléiade. 1781p. 1975. p.464
111 Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église catholique, Les violences sexuelles dans l’Église catholique. France. 1950-2020. octobre 2021. p.3
112 La Croix, ‘C’est une déflagration pour tout le monde’. 6 octobre 2021. p.7
113 Le Canard enchaîné, Les petites cachoteries de l’évêché [de Paris]. 14 décembre 2022. p.4
114 France Culture, Répliques. 8 janvier 2022 [Ière diffusion. 24 novembre 2001]
115 Marquis de Sade, Lettres à sa femme. Les épistolaires. Choix, préface et notes de Marc Buffat. Actes Sud. février 1997
116 Journal de l’abbé Mugnier. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.314
117 Laclos, Œuvres. 1979. 1713p.
118 In : Le Point. 8 février 2020
119 Gilbert Lely, Sade. Idées. NRF. 375p. 1967. p.28
120 Gilbert Lely, Sade. Idées. NRF. 375p. 1967. p.185
121 Sade, Histoire de Juliette. In : Œuvres. II. La Pléiade. 1638p. 1998. p.194
122 L’œuvre du marquis de Sade, Introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire. Bibliothèque des curieux. Collection. Les maîtres de l’amour. 1909. p.17, 88. In : Michel Delon, responsable de l’édition de Sade dans la Pléiade. Œuvres. III. La Pléiade. 1638p. 1998. p.1383
123 Guillaume Apollinaire, Les onze mille verges. 1907. Wiki source. 50p.
124 Thomas Schlesser. In : Dictionnaire de la pornographie. (Sous la direction de Philippe Di Falco) PUF. 581p. 2005. p.36, 37
125 Georges Bataille, Critique, Emily Brontë. n°117. février 1957. In : Emily Brontë, Hurlevent. Folio. Classique. Gallimard. 620p. 2018. p.609
126 Pascal Bruckner, Un bon fils. Grasset. 251p. 2014. p.169
127 In : Gilbert Lely, Sade. Idées. NRF. 375p. 1967. p.275
128 In : Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. note. p.1232
129 André Breton, Anthologie de l’humour noir. Le livre de poche. 446p. 1970. p.39
130 France Culture, Ce que les Surréalistes doivent au marquis de Sade. 17 avril 2022 [1ère diffusion. 9 janvier 2002]
131 Albert Camus, L’homme révolté. Idées. Gallimard. 372p. 1972. p.56, 58, 65
132 In : Marie-Françoise Hans, Gilles Lapouge, Les femmes, la pornographie, l’érotisme. Seuil. 391p. 1978. p.97
133 France Culture, Les vendredis de la philosophie. Libertins dans l’âme. 28 janvier 2005 [Rediffusion. 10 novembre 2020]
134 Andrea Dworkin, Pornography. Men possessing women. 1981. 1ère édition. The women’s press Ltd. 304p ; Andrea Dworkin, Intercourse. Arrow books. 1988. 326 p.
135 In : Gustave Flaubert, Correspondance. Index. La Pléiade. 485p. 2007. p.390
136 Gustave Flaubert, Correspondance. V. (janvier 1876-mai 1880). La Pléiade. 1556p. 2007. p.176
137 France Culture. Vers un printemps des femmes arabes. 5 février 2013
138 In : Gilbert Lely, Sade. Idées. NRF. 375p. 1967. p.42
139 Sigmund Freud, Le malaise dans la culture. GF Flammarion. 218p. 2010. note. p.144
140 Dictionnaire de la violence, Sous la direction de Michela Marzano. Item : Sade, Donatien Alfonse François, Marquis de, 1740-1814. PUF. 1546 p. 2011, p.1156, 1157
141 France Culture, Ce que les Surréalistes doivent au marquis de Sade. 17 avril 2022 [1ère diffusion. 9 janvier 2002]
142 Gilbert Lely, Sade. Idées. NRF. 375p. 1967. p.280
143 Le Monde, Jean Birnbaum. Sade ou l‘érotisme de la pensée. 5 décembre 2014
144 In : La violence. Actes du colloque de Milan. Généalogie de la politique. 1977. 10/18. 376p. 1978. p.206, 213
145 Alice Miller, C’est pour ton bien. In : L’essentiel d’Alice Miller. Flammarion. 1002p. 2011. p.285
146 Maurice Nadeau, Serviteur ! Un itinéraire critique à travers livre et auteurs depuis 1945. Albin Michel. 423p. 2002. p.58 à 62, p.174 à 183, p.133
147 AH ! NANA. De Sade à Masoch en passant par Robbe-Grillet. Questions posées à Alain Robbe-Grillet par Isabelle Sacuto. Édité par les Humanoïdes associés. décembre 1977. p.20, 21
148 Nicolas Waquet, Introduction, La Vénus à la fourrure, Petite Bibliothèque Payot. Rivages. 2009. p.8
149 France Culture, Le bon plaisir. Jean Starobinski. 28 septembre 1985. [2ème diffusion. 23 janvier 2021]
150 France Culture, Ce que les Surréalistes doivent au marquis de Sade. 17 avril 2022 [1ère diffusion. 9 janvier 2002]
151 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008 p. 2003. p.679, 680, 688
152 Raoul Vanegeim, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Gallimard. 292p. 1975. p.215
153 Michel Winock, Jeanne et les siens. Seuil. 265p. 2003. p.11
154 Michel Leiris, Journal. 1922-1989. Quarto. Gallimard. 1052p. 2020. p.601
155 In : Pierre Desgraupes, Le mal du siècle. Grasset. 346p. 1977. p.240
156 George Bernanos, Journal d’un curé de campagne. Plon. 160ème mille. 366p. 1936. p.155
157 Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Au coin de la rue, l’aventure. Éditions du Seuil. Points. 275p. 1982. note 1. page 91
158 Robert Debré, Témoignage. L’honneur de vivre. Stock. Hermann. 462. 1974. p.260
159 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus Classiques. 615p. 2006. p.354
160 France Culture, Édouard Durand. 20 novembre 2021
161 France Culture, Édouard Durand : La justice à hauteur d’enfant. 10 mai 2022
162 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022. p.191, 192
163 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022.
164 Michel Leiris, L’âge d’homme, précédé de L’Afrique fantôme. La Pléiade. 1387p. 2014. p.224
165 Comtesse de Ségur, Pauvre Blaise. Éditions Carrefour. 250p.1994
166 (Sous la direction de) Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset, Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir. PUF. 773p. 2022. p.179
167 Charles Dickens, David Copperfield. Le livre de poche. Classique. 1024p. 2008. p.149
168 Charles Dickens, Les grandes espérances. Folio. Classique. Gallimard. 741p. 1999. p.48
169 Fiodor Dostoïevski, L’adolescent. Folio. Classique. Gallimard. 649p. 2023. p.427
170 Fiodor Dostoïevski, Journal d’un écrivain. La Pléiade. 1611p. 1972. p.1097
171 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.191
172 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.337
173 Gustave Flaubert, Correspondance. V. La Pléiade. 1556p. 2007. p.515, 1324
174 Le Parisien, Un accusé ‘ pervers’ et ’peu ouvert aux autres’. 3 mai 2017
175 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXI. 992p. 1986. p.479
176 Jacques Loew, Journal d’une mission ouvrière (1941-1959). Les Éditions du Cerf. 476p. 1959. p.3,
177 Gustave Flaubert, Correspondance. III. (janvier 1859-décembre 1868). La Pléiade. 1727p. 1991. p.100
178 Matthieu Galey, Journal Intégral. 1953-1986. Bouquins. Robert Laffont. 983p. 2017. p.376
179 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.288,289
180 André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.90
181 André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.(à retrouver)
182 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.633
183 France Culture, La compagnie des auteurs. André Gide. Le salut par le Journal. 25 mai 2017
184 André Girard, Dictionnaire de l’anarchie. Honoré Champion. 376p. 2021. p.115
185 Antonio Gramsci, Lettres de prison, Éditions Sociales. 310p. 1953. p.119, 120
186 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.106
187 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.16
188 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Mercure de France. 1304p. 2013. p.459, 460
189 Jean-Jacques Rousseau, Les confessions, In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.340
190 AFP, Des députés veulent interdire toute forme de violence faite aux enfants. 20 avril 2016
191 Lou Andreas Salomé, Ma vie. PUF. Perspectives Critiques. 315p. 1978. p.11, 45
192 Sándor Márai, Les confessions d’un bourgeois. Le livre de poche. Albin Michel. 574p. 1993. p.111
193 Le Canard enchaîné, Sorj Chalandon. Voleurs d’enfants. 20 mars 2019. p.7
194 Françoise Giroud, La rumeur du monde. Le livre de poche. Arthème Fayard. 284p. 1999. p.199
195 Leïla Sebbar, On tue les petites filles. Stock 2 / Voix de femmes. 357p. 1978. p.255 , 291
196 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.262
197 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.480
198 France Culture, Esprit de justice. Dans la tête d’un pédophile. 17 février 2021
199 Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.332
200 Jean-Claude Brialy, Le ruisseau des singes. Pocket. Robert Laffont. 510p. 2001. p.49, 55
201 France Inter, Affaires sensibles. Le grand préfet et les déracinés. 30 août 2018
202 Claude Roy, Permis de séjour. 1977-1982. Folio. Gallimard. 372p. 1985. p.160
203 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. I. La Pléiade. 1418p. 1978. p.778, 779, 780
204 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXI. 992p. 1986. p.153
205 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIII. 781p. 1989. p.233, 234
206 Libération, Enfants Migrants. Trump face à la honte. 20 juin 2018
207 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.765, 764
208 Cesare Beccaria, Des délits et des peines. Genève, Droz, 1965. p.146. Édité plus tard par Garnier Flammarion en 1991
209 In : Chow Ching lie, Le palanquin des larmes. Dans la chine de Mao, l’échappée d’une femme. J’ai lu. 382p. 2001. p.257
210 In : Voltaire, Correspondance. XIII (juillet 1777-mai 1778). La Pléiade. 1203p. 1992. p.271
211 Choisir de donner la vie, Colloque international de Choisir, La cause des femmes des 5, 6, 7 octobre 1979 à l’Unesco. Idées. Gallimard. 566p. 1979. p.82
212 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022. p.343, 1400
213 Le Figaro. AFP, Bébé jeté du 5ème étage : la lycéenne écrouée. 15 octobre 2014
214 Abbé Casimir Dugoujon, Lettres sur l’esclavage et l’abolition dans les colonies françaises, 1840-1850). Présentation de Nelly Schmidt, L’Harmattan. 254p. 2016. p.75, 76
215 Jules Michelet, La sorcière. Garnier Flammarion. 309 p.1966. note 1. p.223
216 AFP, Une mère condamnée à 15 ans. 18 décembre 2014
217 Le Figaro. AFP. Reuters, Infanticide en Australie : la mère arrêtée. 20 décembre 2014
218 Annie Goldmann, Les filles de Mardochée. Histoire d’une émancipation. Denoël / Gonthier. 153p. 1979. p.44
219 Léon Tolstoï, La sonate à Kreuzer. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.1110
220 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.626
221 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.379
222 Robert Beck (Iceberg Slim), Pimp. Mémoires d’un maquereau. Éditions de l’Olivier. 411p. 2008. p.243 à 245
223 Sources de Choisir (Revue de l’association Choisir la cause des femmes. Présidente : Gisèle Halimi) non vérifiées. In : Eva Thomas, Le viol du silence. Aubier. 230p. 1986. p.218
224 Radio Libertaire, 18 septembre 2014. 17h
225 Gramsci dans le texte. (Réalisé sous le direction de François Ricci) Éditions sociales. 717p. 1977. p.690
226 Le Figaro, Procès de l’octuple infanticide : le lourd secret de la famille Cottez. 26 juin 2015
227 Vladimir Nabokov, Lolita. Gallimard. 468 p. 2001. p.187
228 France Culture, LSD. Écrire l’amour, La rencontre. 19 février 2018
229 Bruno Bettelheim, L’amour ne suffit pas. Le livre de poche. 544p. 1994. p.466, 467, 478, 479
230 Sigmund Freud, Ma vie et la psychanalyse. Idées. Gallimard. 184p. 1981. p.44
231 Huffington Post.fr, Jeffrey Masson, Ancien psychanalyste, ancien co-directeur des archives Freud. Ces psychanalystes qui nient l'inceste. 12 octobre 2012
232 Niki de Saint Phalle, Tous les hommes sont des violeurs. In : Toi, mon père. Albin Michel. 316p. 2002. p.110 à 113
233 Virginie Talmont, Inceste. Récit. J’ai lu. 190p. 2004. p.133
234 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1765-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.231
235 Cf. Marie-Victoire Louis, Violences des hommes à l’encontre des femmes. http://www.marievictoirelouis.net/index.php?id=331
236 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. II. La Pléiade. 1399p. 1980. p.501
237 Paris Match, Bonnes feuilles. 30 janvier 2020
238 Libération, Yogi Adityanath, un moine extrémiste à la tête du plus grand état de l’Inde. 4 avril 2017
239 Louis Aragon, Les voyageurs de l’impériale. Folio. Gallimard. 689p. 1948. p.314
240 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.252
241 In : Michel Bakounine, Théorie générale de la révolution. Les nuits rouges. 383p. 2001. p.293
242 Télérama, Jeanne Balibar : ‘On me disait que c’est comme ça avec toutes les actrices’. 15 octobre 2021
243 Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Le livre de poche. 366p. 1972. p.206
244 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1969. p.250
245 Honoré de Balzac, La femme de tente ans. Garnier-Flammarion. 242p. 1965. p.110
246 Robert Beck (Iceberg Slim), Pimp. Mémoires d’un maquereau. Éditions de l’Olivier. 411p. 2008. p.32
247 Nina Berberova, C’est moi qui souligne. Actes Sud / Labor / L’aire. 609p. 1990. p.125
248 Panoramiques, Bizutages. Arléa-Corlet. 231p. 1994. p.50
249 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. note 1. p.422
250 Adèle Toussaint-Samson, Une Parisienne au Brésil. Paris. Ollendorff. 233p. 1883. p.82 à 86
251 Cardinal de Retz, Mémoires. La Pléiade. 1003p. 1950. p.564, 565
252 Edmund Burke, Première lettre sur la paix régicide. In : Réflexions sur la révolution de France. Pluriel. 816p. 2011. p.518
253 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe. II. La Pléiade. 1496p. 1988. p.382
254 BFM-TV. 23 août 2018
255 BFM-TV. 6 septembre 2018. 11h 30
256 France Culture, LSD. Raconter le monde. Une littérature de voyages. 3 juin 2019
257 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.215, 216
258 In : Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe. Côté-Femmes. 291p. 1991. p.216
259 In : Sporenda. Interview n°1. Samira Bellil. Site d’Isabelle Alonso
260 « Faire du consentement libre et éclairé à l’acte sexuel la norme » - Audrey Darsonville, Magali Lafourcade, François Lavallière, Catherine Le Magueresse et Élodie Tuaillon-Hibon. In : La marche mondiale contre les femmes. 11 novembre 2024
261 Dominique Fernandez, Mère Méditerranée. Grasset. 268p. 1969. p.62
262 France Culture, Le crime d’Orcival. 20 août 2020
263 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.122, 123
264 France Culture, Cultures Monde. De Madrid à Beyrouth : combatte des violences sexistes. 10 mars 2021
265 Charles Dickens, Les grandes espérances. Folio. Classique. Gallimard. 741p. 1999. p.92, 93
266 France Culture, Violées. Une histoire de domination. Poser ses mots. 10 octobre 2022 [1ère diffusion. 7 décembre 2020]
267 Fiodor Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts. 10/18. 311p. 1962. p.9
268 Fiodor Dostoïevski, Journal d’un écrivain. La Pléiade. 1611p. 1972. p.25
269 Alexandre Dumas fils, Le dossier ‘Tue-la !’. Édouard Aubanel, Avignon. 227 p. 1969. p.135
270 In : Yvette Roudy, Mais de quoi ont-ils peur ? Un vent de misogynie souffle sur la politique. 218 p. 1995. p.89
271 Princesse de Metternich, ‘Je ne suis pas jolie, je suis pire’. Souvenirs 1859-1871. Le livre de poche. 286p. 2010. p.146
272 La Croix, Comment les catholiques de France traversent la crise. 7 juin 2019
273 Cf. notamment Marie-Victoire Louis, «Lettre à Dominique Fougeyrollas». http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=347&themeid=346
274 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social. Folio. Essais. Gallimard. Livre III. 535p. 1993. p.241
275 Maryse Jaspard, Les violences conjugales en Europe. In : Le livre noir de la condition des femmes (dirigé par Christine Ockrent). Document. XO Éditions. 954p. 2007. p.302
276 France Culture, Ping Pong. Nancy Huston & Chloé Delaume. - Sorcières et amazones. 29 septembre 2016
277 Le Monde, Condamné pour violences conjugales, le secrétaire à l’intégration démissionne. 22 juin 2015
278 Le Parisien, L’incroyable erreur de casting du PS. 22 juin 2015
279 Le Canard enchaîné, Femmes abattues. 23 juin 2021. p.7
280 Henry Fielding, Histoire de Tom Jones. Folio. Classique. Gallimard. 1142p. 2007. p.294, 295
281 Histoire de Michèle. Fayard. 175p. 1972. p.11, 12
282 Jean Guéhenno, Journal des années noires. 1940-1944. Gallimard. 346p. 1947. p.325
283 Le Figaro, Une lycéenne dépouillée et jetée dans la Seine. 21 octobre 2016
284 Le Figaro. AFP, Un homme abat sa compagne et se suicide. 1er août 2018
285 France Culture, Turquie. Saint-Sophie, instrument de l’islamo-nationalisme. 9 juillet 2021 [1ère diffusion. 28 août 2020]
286 France Culture, Louise Michel, femme tempête. 16 août 2021
287 Le Monde, Femmes battues : l’indifférence en procès aux Assises du Nord. 25/26 mars 2012 ; TF1. 8 avril 2012. 19 heures ; Depuis lors, un livre est paru qui, notamment, relate le procès : Alexandra Lange, Acquittée. ‘Je l’ai tué pour ne pas mourir’. Michel Lafon. Octobre 2012. (Cf. notamment chapitre I : ‘Acquittez-la !’) 295 p. Réédité dans ‘J’ai lu’. 2013
288 Le Figaro.fr Madame, Luc Frémiot : ‘Il faut intervenir dès la première gifle’. 20 janvier 2014
289 France Inter, 29 décembre 2016. 7h 58
290 Sigmund Freud, Le malaise dans la culture. GF Flammarion. 218p. 2010. p.127
291 Le Figaro, Le Front national s’en prend à la venue de Joey Starr dans le Var. 14 mars 2016
292 France Culture, Une journée avec Serge Gainsbourg. 24 septembre 2020 [1ère diffusion. 3 novembre 1982]
293 Gustave Flaubert, Correspondance. IV. (janvier 1869-décembre 1875). La Pléiade. 1484p. 1997. p.52
294 France Culture, Clap sur Jean-Luc Godard, cinq ans après mai 68. 20 mai 2018 [1ère diffusion. 5 mai 1973]
295 France Culture, Les racines du ciel [« émission consacrée à la spiritualité »] Guy Gilbert, un parcours hors du commun. 7 avril 2013
296 In : Gérard Davet, Fabrice Lhomme, « Un président ne devrait pas dire ça», Les secrets d’un quinquennat. Stock. 662p. 2016. p.423
297 Victor Hugo, Les pauvres gens. La légende des siècles. 1859
298 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.1150
299 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.1428
300 Ivan Jablonka, Laëtitia. Éditions du Seuil. 2016. 436p.
301 Jean de La Fontaine, Fables. La femme noyée. Livre III. Fable 16
302 Le Monde Diplomatique, En Russie, le fléau des violences conjugales. décembre 2019. p.17
303 Louise Michel, Souvenirs et aventures de ma vie. La Découverte. Maspero. 437p. 1983. p.324, 325
304 Michel Leiris, L’âge d’homme, précédée de L’Afrique fantôme. La Pléiade. 1387p. 2014. p.105
305 France Culture, Concordance des temps. Du fouet, de la gifle et de la fessée. 19 mars 2022
306 In : Samuel Bamford, La vie d’un radical anglais au temps de Peterloo. Éditions sociales. 442p. 2019. p.8
307 Dominique Fernandez, Mère Méditerranée. Grasset. 268p. 1969. p.197
308 Moncef Marzouki, L’invention d’une démocratie. Les leçons de l’expérience Tunisienne. La découverte. 177p. 2013. p.120
309 Europe 1. Le JDD, Violences sexuelles : Édouard Philippe et Marlène Schiappa répondent aux Nous toutes. 25 novembre 2018
310 Anne Martin-Fugier, Une nymphomane vertueuse. L’assassinat de la duchesse de Choiseul-Praslin. Fayard. 2009. 176p.
311 France Culture, Le cours de l’histoire. L’Iran à la confluence des passions. 21 janvier 2020
312 France Culture, Le cours de l’histoire. Au fin fond de la Sibérie. 7 février 2020
313 France Inter, Louise Mey : ‘La différence de traitement de femmes est systémique’. 6 février 2020
314 France Inter, Là-bas si j’y suis. 4 avril 2013
315 France Culture, Mémoires du siècle. Daniel Meyer. 2 août 1985 [Rediffusion le 10 septembre 2015]
316 France Culture, Fémincides. A quoi a servi le Grenelle contre les violences conjugales ? 9 juin 2021
317 Franceinfo. TV. 31 octobre 2016. 11h 50
318 Alexandre Zinoviev, Les confessions d’un homme en trop. Gallimard. Olivier Orban. Folio. Actuel. Gallimard. 696p. 1990. p.260, 261
319 Libération, Les féministes chinoises donnent de la voix. 26 juin 2014
320 Friedrich Nietzsche, Zarathoustra. (source à retrouver)
321 Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Bouquins. Robert Laffont. Tome.1. 839p. 1986. p.742, note 1. p.743
322 Fatéma Oufkir, Les jardins du roi. Le livre de poche. Michel Lafon. 254p. 2000. p.243
323 El Watan (Algérie), Violences à l’égard des femmes : Que cesse l’impunité ! 4 mars 2015
324 Boris Pasternak, Le docteur Jivago. Folio. Gallimard. 697p. 1972. p.513, 514
325 Pauline Réage, Histoire d’O. Chez Jean-Jacques Pauvert. 247p. 1961. p.X
326 Femmes actuelles. 10 février 2021
327 France Culture, 1913-1915. L’affaire Léo Franck. 10. 11 septembre 2022
328 Le Monde, Violences conjugales : Les premières mesures saluées. 5 septembre 2019
329 Jodi Picoult, Mille petits riens. Traduit de l’américain. Actes Sud. 588p. 2018. p.227, 228
330 Edmund Burke, Réflexions sur la révolution de France. Pluriel. 816p. 2011. p.21
331 Mediapart. Blog de Coralie Miller : Nous accusons. 12 novembre 2019
332 Note à retrouver
333 France Culture, Politique ! 10 avril 2021
334 Pauline Réage, Histoire d’O. Chez Jean-Jacques Pauvert. 247p. 1961. p.132
335 Pauline Réage, Histoire d’O. Chez Jean-Jacques Pauvert. 247p. 1961. p.132
336 Pauline Réage, Histoire d’O. Chez Jean-Jacques Pauvert. 247p. 1961. p. 201, 202
337 Jean Renoir, Pierre-Auguste Renoir, mon père. Folio. Gallimard. 507p. 1981. p.218
338 Voltaire, Correspondance. XI (juillet 1772-décembre 1874). La Pléiade. 1411p. 1986. p.353
339 Voltaire, Correspondance. XII. (janvier 1775-juin 1777). La Pléiade. 1361p. 1987. p.500
340 Le Monde, Des milliers de femmes s’unissent ‘contre les violences’ à l’appel de Muriel Robin. 6 octobre 2018. Sauvons celles qui sont encore vivantes. In : Bulletin de la Marche mondiale des femmes. n° 359. 5 octobre 2018
341 Mary Robinson, Mémoires de Mistriss Robinson. In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.717
342 Mary Robinson, Mémoires de Mistriss Robinson. In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.789
343 Jeanne-Marie Roland, Mémoires particuliers. In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.506
344 Marie d’Agoult. George Sand, Correspondance. Bartillat. 301p. 1995. p.32, 33, 23
345 France Culture, Actualité de George Sand. 4 avril 2020 [1ère diffusion. 17 décembre 2013]
346 George Sand, Correspondance. Georges Lubin, Classiques Garnier. Tome XX. 942p. 1985. p.46
347 George Sand, Correspondance. Georges Lubin, Classiques Garnier. Tome XX. 942p. 1985. p.328
348 Le Canard enchaîné, En attendant le Grenelle. 30 octobre 2019. p.2
349 La Croix, Marlène Schiappa : ‘Les violences conjugales ne sont pas des affaires privées’. 29 octobre 2019
350 Le Monde, Soixante mesures contre les violences conjugales. 30 octobre 2019
351 Marianne, Marlène Schiappa : ‘Nous allons expulser les étrangers condamnés pour violences sexuelles’. 7 novembre 2019
352 France Culture, Violé-es, Une histoire des domination. En venir aux mots. 7 décembre 2020
353 Le Monde Diplomatique, Vraies guerrières et faux héros. novembre 2019. p.26
354 France Culture, Anne Sinclair. Avec DSK, pour le meilleur et pour le pire. 22 septembre 2022
355 Gloria Steinem, Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe. Harper Collins. 393p. 2019. p.92, 93
356 Anton Tchékhov, L’étudiant. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.315
357 Awa Thiam, La parole aux négresses. Denoël. 189p. 1977. Dépôt légal. 1983. p.90
358 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.988, 899
359 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.956, 957
360 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. II. (1890-1904). La Pléiade. 1399p. 1980. p.829
361 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. III. (1905-1910). La Pléiade. 1368p. 1985. p.860, 1213
362 Flora Tristan, Promenades dans Londres. p.130. In : Évelyne Bloch-Dano, Flora Tristan. Une femme libre. Grasset. Le livre de poche. 442p. 2018. p.280
363 Le Monde, Trump fustige ‘les fausses accusations’ de violences conjugales à la Maison Blanche. 10 février 2018
364 France Culture, Victorine, la veille Bretonne. 6 août 2020 [1ère diffusion. 20 octobre 2005]
365 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.54, 72, 75, 76, 86
366 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.479, 743, 904
367 XVIIIème siècle, Alain Nabarra, ‘Les rapports que nous font les hommes’. Voltaire et l’affaire Lerouge. n°39. 2007. (Lisible sur le net)
368 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.490
369 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.743, 904
370 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.619, 1210
371 Émile Zola, Thérèse Raquin. Garnier Flammarion. 253p. 1970. p.224, 232
372 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La fortune des Rougon. La Pléiade. 1709p. 1960. p.45
373 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.422
374 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.689
375 Émile Zola, Correspondance. III. 1877-1880. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 543p. 1982. note 2, 4. p.211, 212
376 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1295
377 Émile Zola, Germinal. Fasquelle. Le livre de poche. 503p. 1969. p.188, 189
378 Émile Zola, Germinal. Fasquelle. Le livre de poche. 503p. 1969. p.257
379 Émile Zola, Germinal. Fasquelle. Le livre de poche. 503p. 1969. p.392
380 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.372
381 Émile Zola, La bête humaine. GF. Flammarion. 459p. 2011. p.94, 96, 209, 363, 364, 365
382 Émile Zola, L’argent. Le livre de poche. 501p. 1978. p.398
383 Émile Zola, L’argent. Le livre de poche. 501p. 1978. p.464
384 Émile Zola, L’argent. Le livre de poche. 501p. 1978. p.473
385 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.474
386 Louis Aragon, Les beaux quartiers. Folio. Gallimard. 625p. 2012. p.62, 318
387 In : Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.363
388 Suétone, Vies des douze Césars. Folio. Gallimard. 1975. 497p. p.141
389 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.292
390 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.559, 692
391 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. II. 1845-1850. Bouquins. Robert Laffont. 1209p. 1990. p.87
392 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. p.189
393 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. p.577, 578
394 Nina Berberova, C’est moi qui souligne. Actes Sud / Labor / L’aire. 609p. 1990. p.455
395 Chaîne Histoire, Anne-Marie Thunissen, Femmes machines. 20 novembre 2016 [1ère diffusion. 1996]
396 France Culture, La Fabrique de l'histoire. Histoire des domestiques et de la domesticité. Catégorie T. Bonne de ferme. 11 avril 2017
397 Hermann Broch, Les somnambules. I. Gallimard. 1985. 388p. p.71, 72
398 Pierre Truche, L’anarchiste et son juge. À propos de l’assassinat de Sadi Carnot. Fayard. 190p. 1994. p.162
399 Isabelle de Charrière, Lettres Neuchâteloises. In : Romans de femmes du XVIIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1085p. 1996. p.285
400 France Culture, Les Inconnus de l’histoire. Gilles de Gouberville. 19 août 2017 [1ère diffusion. 15 janvier 1982]
401 Louise Colet, Le poème de La femme. 2ème récit. La Servante. In : Micheline Bood et Serge Grand, L’indomptable Louise Colet. Pierre Horay. 235p. 1986. p.142
402 Comte de Comminges, Souvenirs d’enfance et de régiment. 1831-1870-71. Plon. 249p. 1933. p.34, 39
403 Robert Debré, L’honneur de vivre. Stock. Hermann. 462p. 1974. p.435
404 Daniel Defoe, Heurs et malheurs de la célèbre Moll Flanders. In : Moll Flanders. La Pléiade. 1728p. 1969. p.645
405 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.66
406 Françoise Dolto, La cause des enfants. Le livre de poche. 638p. 1985. p.34
407 Fiodor Dostoïevski, Correspondance. 2. (1865-1873). Bartillat. 905p. 2000. p.115
408 Claude Dulong, Anne d’Autriche. Folio. Histoire. Gallimard. 523p. 1985. p.16
409 Henry Fielding, Histoire de Tom Jones. Folio. Classique. Gallimard. 1142p. 2007. p.399, 400
410 Jean Pierre Hirsch, La nuit du 4 août. Collection Archives. Gallimard. Julliard. 283p. 1978. p.25, 26, 268
411 Françoise Giroud, Leçons particulières. Fayard. 260 p.1990. p.39, 40
412 Christine Ockrent, Françoise Giroud. Une ambition française. Fayard. 364p. 2003. p.60
413 Edmond de Goncourt, La fille Élisa, La Faustin. UGE. 10/18. 426p. 1978. p.47
414 Vassili Grossman, Vie et destin. Julliard / L’âge d’Homme. 818p. 1993. p.241, 242
415 Émile Guillaumin, La vie d’un simple. In : Paroles de paysans. Présentés par Michel Ragon. Omnibus. 748p. 2005. p.169
416 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.212, 213
417 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.254
418 Yvonne Knibielher et de Catherine Fouquet, Histoire des mères du Moyen-Âge à nos jours. Éditions Montalba. 359p. 1977. p.167
419 Panaït Istrati, Vers l’autre flamme. 10/18. 1980. p.139,140
420 Astolphe de Custine, Lettres à Varnhagen. Stalkine Reprints. Genève. 509p. 1979. p.403
421 Ryszard Kapuściński, Ébène. Aventures africaines. Plon. Pocket. 373p. 2002. p.282, 283
422 Roger Knobelspiess, Voleur de poules. Une histoire d’enfant. 193p. 1991. p.124
423 Alice Sapritch, Ma vérité. Femme-Public. Presses Pocket. 212p. 1988. p.30
424 France Culture, L’affaire LIP. Un hold-up ? Non une usine occupée. 24 septembre 2022
425 Mémoires du duc de Saint-Simon. Choix et présentation de Paul Galleret. 10/18. 443p. 1974. p.136
426 Robert Grimm, Luther et l’expérience sexuelle. Sexe, célibat, mariage chez le réformateur. Histoire et société. n° 39. Labor et Fides. 431p. 1999. p.99, 378, 379
427 Léo Malet, Corrida aux Champs-Élysées. In : Léo Malet. Bouquins. Robert Laffont. 1106p. 1986. p.15
428 Thomas Mann, Les Buddenbrook. Le livre de poche. Fayard. 2019. 764p. p.380, 383, 386, 387, 388, 391
429 Marat, Les aventures du jeune comte Potowski. In : Marat, Textes choisis. ES. Les classiques du peuple. 251p. 1975. p.65
430 Sándor Márai, Les confessions d’un bourgeois. Le livre de poche. Albin Michel. 574p. 1993. p.71, 72
431 Sándor Màrai, Métamorphoses d’un mariage. Albin Michel. 448p. 2006. p.268
432 In : Nouvelles du XVIIIème siècle. La Pléiade. 1552p. 2002. p.1500, 1501
433 Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste. février 1848
434 Karl Marx, ‘Prolétaires de tous les pays, unissez-vous’ . Kommunistische Zeitschrift. n°1. In : Karl Marx, Œuvres politiques. I. La Pléiade, 1829 p. 1994. p.990
435 Daniel Guérin, L’anarchisme. Folio. Essais. Gallimard. 286p. 2019. p.226
436 Pierre Larousse, Pages du Grand dictionnaire universel du XIXème siècle. 10/18. 309p. 1975. p.215
437 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.1169
438 Jules Michelet, Histoire de la révolution française. II. La Pléiade. 1308p. 1939. p.670, 671
439 Montaigne, Essais. I. Folio. Gallimard. 10/18. 505p. 1962. p.179, 180, 181
440 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.362
441 Gilles Perrault, Notre ami, le roi. Gallimard. 367p. 1990. p.18, 214
442 Clarisse Feletin, Hélène Viannay, L’instinct de résistance. De l’Occupation à l’école des Glénans. Préface de René Rémond. Éditions Pascal. 254p. 2004. p.53
443 Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.384
444 France Inter, Philippe Pétain, le fils de la morte. 11 juillet 2022
445 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.239
446 France Culture, Entre histoire et légende. Métamorphoses du mythe de Phoolan Devi. 21 mars 2020 [1ère diffusion. 26 mars 1996]
447 André Stil, Femmes, que vous êtes. Éditions sociales. 94p. 1963. p.43
448 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.238
449 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.1028, 1092
450 Samuel Richardson, Paméla où la vertu récompensée. 10/18. 2019. 480p.
451 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468p. 1997. p.437
452 Voltaire, Correspondance IX (juillet 1767-septembre 1769). La Pléiade. 1601p. 1985. p.923
453 Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs. I. Une édition féministe de Claudine Herrmann. Des Femmes. 360p. 1984. p.227
454 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation. Garnier Flammarion. 629p. 1966. p.257
455 Pierre Pascal, Journal de Russie. 1928-1929. Les Éditions Noir sur blanc. 766p. 2014. p.253
456 Pierre Pascal, Journal de Russie. 1928-1929. Les Éditions Noir sur blanc. 766p. 2014. p.644
457 Jean-Paul Sartre, Dullin et l’Espagne, In : Situations, II. NRF. Gallimard. 474p. 2012. p.17
458 Danilo Dolci, Enquête à Palerme. Les Temps Modernes. Julliard. 336p. 1957. p.192
459 Danilo Dolci, Enquête à Palerme. Les Temps Modernes. Julliard. 336p. 1957. p.242
460 Georges Simenon, Mémoires intimes. France Loisirs. 753p. 1982. p.468
461 In : Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.388
462 Stendhal, Oeuvres intimes. I. La Pléiade. 1637p. 1981. p.1061
463 William Styron, Les confessions de Nat Turner. Folio. Gallimard. 529p. 1969. p.227
464 France Culture, Anne Sylvestre. 21 janvier 2021 [1ère diffusion. 31 décembre 2003]
465 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.242, 243
466 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.591
467 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.722
468 William Makepeace Thackeray, La foire aux vanités. Folio. Classique. Gallimard. 1071p. 2005. p.151
469 Anton Tchékhov, Récit d’un inconnu. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.144
470 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.637
471 Léon Tolstoï, Souvenirs. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.391
472 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. Note. p.1608
473 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. III. La Pléiade. 1368p. 1985. p.1625, 1144
474 Léon Tolstoï, Résurrection. Marabout Géant. 522p. (s,d) p.12, 13, 89
475 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.979, 1608
476 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.873, 1164
477 Le Figaro, Les cinq mesure phares de la loi qui veut révolutionner la lutte contre la prostitution. 6 avril 2016
478 Roger Vaillant, La Loi. NRF. Gallimard. 313p. 1957. p.71
479 Vassilis Vassilikos, Les photographies. Gallimard. 224p. 1969. p.84, 85
480 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.770
481 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p. 635
482 Voltaire, Le droit du seigneur. Imprimé à Genève. 1762. (Lisible sur Gallica)
483 In : Beaumarchais, Œuvres. La Pléiade. 1696p. 1988. Notice, Le mariage de Figaro. p.1361
484 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.193
485 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.466
486 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468p. 1997. p.367
487 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.750
488 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.761
489 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.775
490 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.784
491 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.1114
492 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.1445, 1578
493 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.130
494 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.186, 1197
495 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.581
496 Alexandre Zinoviev, L’avenir radieux. L’Age d’homme. 280p. 1978. p.180, 181
497 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.413, 414
498 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.136
499 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.132
500 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.262
501 Émile Zola, Au bonheur des dames. Préface. Garnier Flammarion. 442p. 1971. p.318, 366
502 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.437
503 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.606
504 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.674, 675
505 Émile Zola, Germinal. Fasquelle. Le livre de poche. 503p. 1969. p.125
506 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. L’oeuvre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.(à retrouver)
507 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.429
508 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.441, 442
509 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.521
510 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La bête humaine. La Pléiade. 1806p. 1967. p.1009
511 L’Express, 17 février 2015
512 Le Monde, Les femmes entrent en force au parlement Turc. 9 juin 2015
513 France Culture, Du jour au lendemain, Chantal Akerman pour son livre : Ma mère rit. 7 novembre 2013. [2ème écoute, La nuit Chantal Akerman. 11 février 2018]
514 Michelle Perrot, Mon histoire des femmes. Éditions du Seuil. France Culture. 247p. 2008. p.161
515 Le Canard enchaîné, Duflot et Mélenchon à la manœuvre ; Cf. aussi, La Hollandie harcelée par l’affaire Baupin. 11 mai 2016
516 Metro news, Après l’affaire Baupin, le groupe écolo se disloque à l’Assemblée Nationale. 19 mai 2016
517 Le Figaro, Le PS regagne sa majorité absolue à l’Assemblée Nationale. 24 mai 2016
518 Cf. notamment : Le Monde, Affaire Baupin. ‘Nos témoignages ont été validés par la justice’. 7 mars 2017
519 Karel Capek, Une vie ordinaire. Éditions L’Age d’Homme. 165p. 2002. p.134
520 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.92
521 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.995
522 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.366
523 Le Figaro, Claude Lanzmann, arrêté pour harcèlement sexuel en Israël. 8 février 2012
524 JSSNews, 8 février 2012
525 Alice Coffin, Portrait de Claude Lanzmann en ‘séducteur brusque’ : la presse française n’a rien appris de Metoo. 7 juillet 2018 (source à retrouver)
526 Blog de Corinne Lesnes, Le Monde, Croquis d'Amérique. Quand Monica Lewinski se rappelle au bon souvenir des Clinton. 12 mai 2014
527 Le Monde, Harcèlement sexuel : quatre ‘sages’ connaissaient le requérant. 5 mai 2012
528 V.S. Naipaul, L’Inde. Plon. 10/18. 1992. 666p. p.27, 28
529 Dictionnaire des droits de l’homme. Sous la direction de Joël Andriantsimbazovina, Hélène Gaudin, Jean-Pierre Marguénaud, Stéphane Rials, Frédéric Sudre. PUF. 1074 p. 2008. p.605, 606
530 Le Monde, Affaire du Carlton : L’incrimination du proxénétisme est extrêmement large. 22 mai 2012
531 Le Parisien, Le client puni se rebiffe. 29 août 2017
532 Le Canard enchaîné, Une histoire de QPC. 19 septembre 2018. p.5
533 Émile Zola, Au bonheur des dames. Préface. Garnier Flammarion. 442p. 1971. p.211
534 Roger Vailland, La Loi. Le livre de poche. 378p. 1965. p.292, 293
535 Mediapart, Harcèlement sexuel : le projet de loin sera peaufiné au Parlement. 14 juin 2012
536 Jacques Vergès, Journal. La passion de défendre. Éditions du Rocher. 403p. 2008. p.200
537 In : Sous la direction de Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset, Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir. PUF. 773p. 2022. p.705
538 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.513
539 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.514, 515
540 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.516
541 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.615
542 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.721
543 George Eliot, Felix Holt, le radical. Folio. Classique. Gallimard. 2021. 801p. p.98, 99
544 AFP. Le Monde, Triomphe du britannique Sam Smith aux Grammy Awards. 9 février 2015
545 Comtesse de Ségur, Le général Dourakine. Hachette. Bibliothèque rose illustrée. 375p. 1907. p. 134, 137, 56, 57
546 In : Sophie Laffite, Tchékhov par lui-même. Éditions du Seuil. Écrivains de toujours. 191p. 1955. p.13, 14, 136, 137
547 Marie-Hélène Luiggi, Marie-Louise Girod. La dame d’En Haut. Montauban, Impr. Lormand. 166p. 2003. p.94, 95
548 In : Georges Sorel, Réflexions sur la violence. Deuxième édition. Paris, Marcel Rivière et Cie. 412 p. 1910. p.86